Fiches biographiques
Saint Augustin
Saint Augustin (354-430): Sa Vie
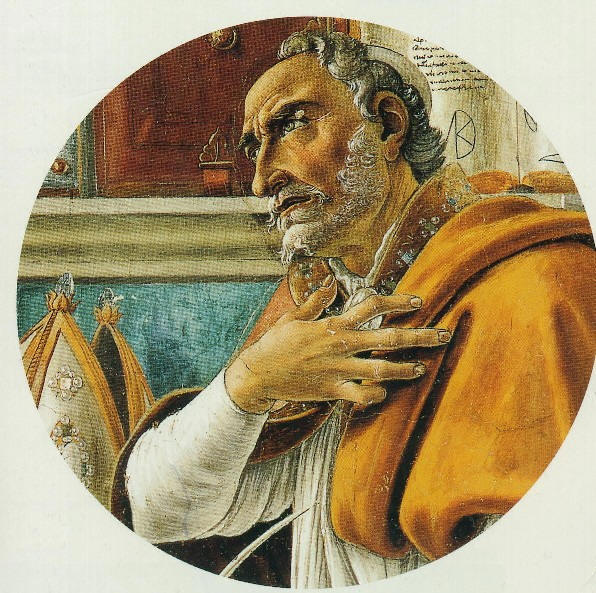 Augustin est né à
Thagaste, une petite ville romaine de la côte algérienne actuelle. Il
appartient à la petite élite chrétienne locale. Il est nourri par les
perspectives dorées de carrière à Rome. Il pratique un paganisme local,
c'est une communauté syncrétique qui intègre des éléments locaux, chrétiens
et romains. Il voulait être avocat, c'est une profession disait-il ou plus
on ment plus on réussit. finalement il ouvrira à Carthage une école de
rhétorique. Son talent de professeur le pousse à Rome ou on le réclame puis
à Milan. Il a aussi une vie privée très agitée, il est très préoccupé par
les problème de chaire.
Augustin est né à
Thagaste, une petite ville romaine de la côte algérienne actuelle. Il
appartient à la petite élite chrétienne locale. Il est nourri par les
perspectives dorées de carrière à Rome. Il pratique un paganisme local,
c'est une communauté syncrétique qui intègre des éléments locaux, chrétiens
et romains. Il voulait être avocat, c'est une profession disait-il ou plus
on ment plus on réussit. finalement il ouvrira à Carthage une école de
rhétorique. Son talent de professeur le pousse à Rome ou on le réclame puis
à Milan. Il a aussi une vie privée très agitée, il est très préoccupé par
les problème de chaire.
Il est adepte du dualisme manichéen. C'est une doctrine qui fait du mal un
principe rival du bien. Sous l'influence de sa mère, famille chrétienne, en
lisant Plotin et les néoplatoniciens, il abandonne rapidement ce dualisme.
Plotin le convainc que l'Un, le bien originel est la source de tout ce qui
existe, le mal simple défaut du bien, n'est donc pas à ériger au même rang
que le bien.
Il se convertit au christianisme et demande le baptême en 388. Il est
ordonné prêtre en 391, il devient évêque d'Hippone (Bône deuxième ville
d'Afrique) en 395. En 410 Rome est envahit par les barbares qui prétendent
que les dieux délaissés punissent les Romains, augustin réplique alors par
son ouvrage : « la cité de Dieu ».
Il meurt en 430 à Hippone pendant que des hordes de vandales assiégent sa
ville.
SAINT AUGUSTIN (354-430) : Sa Philosophie
Saint Augustin est à la fois témoin de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, acteur de l'Eglise chrétienne, et un homme de la fin de l'Antiquité hanté par de grandes questions philosophiques et religieuses. Son œuvre immense recourt avec succès à tous les genres littéraires, du traité philosophique à l'échange épistolaire, de l'autobiographie au sermon.
Après avoir cherché réponses à ses questions auprès des manichéens, en adhérant à leur secte pendant presque dix ans, il découvre à Milan le néoplatonisme relu par un chrétien, l'évêque Ambroise, et y trouve enfin une philosophie capable de fonder rationnellement sa foi. C'est donc une mutation intellectuelle qui provoque sa conversion religieuse.
C'est dans le texte
que se trouve le moteur enfin efficace de la conversion: la grâce divine se
produit dans la lecture:(extrait des
confessions)
"Je pris le livre, l'ouvris et lus en silence, le premier chapitre où
tombèrent mes yeux : "ne vivez pas dans la ripaille et l'ivrognerie, ni dans
les plaisirs impudiques du lit, ni dans les querelle et les jalousies; mais
revêtez-vous du Seigneur Jésus-christ, et ne pourvoyez pas à la
concupiscence de la chaire." Je ne voulus pas en lire d'avantage, c'était
inutile. a peine avais-je fini de lire cette phrase qu'une espèce de lumière
rassurante s'était répandue dans mon cœur, y dissipant toutes les ténèbres
de l'incertitude.
La vie de cet homme étonnant, dont les talents d'orateur rivalisent avec ses capacités spéculatives, est donc animée par un désir ardent de connaître Dieu. De ce désir découle une mystique où le théologien ne cesse d'être un penseur et où le philosophe se nourrit de l'expérience quotidienne de la foi. Toute l'œuvre augustinienne, dans son ampleur et sa variété, est un dialogue perpétuel entre un homme qui cherche Dieu, et Dieu qui le guide. Ses quelque 113 traités, 200 lettres et 500 sermons sont traversés par l'intuition fondamentale de la recherche de Dieu.
Ainsi, le De Trinitate avance la thèse selon laquelle le mystère de la Trinité, dogme religieux fondamental, s'incarne dans tous les êtres, du plus matériel au plus spirituel, et ouvre sur une ontologie et une psychologie des facultés. L'âme humaine, qui est à la fois mémoire, intelligence et volonté, représente aussi la triple image du Créateur. Par sa nature, l'homme est d'abord uni à Dieu, car créé à son image. Toutefois, l'homme est sans doute l'image la plus complexe de Dieu, car il est le seul être capable de refuser ce statut d'image. Si notre volonté tend foncièrement à s'attacher à Dieu par l'amour, elle peut aussi s'en détourner par l'orgueil, lorsque nous nous préférons à Dieu et croyons trouver en nous-mêmes le bien que seul Dieu peut nous accorder. L'orgueil, qui est ainsi la racine de tous les vices, permet de comprendre que le mal n'est pas une substance opposée à la bonté divine, mais une privation, une déficience de notre volonté qui se détourne de sa destination propre, se prive de Dieu et se perd loin de lui.
Le sens le plus haut de notre liberté est donc, selon Saint Augustin, non pas de choisir entre bien et mal, mais d'adhérer à l'action de Dieu en nous. Les événements de notre vie deviennent ainsi des étapes d'une histoire au cours de laquelle, perdus loin de Dieu, nous revenons vers lui, grâce à lui. L'itinéraire individuel s'épanouit dans l'histoire collective, et la spiritualité augustinienne s'achève dans une théologie de l'histoire, formulée dans les 22 livres de la Cité de Dieu.
Bibliographie :
Contre les philosophes de l’académie 386
Du libre arbitre 388/395
Le Maître 389
De la Trinité 399/419
Les Confessions 400
La cité de Dieu 410/426
Fiche préparée par Jean Michel
Van Couyghem
Saint Augustin - Les confessions (I-III)
par Jean-Claude Fraisse
Cet
ouvrage de Jean-Claude Fraisse sur Les
Confessions (I-III) de Saint Augustin, anciennement publié dans la
collection Profil d'une oeuvre chez
Hatier, est repris ici grâce au soutien de Laurence Hansen-Løve, ancienne
directrice de la collection.
"Les Confessions, par leur souci de mémoire descriptive,
d’auto-justification, de proposition d’un itinéraire spirituel exemplaire,
sont devenues elles-mêmes le modèle de tant de «Méditations», «Journaux»,
«Itinéraires», «Confessions» mêmes, que l’on doit toujours rechercher, à
travers les temps ultérieurs, les normes qu’elles ont imposées aux écrits
dont elles constituaient l’horizon, même lorsqu’ils s’en sont résolument
démarqués. Sans doute est-ce aux Confessions d’Augustin que ces écrits
doivent, non seulement leur volonté de se proposer pour modèles et de
justifier des voies nouvelles, mais leur conscience des enrichissements liés
aux erreurs, leur mise au jour des conflits entre spontanéité personnelle et
nécessités de la tradition sociale, leur vivante expérience de l’obscurité
de l’homme à lui-même. On y retrouve le conflit entre des fins rationnelles
ou intérieures et des motivations obscures, aliénantes et, éventuellement,
corruptrices. La lumière que le néophyte a reçue en fait toujours à la fois
un juge intransigeant, et un analyste de ses incertitudes antérieures,
autrement dit un philosophe soucieux du Bien et un psychologue «des
profondeurs»."
Bienvenue| Cours de philosophie| Suivi des classes| Fiche auteur| Liens sur la philosophie| Nos travaux| Informations E-mail : philosophie.spiritualite@gmail.com