Questions et réponses sur la leçon:
Le statut des sciences humaines
J. Pierre Castel
Q. Je lis dans votre leçon Le statut des sciences humaines que « les
philosophes [grecs] ont formulé […] les lois de la Nature », ce qui me
paraît assez évident (comme le fameux Eurêka d’Archimède). Et pourtant
nombre d’auteurs plaident que :
« L'idée que la raison puisse s'appliquer à
toutes choses implique que toutes choses soient intelligibles, qu'il n'y ait
pas d'irrationnel. Or chez Platon comme chez Aristote, s'il existe un seul
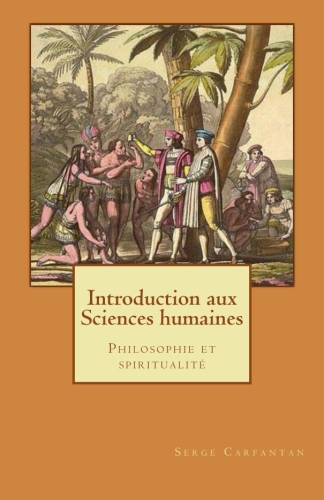 principe pour rendre compte de toutes choses, il y a de l'irrationnel, de
l'inintelligible dans le monde sensible ou sublunaire : on y trouve de
l'ordre, certaines régularités imparfaites, comme les saisons, mais pas de
lois véritables. La raison n'est donc pas valable universellement. C'est
seulement avec Galilée puis Descartes et Spinoza que la modernité admettra
que le réel est parfaitement intelligible et qu'ainsi des lois de la nature
sont possibles. »
principe pour rendre compte de toutes choses, il y a de l'irrationnel, de
l'inintelligible dans le monde sensible ou sublunaire : on y trouve de
l'ordre, certaines régularités imparfaites, comme les saisons, mais pas de
lois véritables. La raison n'est donc pas valable universellement. C'est
seulement avec Galilée puis Descartes et Spinoza que la modernité admettra
que le réel est parfaitement intelligible et qu'ainsi des lois de la nature
sont possibles. »
Même pour JP Vernant "[la philosophie grecque] ne s’est pas beaucoup rapprochée du réel physique ; elle a peu emprunté à l’observation des phénomènes naturels ; elle n’a pas fait d’expérience. La notion même d’expérimentation lui est demeurée étrangère. Elle a édifié une mathématique sans chercher à l’utiliser dans l’exploration de la nature. Entre le mathématique et le physique, le calcul et l’expérience, cette connexion a manqué ce qui nous a paru unir au départ le géométrique et le politique. Pour la pensée grecque, si le monde social doit être soumis au nombre et à la mesure, la nature représente plutôt le domaine de l’à-peu-près auquel ne s’appliquent ni calcul exact ni raisonnement rigoureux. La raison grecque ne s’est pas tant formée dans le commerce humain avec les choses que dans les relations des hommes entre eux…. » Dire que les Grecs n’ont pas fait d’expérience ma paraît grotesque , même si leurs moyens de mesure, en particulier du temps, étaient évidemment limités. Pourrais-je avoir votre avis . L’invention de la notion de loi de la nature n’est-elle pas au cœur de l’invention des sciences par les Grecs (pas seulement les mathématiques, mais aussi la mécanique, l’optique, la médecine, …)?
R. Je souscrit tout à fait au premier texte. Il me semble que la difficulté vient du concept de loi qui n'est pas clair du tout. Avec Newton, disons dans le paradigme mécaniste, nous voyons bien ce qu'il signifie, mais chez les grecs, c'est moins facile. Quand Platon invoque les Lois, dans la prosopopée des lois devant Socrate, il ne sépare pas la notion de loi divine et de loi comme fondement, pilier de la Cité. Il reproche aux Sophistes de faire de la loi un principe arbitraire, alors qu'elle est fondée sur un principe cosmique. Comme l'idée de Dharma en Inde. Un Grec parlerait de l'Ordre dans la Nature, l'ordre finalisé selon Aristote, qui en cela prolonge Platon. Ce sont des raisons éternelles qui régissent le Cosmos et non pas la déraison du Chaos. L'idée émise dans le livre, c'est que nous pourrions nous représenter les dieux dans la métaphysique traditionnelle comme symboles des lois de la Nature qui supportent toutes choses, créent, maintiennent et détruisent à tour de bras, monde après monde, mais demeurent inaltérables dans leur essence. A coup sûr, ce n'est pas du tout une idée de la loi de la Nature telle qu'elle a été développée dans le paradigme mécaniste. Voyez à ce propos comme Stuart Mill parle des lois naturelles dans son essai sur la Nature. C'est un mécaniste brut. Maintenant, qu'il y ait de l'irrationnel pour Aristote oui bien sûr, du fait de la matière, la matière résiste à l'action de la forme dans le vivant et cela donne parfois des "monstres", alors que d'ordinaire, les Idées se répliquent plutôt bien, d'où la perfection que l'on trouve dans le règne végétal et animal.
Q. Même pour J.P. Vernant "[la philosophie grecque] ne s’est pas beaucoup rapprochée du réel physique ; elle a peu emprunté à l’observation des phénomènes naturels ; elle n’a pas fait d’expérience. La notion même d’expérimentation lui est demeurée étrangère. Elle a édifié une mathématique sans chercher à l’utiliser dans l’exploration de la nature. Entre le mathématique et le physique, le calcul et l’expérience, cette connexion a manqué ce qui nous a paru unir au départ le géométrique et le politique. Pour la pensée grecque, si le monde social doit être soumis au nombre et à la mesure, la nature représente plutôt le domaine de l’à-peu-près auquel ne s’appliquent ni calcul exact ni raisonnement rigoureux. La raison grecque ne s’est pas tant formée dans le commerce humain avec les choses que dans les relations des hommes entre eux…. » Dire que les Grecs n’ont pas fait d’expérience me paraît grotesque , même si leurs moyens de mesure, en particulier du temps, étaient évidemment limités. Pourrais-je avoir votre avis . L’invention de la notion de loi de la nature n’est-elle pas au cœur de l’invention des sciences par les Grecs (pas seulement les mathématiques, mais aussi la mécanique, l’optique, la médecine, …)?
R. Oui c'est la position universitaire en général. Cependant, j'ai des doutes, la découverte du mécanisme d'Anticytère m'a troublé. Elle prouve indiscutablement qu'à une époque très reculée, les grec ont pratiqué la mécanique à un très haut degré, ce qui met par terre l'idée que l'on s'est fait longtemps d'une culture qui aurait dédaigné la technique. Une idée fausse. En plus il y a un accord pour attribuer le mécanisme d'Anticytère à Archimède! Nous ignorons beaucoup de choses en histoire. Il ne faut pas l'oublier. Mais ce qui reste vrai, c'est que la science grecque était fortement orientée vers la contemplation, pas vers l'action, la maîtrise de la Nature. Une civilisation dont l'empreinte est avant tout l'éthique. cf Paideia de Jaeger.
Avec la participation de
Bienvenue| Cours de philosophie| Suivi des classes|
Dialogues| Liens sur la philosophie| Nos travaux| Informations
E-mail : philosophie.spiritualite@gmail.com