Textes philosophiques
Serge Carfantan de la causalité scientifique
....
S’il est un mode de raisonnement spontané, c’est bien, devant un
phénomène qui nous étonne, de trouver « une cause ». Si je vois le vase
renversé sur la table, je me demande comment cela s’est produit, je
cherche une explication. Est-ce le chat qui a sauté sur la table ?
Est-ce le poids des fleurs ? La balle des enfants ? Un esprit
frappeur ? Une explication est satisfaisante quand elle livre une cause
intelligible, qui puisse rendre raison de l’apparition du phénomène B à
la suite d’un phénomène A, de telle manière que le passage de A à B
devienne compréhensible. Si on me dit que
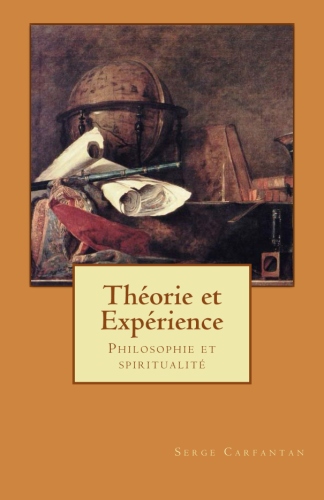 le
chat a sauté sur la table, je suis satisfait, j’ai la cause du fait que
le vase a été renversé. Nous procédons ainsi très fréquemment, dès
qu’un phénomène nous surprend, et n’entre pas dans l'ordre dit
« normal » des choses.
le
chat a sauté sur la table, je suis satisfait, j’ai la cause du fait que
le vase a été renversé. Nous procédons ainsi très fréquemment, dès
qu’un phénomène nous surprend, et n’entre pas dans l'ordre dit
« normal » des choses.
Où est donc la cause dite scientifique ? Elle doit être inscrite dans une théorie. Ce n’est pas le raisonnement causal qui est « scientifique », il est tout à fait banal, mais la manière dont on interprète la causalité dans les sciences de la Nature. En effet, la science n’est pas prête à accepter n’importe quelle cause, surtout une cause qui serait impondérable et invérifiable. Elle donne à la cause une interprétation rationnelle. Et d’une rationalité assez serrée puisqu'elle exige de la causalité une traduction dans des mesures. D’autre part, elle pense la causalité à l’intérieur d’une représentation du déterminisme qui n’est pas celle du sens commun. La cause est représentée comme un phénomène qui est potentiellement porteur d’un effet, qu’il produit dans des conditions favorables. Il est ainsi fréquent de lire dans des revues scientifiques des rapports du genre : « Des chercheurs américains viennent de dmontrer que la consommation de café chez la femme enceinte pouvait être la cause d’accouchements prématurés ».
Théorie et Expérience ch. IV, p. 79.
Indications de lecture:
Le chapitre s'intitule les éléments de la théorie scientifique. Plus de
développement dans la suite du texte.Le PDF de la leçon est diponible.
![]()
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Bienvenue| Cours de
philosophie| Suivi des
classes| documents| Liens sur la philosophie| Nos travaux| Informations
E-mail : philosophie.spiritualite@gmail.com