Quand nous rencontrons un -isme dans une expression, il faut y
voir une
doctrine. Une doctrine qui
organise une action
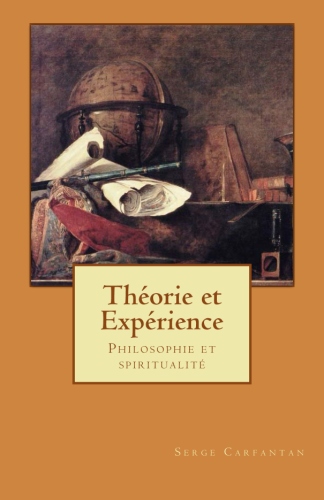 sociale et politique, est une
idéologie.
Enfin, un -isme s’emploie comme système revendiqué comme tel
(comme l’existentialisme pour Sartre) ou bien comme expression
péjorative (comme l’intégrisme des religions). Il est remarquable que
le scientisme
présente tous ces caractères à la fois. Le
terme apparaît historiquement sous la plume de Romain Rolland pour désigner un
courant très vivace au XIXème siècle dont l’une des formes a été le
positivisme d’Auguste Comte. Il comporte trois articles de foi : a) la
science est le seul savoir authentique, donc le meilleur des savoirs ; b) la
science est capable de répondre à toutes les questions théoriques, du moment que
ces questions sont formulées de manière scientifique ; c) il est souhaitable de
confier aux scientifiques le soin de toutes les affaires humaines (morale,
politique, économie etc.).
sociale et politique, est une
idéologie.
Enfin, un -isme s’emploie comme système revendiqué comme tel
(comme l’existentialisme pour Sartre) ou bien comme expression
péjorative (comme l’intégrisme des religions). Il est remarquable que
le scientisme
présente tous ces caractères à la fois. Le
terme apparaît historiquement sous la plume de Romain Rolland pour désigner un
courant très vivace au XIXème siècle dont l’une des formes a été le
positivisme d’Auguste Comte. Il comporte trois articles de foi : a) la
science est le seul savoir authentique, donc le meilleur des savoirs ; b) la
science est capable de répondre à toutes les questions théoriques, du moment que
ces questions sont formulées de manière scientifique ; c) il est souhaitable de
confier aux scientifiques le soin de toutes les affaires humaines (morale,
politique, économie etc.).
Il n’en faut guère plus pour se rendre compte qu’il s’agit d’un projet
totalitaire. La Modernité et dans la foulée le siècle des
Lumières, ont mené une critique sévère des ambitions totalitaires de la
religion. Après les expériences violentes du XXème siècle, la
postmodernité a développé une critique sans concession des ambitions
totalitaires des idéologies politiques.
Mais
le scientisme lui a survécu et il est très présent dans nos mentalités. Il
existe sous une forme pure
dans le courant positiviste au XIXème siècle et dans la
science-fiction qui pousse jusqu’au bout la techno-science, comme Le
techno-centre dans Hypérion
de Dan Simmons.
Il
existe sous une forme atténuée,
bien que très active dans la postmodernité, car en conflit direct
avec des courants de pensée relativistes issus des sciences humaines.
Faut-il prendre au sérieux le scientisme, ou le considérer comme une idéologie
obsolète ?
Est-ce le fil conducteur du projet de civilisation de
l’Occident, comme le prétendent Pierre Thuillier, ou Jacques Ellul ? Ou le cri
de ralliement d’une espèce intellectuelle grégaire en voie d’extinction ? Quelle
place lui revient dans nos mentalités et nous conduit-il ?
*
*
*
Commençons donc par la première proposition : la science est le seul savoir
authentique, donc le meilleur des savoirs. Pour
le scientiste, c’est une évidence. « Il est entendu que « la science » est le
savoir le plus parfait et doit devenir la panacée universelle ». Ce qui veut
dire ? Dans d’autres cultures que celle de l’Occident, il n’y a que des savoirs
médiocres, magiques, folkloriques, ésotériques, religieux, mais dépourvus de
rigueur scientifique. Une des plus grandes fiertés de l’Occident est d’avoir
élaboré « la » science, ce qui
signifie la science pure - idée que
nous avons tous en tête quand nous parlons de la science alors que nous devrions
plutôt parler « des » sciences.
Grâce à la méthode expérimentale, nous
avons réussi à élaborer un savoir objectif. Si la science est le meilleur des
savoirs, c’est parce qu’elle est un savoir objectif. Elle est célébrée à ce
titre au XIXème siècle. Il n’est pas bien difficile à l’époque de
trouver une apologétique de la science dans la littérature. On n’a que
l’embarras du choix. Par exemple en 1910, celle de J. Novicow : « La science est
ce qu’il y a de plus auguste au monde. C’est notre dernière instance. Il n‘y a
rien au-dessus. Pour les esprits populaires, elle est comme la plus haute des
déesses. Fort heureusement pour le genre humain, le prestige de la science
augmente tous les jours. Et certes, plus la civilisation avancera, plus il
augmentera encore. D’abord parce que la science fera des découvertes toujours
plus nombreuses, plus profondes et plus surprenantes ; ensuite parce que les
hommes, affranchis des conceptions mythologiques et enfantines, auront les
esprits mieux préparés à recevoir les enseignements de recherches positives,
précises et exactes. Déjà l’autorité sans appel de la science n’est plus
contestée par le grand public pour tout ce qui concerne les faits physiques et
biologiques. Bientôt sans doute, on fera le dernier pas, et l’autorité de la
science s’imposera d’une façon aussi complète dans le domaine des connaissances
sociales. Alors on arrivera à faire une politique rationnelle, comme on fait
maintenant des machines électriques rationnelles, parce que construites
uniquement sur des données positives et non sur les tendances subjectives des
physiciens ».
 1)
« Positive » a ici un double
sens, voulant dire scientifique
conformément au positivisme d’Auguste Comte et opposé à
négatif, dans les concepts duels
positif/négatif. En quelques générations le positivisme a réussi une OPA sur le
mot « positif » au point que l’usage a fini par l’accepter. Pour ceux qui ont
une certaine culture, « donnée positives » se comprend de manière technique,
« positif » devenant équivalent de « scientifique », pour ceux qui n’ont pas
cette culture, ils comprendront à leur manière, « positif », c’est « très
bien » ! Comme quand on nous demander de positiver. De sorte que, en
arrière-fond, l’opposé, négatif est inconsciemment associé à non-scientifique.
Et c’est bien le cas, le scientisme fonctionne effectivement par rejet de tout
ce qui est savoir traditionnel, culturel etc. qui tombe dans l’ordre du
médiocre, approximatif, non-rigoureux, superstition, remèdes de bonne femme et
sorcellerie. Non, non, si la science est le meilleur des savoirs, c’est qu’elle
suit une approche objective dont le mérite est qu’elle
écoute seulement la voix des faits. Son rôle est de rassembler des faits,
puis par induction de dégager une loi qui puisse en rendre compte. La science
met en œuvre un faitalisme conséquent et efficace. Si le fatalisme est une
soumission à la mort, le faitalisme est une soumission aux faits, au sens tout à
fait habituel où on dit que dans l’approche scientifique, l’esprit doit
s’incliner devant les faits, les faits sont têtus et ils s’imposent à nous. Mais
encore faut-il les traiter comme il convient, c’est-à-dire objectivement. C’est
la grande idée de la méthode expérimentale,
véritable fer de lance du scientisme, qui va des faits, vers l’hypothèse, puis
sa vérification dans l’expérience. D’où la supériorité incontestée de la science
et le triomphe de la mesure qui établit chiffre à l’appui les preuves
scientifiques. Il ne faut surtout pas nuancer ce mot de « supériorité » sous
peine de perdre la quintessence idéologique du scientisme. La science est le
savoir supérieur là où tous les autres sont inférieurs. L’adjectif « meilleur »
est pleinement justifié par les acquis de la physique, de la chimie, de la
génétique, de la biologie moléculaire. Les méthodes des sciences exactes,
expérimentales et mathématisées, sont les
seules méthodes fiables et valides, et le programme du scientisme est de
les appliquer à tous les domaines de connaissance objective possibles, qu’ils
soient biologiques, sociaux, psychologiques, économiques, anthropologiques etc.
Toutes les disciplines doivent copier le modèle
de la physique et le répliquer dans leur domaine propre, c’est le
réductionnisme physicaliste. On verra donc apparaître un positivisme
historique, avec Langlois et Seignobos, une sociologie scientifique, avec
Durkheim, un positivisme logique, avec le cercle de Vienne, un positivisme
juridique, un positivisme linguistique etc. et même par contagion une « science
des textes » en littérature. Rien n’y réchappe
1)
« Positive » a ici un double
sens, voulant dire scientifique
conformément au positivisme d’Auguste Comte et opposé à
négatif, dans les concepts duels
positif/négatif. En quelques générations le positivisme a réussi une OPA sur le
mot « positif » au point que l’usage a fini par l’accepter. Pour ceux qui ont
une certaine culture, « donnée positives » se comprend de manière technique,
« positif » devenant équivalent de « scientifique », pour ceux qui n’ont pas
cette culture, ils comprendront à leur manière, « positif », c’est « très
bien » ! Comme quand on nous demander de positiver. De sorte que, en
arrière-fond, l’opposé, négatif est inconsciemment associé à non-scientifique.
Et c’est bien le cas, le scientisme fonctionne effectivement par rejet de tout
ce qui est savoir traditionnel, culturel etc. qui tombe dans l’ordre du
médiocre, approximatif, non-rigoureux, superstition, remèdes de bonne femme et
sorcellerie. Non, non, si la science est le meilleur des savoirs, c’est qu’elle
suit une approche objective dont le mérite est qu’elle
écoute seulement la voix des faits. Son rôle est de rassembler des faits,
puis par induction de dégager une loi qui puisse en rendre compte. La science
met en œuvre un faitalisme conséquent et efficace. Si le fatalisme est une
soumission à la mort, le faitalisme est une soumission aux faits, au sens tout à
fait habituel où on dit que dans l’approche scientifique, l’esprit doit
s’incliner devant les faits, les faits sont têtus et ils s’imposent à nous. Mais
encore faut-il les traiter comme il convient, c’est-à-dire objectivement. C’est
la grande idée de la méthode expérimentale,
véritable fer de lance du scientisme, qui va des faits, vers l’hypothèse, puis
sa vérification dans l’expérience. D’où la supériorité incontestée de la science
et le triomphe de la mesure qui établit chiffre à l’appui les preuves
scientifiques. Il ne faut surtout pas nuancer ce mot de « supériorité » sous
peine de perdre la quintessence idéologique du scientisme. La science est le
savoir supérieur là où tous les autres sont inférieurs. L’adjectif « meilleur »
est pleinement justifié par les acquis de la physique, de la chimie, de la
génétique, de la biologie moléculaire. Les méthodes des sciences exactes,
expérimentales et mathématisées, sont les
seules méthodes fiables et valides, et le programme du scientisme est de
les appliquer à tous les domaines de connaissance objective possibles, qu’ils
soient biologiques, sociaux, psychologiques, économiques, anthropologiques etc.
Toutes les disciplines doivent copier le modèle
de la physique et le répliquer dans leur domaine propre, c’est le
réductionnisme physicaliste. On verra donc apparaître un positivisme
historique, avec Langlois et Seignobos, une sociologie scientifique, avec
Durkheim, un positivisme logique, avec le cercle de Vienne, un positivisme
juridique, un positivisme linguistique etc. et même par contagion une « science
des textes » en littérature. Rien n’y réchappe
-------------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Vos commentaires
Questions:
![]() © Philosophie et spiritualité, 2020, Serge Carfantan,
© Philosophie et spiritualité, 2020, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()