Pour la plupart d’entre nous, le droit a un caractère contraignant. Nous le voyons même
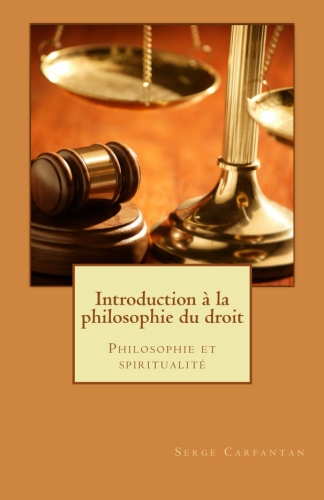 comme un système de contraintes
d'État qui est lié à un appareil répressif, celui de la police chargée de faire respecter la loi au nom de la sécurité et de l’ordre social. Sans rapport de force, soit des citoyens entre eux, soit des citoyens face à l’État, parlerait-on de droit ?
comme un système de contraintes
d'État qui est lié à un appareil répressif, celui de la police chargée de faire respecter la loi au nom de la sécurité et de l’ordre social. Sans rapport de force, soit des citoyens entre eux, soit des citoyens face à l’État, parlerait-on de droit ?
Mais c’est là une vision incomplète, puisque l’on emploie ce même mot de droit pour désigner aussi des exigences de justice. Chacun a le droit de manger à sa faim, le droit de s’exprimer, le droit de mener une vie décente, de jouir d'une liberté de pensée, d'une liberté de croyance, chacun à droit au respect de sa vie privée etc. Mais il est vrai que les réclamations subjectives au nom du droit sont assez différentes de l’exercice du droit positif à l’intérieur d’une société. Elles ont un caractère subjectif, tandis que le droit a un caractère objectif.
Nous sommes donc bien obligé de devoir éclaircir les rapports entre le et la force. Que nous vivions dans des rapports de force veut-il dire que la force fait droit ? Le respect de la loi a-t-il surtout pour but d’assurer l’ordre social ?
* *
*
... : le droit n’est pas le fait. Un état de fait n’est pas un état de droit. Même si une majorité d’individus agissait en contradiction avec la loi, comme en violant les règles du code de la route, cela ne fera jamais droit. Le droit ne résulte pas d’un fait. Le droit exprime ce qui devrait être selon les lois en vigueur, tandis que le fait est ce qui existe en réalité, ce qui se pratique. Par exemple, ce n’est pas parce qu’un voleur est surpris de fait en possession de ma guitare qu’il en est légitimement (R) le propriétaire. La possession est un rapport physique qui fait que je m’approprie un objet, je l’ai en ma possession. La propriété est un rapport de droit, une possession reconnue aux yeux de la loi. Squatter une maison ne m’en rendra pas propriétaire. (texte)
Si l’ordre social, c’est l’état dans lequel la propriété de chacun est respectée, il est facile de se convaincre que le respect de la loi a surtout pour but de maintenir les choses en place. Cette analyse reste juste, tant qu’elle s’attache aux choses et aux biens qu’un homme a pu acquérir légitimement. Mais d’un autre côté, la propriété a un aspect historique, elle n'est pas tombée du ciel comme une bénédiction accordée à certains, pendant que d'autres recevaient en partage la misère. La propriété recouvre des situations d’inégalité flagrantes entre les hommes. Mais n'est ce pas justement par la violence, et des rapports de force qu'elle a été acquise? Il serait scandaleux de légitimer ...
Prenons la première propriété, la propriété de la terre. A qui revient elle? (texte) Ne revient-elle pas au premier qui s’en est emparée ? Mais s’emparer de la terre est un acte de la force. C'est un acte de force, même si le fait de la transmettre à des descendant est un acte de droit. Pensons aux conquêtes. Les colons qui s’emparaient d’un territoire plantaient le drapeau de leur pays. De cette manière ils marquaient que cette île, cette plaine, ces forêts étaient sous la juridiction de la Couronne d’Espagne, de France ou du Portugal.Ensuite, ils pouvaient tracer les limites d’un champ et se considérer comme propriétaires. Qu’importe si cela pouvait coûter la vie de milliers de « sauvages » installés là auparavant. N’est-ce d’abord un rapport de force inégal qui a instauré une répartition de la terre, rapport que le droit est venu sanctionner ensuite ? Si c'est le cas, pourquoi devrions-nous respecter la propriété ? Bien sûr, il est difficile de reprocher par exemple aux américains le droit qu’ils ont d’occuper leurs terre aujourd'hui. Pourtant ce droit a été payé cher ,dans des conquêtes dont les tribus amérindiennes ont fait les frais. Le temps finit par agir, la coutume inscrit une habitude, la religion pardonne : bref, il y a des facteurs de légitimation qui font oublier ce qu'ont pu être les origines, c'est à dire des rapport de force.
Cela pose un problème grave, car le principe que l’on en tire alors est qu’au fond le droit est toujours le droit du plus fort. Mais comment pourrions-nous alors respecter le droit, dans la mesure où les rapports de force créent des inégalités ? Ce sont les plus forts qui triomphent et les faibles qui s’inclinent ; devant ceux qui possèdent les biens de la terre, ce sont les plus faibles qui travaillent pour les plus riches. Nous devrions respecter un état de fait, parce qu’il est sanctionné par le ...
![]() Il faudrait admettre comme juste l’idée selon laquelle c’est la force qui fonde le droit. Que la loi sanctionne l’existence d’un rapport de force à l’intérieur de l’État., il serait irréaliste de le nier. Mais est-ce à dire que la volonté de puissance, comme le dit Nietzsche, confère aux hommes de proie une domination légitime sur les faibles ? L’
Il faudrait admettre comme juste l’idée selon laquelle c’est la force qui fonde le droit. Que la loi sanctionne l’existence d’un rapport de force à l’intérieur de l’État., il serait irréaliste de le nier. Mais est-ce à dire que la volonté de puissance, comme le dit Nietzsche, confère aux hommes de proie une domination légitime sur les faibles ? L’
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
... bien que le droit s’appuie sur la force pour se faire respecter, sans quoi il ne serait que proclamation en l’air. Pas de justice sans police pour la faire respecter. Cela implique aussi, pas de droit sans la garantie d’un pouvoir politique fort et stable. Si le pouvoir laissait, libre cours à la violence des égoïsmes particuliers, la cohésion sociale serait dissoute. L’État disparaîtrait et nous serions ramené à l’état de nature. Or l’état de nature, n’est il pas celui des rapport de forces ? Dans la nature, ce qui règne le plus souvent, n’est-ce pas "la loi du plus fort" ? C'est exactement cette revendication que soutient Calliclès. Dans la Nature, le gros poisson mange le petit. Le lion adulte au mieux de sa vitalité peut gouverner son troupeau de femelles, jusqu’aux jour où il est chassé par un plus jeune et doit s’exiler. Le plus fort est le maître. La loi de la nature, considérée de cette manière, c‘est la loi du plus fort.
Pourtant, la force ne se suffit jamais à elle-même. Elle a besoin du droit. Comme le dit Pascal, la force sans la justice est tyrannique, la justice sans la force est impuissante. (texte) Pour que le droit soit réellement respecté il faut qu’il soit reconnu. La reconnaissance ne vient jamais de la force. Même dans la société archaïque, l’homme le plus respecté, ce n’est pas le plus fort, c’est le sorcier, parce qu’il incarne le Sacré, la coutume, la tradition. Le droit coutumier ne repose pas sur la force. Il repose sur le respect des règles, sur les pratique traditionnelles. La hiérarchie sociale est fondée sur la coutume et le sacré beaucoup plus que sur la force.
--------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Questions
1. Ne peut-on pas dire que l’homme a projeté son propre « darwinisme social » sur la nature en parlant de « droit du plus fort » dans la nature ?
2. La différence entre révolution et révolte tient-elle à une conception différente du droit ?
3. Pourquoi Rousseau a-t-il pu écrire que le premier qui planta des piquets pour délimiter un champ fut le vrai fondateur de la société civile ?
4. L’idée de droit repose-t-elle nécessairement sur une conscience morale?
5. Comment peut-on distinguer entre exercice légal de la force et violence publique?
6.. Supposer que la nature promeut la vie est ainsi orientée vers le bien ne se justifie-t-il que d’un point de vue religieux ?
7. Pourquoi le relativisme culturel est-il insuffisant en matière d’exigence de droit ?
![]() © Philosophie et spiritualité, 2002, Serge Carfantan.
© Philosophie et spiritualité, 2002, Serge Carfantan.
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()