En
2008, Jean Ziegler, alors rapporteur de l’ONU, disait que si l’humanité
partageait décemment ses ressources
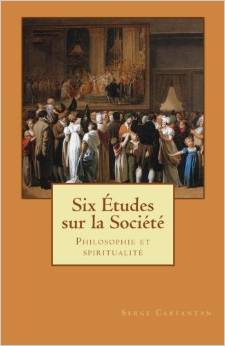 alimentaires, la Terre pourrait accueillir
sans problème 12 milliards d’habitants. Nous avons vu précédemment que le seul
changement de régime, depuis une nourriture carnée,
vers une nourriture végétarienne
permettrait d’atteindre ce résultat, tout en diminuant considérablement notre
empreinte écologique. Il ne s’agit pas ici de prétendre qu’une telle
accélération démographique est
souhaitable, mais de mettre en cause l’une des
croyances fausses que nous entretenons
au sujet de la faim dans le monde.
alimentaires, la Terre pourrait accueillir
sans problème 12 milliards d’habitants. Nous avons vu précédemment que le seul
changement de régime, depuis une nourriture carnée,
vers une nourriture végétarienne
permettrait d’atteindre ce résultat, tout en diminuant considérablement notre
empreinte écologique. Il ne s’agit pas ici de prétendre qu’une telle
accélération démographique est
souhaitable, mais de mettre en cause l’une des
croyances fausses que nous entretenons
au sujet de la faim dans le monde.
Bien sûr, nous avons entendu toutes sortes de justifications : c’est la faute du climat, à la fatalité des événements naturels, la faute de la crise économique, du manque de contrôle des naissances, de la corruption des pays pauvres, de l’accumulation de leur dette, de leur manque d’ouverture au marché, d’insuffisances en biotechnologies, des entraves à l’action de la FAO, du FMI etc.
Et si on retournait la causalité de quelques unes de ces raisons ? Et si la fatalité n’y était pour rien, mais que l’humanité avait inconsciemment programmé à travers ses croyances la situation de misère et de souffrance qui règne partout dans le monde ? La question de la faim ne relève-t-elle pas avant tout de la responsabilité politique ? Non, ne vaudrait-il pas mieux dire qu’elle tient à l’irresponsabilité politique ou encore de l’inconscience humaine ? Ne faudrait-il pas mettre au jour ce qui jusqu’à présent nous voile la réalité ? Si nous sommes capables de voir les choses telles qu’elles sont, nous pourrons nous entendre sur la gravité du problème, mais tant que nous n’examinons pas la doxa de la faim qui tourne en boucle dans les discours officiels, nous ne pourrons rien faire, car elle inculque une résignation collective qui barre la route à tout changement.
* *
*
Pour le consommateur occidental qui se rend régulièrement au supermarché, qui a l’habitude de fréquenter les galeries commerciales, les vendeurs de crêpes sur le front de mer, les petits restaurants, la faim n’a guère de signification. C’est un petit creux que l’on s’avise de combler avidement en avalant rapidement un peu tout et n’importe quoi. De manière plus subtile, c’est souvent une tendance créée par le mental pour combler un vide. Une pulsion de l’ego qui porte vers une compensation. Il en est tout autrement pour les SDF, les marginaux qui rodent dans les villes pour qui c’est une obsession constante. Ceux-là sont bien plus près de comprendre ce dont souffre des populations entières de par le monde.
1) « Le massacre quotidien de la faim se poursuit dans une normalité glacée. Toutes les 5 secondes, un enfant de moins de dix ans meurt de faim. Toutes les 4 minutes, quelqu'un devient aveugle par manque de vitamine A. En 2006, 854 millions de personnes - un homme sur six sur notre problème ont été gravement et en permanence sous-alimentés. Elles étaient 842 millions en 2005". (texte)
L’humanité nous fait sentir à quel point notre condition incarnée à travers la pression qu’exercent les besoins du corps. Nous avons vu l’importance que revêtent les sensations de la soif, de l’étouffement, de la faim. Tout être humain se doit d’honorer son corps et cela fait partie des prérogatives d’une société véritablement humaine que de veiller à ce que chacun puisse voir ses besoins élémentaires satisfaits. C’est une question de survie biologique. Nous l’avions dit, mais pour citer Jean Ziegler dans Destruction massive : « A de rares exceptions près, un homme peut vivre normalement trois minutes sans respirer, trois jours sans boire, trois semaines sans manger. Pas davantage. Commence alors la déchéance.
Chez les enfants sous-alimentés, l’agonie s’annonce beaucoup plus rapidement. Le corps épuise ses réserves en sucre, puis en graisse. Les enfants deviennent léthargiques. Ils perdent rapidement du poids. Leur système immunitaire s’effondre. Les diarrhées accélèrent l’agonie. Des parasites buccaux et des infections des voies respiratoires causes d’effroyables souffrances. Commence alors la destruction de la masse musculaire. Les enfants ne peuvent plus se tenir debout. Comme autant de petits animaux, ils se recroquevillent dans la poussière. Leurs bras pendent sans vie. Leurs visages ressemblent à ceux des vieillards. Enfin, vient la mort ».
Un adulte qui tombe en panne de voiture en plein Sahara, privé de nourriture quelques temps, peut être sauvé in extremis et retrouver aisément des conditions de vie normales. Il en va tout autrement d’un enfant pour un enfant de moins de cinq ans qui a été maintenu dans une sous-alimentation, les cellules du cerveau ne pourront avoir un développement normal et il gardera de graves séquelles. « Son destin est scellé. Il restera un crucifié de naissance, un mutilé mental à vie. ...
Dans un grand nombre de cas, la sous-alimentation provoque des maladies dites de la faim : le noma, le kwashiorkor, etc.».
2) « Noma vient du grec nomein, qui signifie dévorer. Son nom scientifique est le cancrum oris. C’est une forme de gangrène foudroyante qui se développe dans la bouche et ravage les tissus du visage. Sa cause première est la malnutrition.
Le noma dévore le visage des enfants souffrant de malnutrition principalement entre un et six ans.
Chaque être vivant a dans sa bouche des micro-organismes en grand nombre, constituant une charge élevée en bactéries. Chez les personnes bien nourries et entretenant une hygiène buccale élémentaire, ces bactéries sont combattues par les défenses immunitaires de l’organisme.
Quand une sous-alimentation ou une malnutrition prolongée affaiblit les défenses immunitaires, cette flore buccale devient incontrôlable, pathogène, brise les dernières défenses immunitaires ». La maladie suit alors trois stades, elle commence par une gingivite avec apparition d’aphtes. Détectée à ce stade, elle est facile à vaincre, il suffit de désinfecter la bouche et d’alimenter correctement l’enfant. Si ce stade est dépassé, un plaie sanglante se forme dans la bouche et la gingivite se transforme en nécrose accompagnée de fièvre. Mais, même à ce stade rien n’est encore perdu, on peut en venir à bout au moyen d’antibiotiques et d’une nourriture adéquate. Il suffit de 2 à 3 euros pour assurer un traitement de dix jours pour guérir un enfant. Mais si rien n’est fait, au troisième stade, « le noma devient invincible ». « D’abord le visage de l’enfant gonfle, puis la nécrose détruit graduellement tous les tissus mous.
Les lèvres, les joues disparaissent, des trous béants se creusent. Les yeux tombent, puisque l’os orbital est anéanti. La mâchoire est scellée.
Les rétractions cicatricielles déforment le visage.
La contracture des mâchoires empêche l’enfant d’ouvrir la bouche.
La mère alors casse les dents sur un côté pour pouvoir introduire dans la bouche de son enfant une soupe de mil… dans l’espoir vain que ce liquide grisâtre empêchera son enfant de mourir de faim ». « 50 % des enfants atteints meurent dans un délai de trois à cinq semaines ».
Quand le noma s’en prend à des sujets plus âgés, ils seront comme survivants condamnés au martyre, l’horreur qu’ils représentent fait qu’ils sont frappés de tabous, rejetés comme pour une punition, caché des voisins. Comme l’a dit un commentateur : « le noma agit comme une punition pour un crime que vous n’avez pas commis ».
Le noma fait des ravages en Afrique mais il « ne figure pas sur la liste de l’OMS » ! Ce n’est pas une maladie contagieuse. Résultat : l’absence de reconnaissance publique fait que l’on manque d’information scientifique. Or tant que l’OMS ne s’intéresse pas à cette maladie qui touche les plus pauvres, il n’y a pas de recherche approfondie à publier et en conséquence, aucune mobilisation internationale ne peut être entreprise. Cercle vicieux. Et le pire pour la fin : le noma n’intéresse pas non plus les trusts pharmaceutiques parce que les médicaments pour le traiter « sont peu coûteux, ensuite parce que les victimes sont insolvables ».
Nous ne pouvons pas argumenter en prétendant que cette maladie est récente ou spécifique à une région du monde. Ses symptômes sont connus depuis l’Antiquité. Son nom lui a été attribué en 1685 par Cornelius van der Voorde des Pays Bas. Tout au long du XVIIème les écrits sur cette maladie ont été nombreux et ils associent clairement le noma à l’enfance, la pauvreté et la malnutrition. « Jusqu’au XIX è siècle, le noma s’étend à toute l’Europe et à l’Afrique du Nord. Sa disparition de ces régions est essentiellement due à l’amélioration des conditions sociales des populations, au recul de l’extrême pauvreté et de la faim.
Mais le noma fait une réapparition massive dans les camps nazis entre 1933 et 1945, notamment dans ceux de Bergen-Belsen et d’Auschwitz. Chaque années 140 000 nouvelles victimes sont frappées par le noma… La proportion de personnes survivantes oscille autour de 10% ce qui signifie que plus de 120 000 personnes périssent de noma tous les ans ».
Le noma est une des manifestations des plus violentes de la tragédie de la faim sur cette planète. Il peut être éradiqué dans l’hémisphère Sur comme il l’a été dans l’hémisphère Nord et il le sera quand ses causes, la malnutrition et la sous-alimentation auront définitivement été balayés. Les remèdes existent. Les moyens existent. Les organisations capables de prise en charge existent. A moins d’être totalement désensibilisés (les fuites dans une possible inconscience ne manquent pas) (texte) personne ne peut supporter la confrontation avec cette réalité de la faim. Quelles que soient les différences culturelles, la souffrance humaine nous atteint directement. (texte) On ne peut pas finasser avec la tragédie de la faim, l’intelligence du réel impose une action immédiate.
-------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier____
Questions:
1. La démographie humaine rend-elle la question de la faim insoluble?
2. Dans quelle mesure les institutions fondée pour lutter contre la faim dans le monde peuvent-elles rester indépendante du pouvoir de l'argent?
3. Sur quels arguments se fonde l'idée d'une fatalité de la faim?
4. Avant de rencontre Malthus, Darwin n'était pas darwinien. Qu'en pensez-vous?
5. En quel sens la faim dans le monde n'est-elle qu'un problème d'argent plus que de ressources?
6. Attribuer un revenu minimum à tous les être humains sur terre pourrait-il aider à résoudre la question de la faim?
7. Peut-on légitimer l'utilisation de la terre pour produire des agrocarburants, tant qu'il y aura sur terre des hommes qui meurent de faim?
© Philosophie et spiritualité, 2011, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()