La philosophie contemporaine s’est beaucoup inspirée de la linguistique. Assez curieusement, parfois plus pour accepter certains de ses a priori que pour en reprendre et commenter les résultats. La
théorie de l’arbitraire du signe de
Saussure été reçue comme un dogme indiscutable.
(texte) Sans véritable interrogation
sur la relation du nom et de la forme. Mais, plus étrangement encore, c’est le caractère indissociable de la relation entre signifiant et signifié qui est devenu un dogme. L’intellectualisme que l’on rencontre chez Hegel est un modèle dont l’autorité est incontestée. Il admet qu’il ne saurait y avoir de pensée sans langage. Sans le langage, la pensée
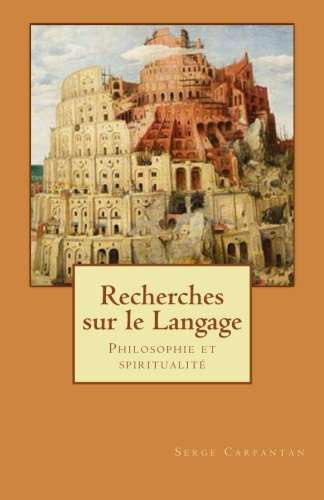 resterait dans un état de confusion complète et ne saurait être intelligente. On tire aussi facilement argument des piètres performances des chimpanzés et des gorilles pour soutenir qu’ils sont visiblement inaptes au raisonnement, parce qu’ils ne parviennent pas à acquérir le maniement de la syntaxe d’un langage conceptuel complexe. La cause est donc entendue, la pensée est inséparable du langage. De là on dérive communément vers la théorie du relativisme linguistique soutenant que, non seulement la pensée est enclose dans le langage, mais elle est aussi enfermée dans le système que constitue la langue.
resterait dans un état de confusion complète et ne saurait être intelligente. On tire aussi facilement argument des piètres performances des chimpanzés et des gorilles pour soutenir qu’ils sont visiblement inaptes au raisonnement, parce qu’ils ne parviennent pas à acquérir le maniement de la syntaxe d’un langage conceptuel complexe. La cause est donc entendue, la pensée est inséparable du langage. De là on dérive communément vers la théorie du relativisme linguistique soutenant que, non seulement la pensée est enclose dans le langage, mais elle est aussi enfermée dans le système que constitue la langue.
Pourtant le seul recours à l’observation nous montre qu’il existe un grand nombre de situations dans lesquelles la compréhension est possible indépendamment du langage. Une mère le sait très bien, dans la relation qu’elle entretient avec son enfant. Ce qui est assez nouveau sur cette question, c’est aussi la lumière que peut apporter l’étude de l’aphasie. Un malade atteint d’aphasie ne devient pour autant une brute, une souche dépourvue de toute pensée, même si l’usage du langage lui fait défaut.
Il est donc important de reprendre la question de la relation entre la pensée et le langage à nouveaux frais en s’interrogeant maintenant sur la nature de la pensée et de l’intelligence non verbale.
En quel sens sommes-nous en droit de parler de pensée non-verbale ?* *
*
Partons directement de témoignages sur l’aphasie. La définition de l’aphasie classique est d’être un trouble qui se traduit par une dissociation du signifiant et du signifié. Nous allons pour l’analyser suivre ici le remarquable travail de Dominique Laplane dans La Pensée d’outre-mot. Il existe plusieurs formes d’aphasie.
1) Dans l’une d’elle, l’aphasie migraineuse, le trouble est de courte durée et le sujet retrouve ensuite la possession de ses moyens d’expression.
a) Dominique Laplane cite le cas d’une de ses patientes. Cette femme de 58 ans souffrait depuis l’enfance de migraines ordinaires, donc de maux de tête associés aussi à des troubles comme des nausées. Ce jour là, elle part faire des courses dans une grande surface. Mais à un moment, elle se rend compte qu’elle ne parvient plus à lire la liste des commissions qu’elle avait faite. Elle a dit plus tard qu’elle entendait bien dans sa tête les mots : sel, huile, sucre etc. mais ils avaient perdu leur signification. Sentant qu’elle risque d’avoir encore une migraine, elle pense aussitôt qu’il lui faut d’urgence aller prendre de l’aspirine. Bien sûr, elle ne sait rien de l’aphasie et ne l’a jamais connue. Elle se rend donc à la cafétéria pour s’adresser à quelqu’un pour demander de l’eau... Impossible de parler, si ce n’est pour articuler « est-ce que ? Est-ce que ? ». L’hôtesse est attentive et compatit à ses difficultés. La dame comprend qu’elle est en train de lui dire « prenez donc votre temps Madame». Après plusieurs minutes, elle parvient à lui prononcer péniblement « à boire ». Elle obtient un verre de jus d’orange et le trouble disparaît au bout d’un quart d’heure. (texte)
cas précis, la patiente a été capable d’avoir un raisonnement très complexe : elle a porté un diagnostic et s’est prescrite un traitement. Ce qui est un exercice de pensée abstraite d’un niveau plutôt élevé. La question que pose alors Dominique Laplane est celle-ci : « quelle pouvait bien être, chez cette femme, la représentation intérieure de la migraine alors qu’elle n’avait aucune possibilité de représentation symbolique, au sens linguistique du terme, ni d’image analogique, puisque les sensations mises en causes étaient entièrement nouvelles ? ».
![]() ---------------b) Autre exemple, cette fois-ci sur une durée bien plus longue, le cas de Lordat. Il était professeur à la faculté de Montpellier et il avait publié des travaux sur l’aphasie (alalie dans son vocabulaire), entre 1820 et 1823. Il fut atteint d’aphasie lui-même en 1825, mais le trouble régressa suffisamment pour qu’il put reprendre son enseignement et il publia ses mémoires en 1843. Il assista donc en clinicien averti à son propre malheur. Evidemment, l’analyse qu’il en a donné ensuite est un document de premier ordre.
Or voici ce qu’il écrit :
---------------b) Autre exemple, cette fois-ci sur une durée bien plus longue, le cas de Lordat. Il était professeur à la faculté de Montpellier et il avait publié des travaux sur l’aphasie (alalie dans son vocabulaire), entre 1820 et 1823. Il fut atteint d’aphasie lui-même en 1825, mais le trouble régressa suffisamment pour qu’il put reprendre son enseignement et il publia ses mémoires en 1843. Il assista donc en clinicien averti à son propre malheur. Evidemment, l’analyse qu’il en a donné ensuite est un document de premier ordre.
Or voici ce qu’il écrit :
« Je m’aperçus qu’en voulant parler, je ne trouvais pas les expressions dont j’avais besoin… la pensée était toute prête, mais les sons qui devaient la confier à l’intermédiaire n’étaient plus à ma disposition. Je me retourne avec consternation et je dis en moi-même (sic) : il est donc vrai que je ne puis plus parler.
La difficulté s’accrut rapidement et, dans l’espace de 24 heures, je me trouvais privé de la valeur de presque tous les mots. S’il m’en restait quelques uns, ils me devenaient presque inutiles parce que je ne me souvenais plus de la manière dont il fallait les coordonner pour qu’ils expriment une pensée…
Lorsque je voulus jeter un coup d’œil sur le livre que je lisais quand la maladie m’avait atteint, je me vis dans l’impossibilité de lire le titre…
Ne croyez pas qu’il y eût le moindre changement dans les fonctions du sens intime, je me sentais le même intérieurement. L’isolement mental, la tristesse, l’embarras, l’air stupide qui en provenait faisaient croire à plusieurs qu’il existait en moi un affaiblissement des facultés intellectuelles… Quand j’étais seul, éveillé, je m’entretenais tacitement de mes occupations de la vie, de mes études. Je n’éprouvais aucune gène dans l’exercice de ma pensée… Dès qu’on venait me voir, je ressentais mon mal à l’impossibilité où je me trouvais de dire : Bonjour, comment vous portez-vous ? ».
Ce témoignage est particulièrement impressionnant, d’autant plus que Lordat décrit un trouble aphasique avec beaucoup de précision, à une époque où il n’était pas encore très étudié. Ce qu’il dit, il n’a pas pu le trouver dans des livres. Il parle de son expérience. Il insiste sur deux point, chez l'aphasique : a) le sens intime du soi, la présence à soi de la conscience sont intacts. b) L’intelligence est intacte. Il reprochera d'ailleurs par la suite vivement à ses prédécesseurs d’avoir assimilé à tort la privation de la parole avec la perte de l’intelligence, alors que ce n’est visiblement pas le cas dans l’aphasie. Ce qui veut donc dire : que le sens intime précède la pensée verbalisé et n’est pas constitué par elle. D’autre part, selon lui il existe une intelligence non-verbale dont la complexité demeure, l’esprit ayant l’aptitude à percevoir et à penser intuitivement en l’absence des mots. Et soyons bien clair à ce sujet, il ne s’agit pas seulement d’une sorte de « pensée immédiate » liée à la seule adaptation pratique, mais bel et bien d’une pensée abstraite et complexe.
2) Voilà de quoi scandaliser nos linguistes et philosophes dévotement acquis à l’intellectualisme. De fait, il existe bien chez certains sujets une « dissociation entre le signifiant et le signifié ». La perte du recours au signifiant langagier n’annihile pas l’aptitude à penser. La pensée continue d’entretenir son dialogue intérieur sur le plan du signifié. On voit mal, dans ces conditions, comment il serait possible de rendre compte de ce type de trouble sans admettre une indépendance de la pensée par rapport au langage. (texte)
Il est tout à fait possible de démontrer que l’aphasie n’est pas en soi un trouble de l’intelligence. L’aphasie est une chose, un trouble de l’intelligence en est une autre. Il existe des troubles de l’intelligence sans aphasie. On observe que des malades atteints de troubles graves de compréhension verbale ont pourtant des performances élevées aux tests non-verbaux. Laplane mentionne plusieurs cas intéressants. Un scientifique de haut niveau, observé par Newcombe ne pouvait pas avoir de performances verbales au-delà de celles d’un enfant de quatre ou cinq ans. Mais il était très au-dessus de la moyenne pour les performances non-verbales. Ou encore ce pharmacien observé par Lecours et Lhermitte atteint d’une sévère jargonophasie qui était un redoutable joueur d’échec.
« Il faut bien reconnaître que la perte de la faculté langagière laisse intacts beaucoup d’aspects de la vie mentale. La plupart des aphasiques sont capables de se comporter normalement dans l’existence courante, réagissent normalement aux divers événements de la vie. Leur affectivité est intacte. Ils n’ont pas perdu la capacité de saisir les situations concrètes ». On peut donc parfaitement être aphasique et intelligent ! (texte)
Et puisque nous sommes en train de jeter des pavés dans la mare de la linguistique, revenons avec Dominique Laplane sur la question des couleurs. C’est un des exemples favoris des partisans du relativisme linguistique. Il consiste à montrer que la discrimination des couleurs dans le spectre lumineux est déterminée par la langue de celui qui perçoit (l’exemple du Gallois et de la confusion entre certaines couleurs dissociées dans d’autres langues). Le langage serait donc censé commander la discrimination dans le réel. Or il existe des troubles appelés anomie des couleurs, assez instructifs à ce sujet. Le sujet est incapable de nommer les couleurs. Quand on lui pose une question à ce sujet, il répond n’importe quoi : un jaune désigné comme du bleu, un rouge comme du marron, etc. « Mais si au lieu de demander au sujet de dénommer des couleurs, on lui demande de mettre de la couleur sur un dessin en noir et blanc, il choisira le crayon convenable pour colorier correctement le ciel en bleu, l’herbe en vert, la paille en jaune etc. De même, réussira-t-il parfaitement un test de classement des fils colorés les uns par
L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
![]() © Philosophie et spiritualité,
2004, Serge Carfantan.
© Philosophie et spiritualité,
2004, Serge Carfantan.
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()