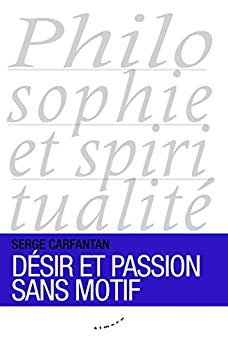 de quitter le terrain du sentiment. Ce qui différentie un ordinateur
d’un être humain, n’est-ce pas avant tout cela ? : la possibilité d’être affecté
par des sentiments.
de quitter le terrain du sentiment. Ce qui différentie un ordinateur
d’un être humain, n’est-ce pas avant tout cela ? : la possibilité d’être affecté
par des sentiments. Nous disons,
lors de l’annonce d’un décès avoir été affecté par la nouvelle. C’est au
niveau de l’affectivité que nous pouvons être touchés, car elle est le royaume
des sentiments. Être affectueux dans ses relations, c’est donner une
chaleur affective qui est celle de la proximité de cœur que donne
l’amour. Pour autant que chacun d’entre nous est un être sensible, il n’est pas
possible
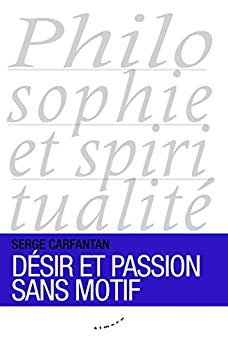 de quitter le terrain du sentiment. Ce qui différentie un ordinateur
d’un être humain, n’est-ce pas avant tout cela ? : la possibilité d’être affecté
par des sentiments.
de quitter le terrain du sentiment. Ce qui différentie un ordinateur
d’un être humain, n’est-ce pas avant tout cela ? : la possibilité d’être affecté
par des sentiments.
L’affectivité n’a cependant pas bonne presse dans la philosophie moderne, car son terrain n’est pas celui de la rationalité. Un sentiment, c’est très immédiat, ce n’est pas réfléchi. La force des sentiments n’est pas celle de la raison. Un sentiment n’est pas « clair » comme une idée claire et distincte en mathématique. Les élans du cœur ne sont pas déterminants à la manière des principes de la raison. L’affectivité a donc suscité la méfiance des rationalistes qui lui reprochent sa confusion. Avec Descartes et Galilée, la science moderne a instauré une méfiance à l’égard de la subjectivité et cette méfiance est bien entendue ...
Mais la vie n’est-elle pas par essence avant tout affective? Ne pas prendre en compte l’affectivité, c’est renier la Vie et la réduire à ce que l’intellect est à même de maîtriser dans des concepts. Que le sentiment soit souvent incontrôlable est une chose, qu’il ne faille pas en tenir compte en est une autre. Un philosophe contemporain de haute envergure, Michel Henry, s’est pourtant attaché, dans l’Essence de la Manifestation, à remettre l’affectivité au cœur de la philosophie. Michel Henry entend même pousser la phénoménologie de Husserl dans ses ultimes conséquences en devenant une phénoménologie de la Vie. Quelle rôle devons-nous reconnaître à l’affectivité ? Faut-il assimiler l’affectivité avec la réceptivité, la perception ou la sensibilité ? Affectivité et subjectivité, est-ce la même chose ? Doit-on, comme le fait Freud, ramener l’affectivité à l’inconscient et à la sexualité ? Enfin, y a-t-il ...
* *
*
Nous avons déjà partiellement répondu à ces questions, sans toutefois aborder directement l’affectivité. Nous avons vu que la subjectivité caractérise le fait qu’un vécu ne peut être éprouvé que par un seul sujet et que nul autre ne peut l’éprouver à sa place. La tristesse est mienne, comme la joie ou l’abattement. Par objectivité on désigne une représentation qui fait l’objet d’un consensus impliquant plusieurs sujets, comme la démarche d’une démonstration, d’une expérimentation ou simplement une constatation d’ordre scientifique. Le problème c’est qu’il y a dans la subjectivité de la sensation, tellement de variations possibles d’un individu à l’autre, que l’approche objective de la connaissance a cru nécessaire de la discréditer. Cependant, le reproche est excessif. Il risque de nous mener à cet extrême consistant à faire « comme si » on pouvait ériger une science sans tenir compte de la subjectivité. Or que la vie soit subjective, il est impossible de le nier et elle l’est parce qu’elle est fondamentalement affective. Que l’affectivité soit par principe fausse et doive être écartée est un a priori qui est dogmatique et ne procède d’aucun examen sérieux.
---------------1) Nous avons vu qu’une des caractéristiques essentielles du vécu est son immédiateté. A quoi nous avons ajouté deux remarques : le vécu est conscient, il se donne directement, sans intermédiaire, à la différence de ce qui est considéré comme inconscient. D’autre part, l’immédiateté renvoie directement à l’affectivité, car le propre du sentiment est de surgir en Soi-même dans les qualités que le cœur éprouve. Cependant, il serait bon, avec S. Prajnanpad, de distinguer entre l’émotionnel, avec son caractère confus et très réactif et le sentiment dans sa passivité primordiale et sa communication infinie.
a) Ce que nous appelons "amour" est souvent confondu avec une excitation émotionnelle ou un sentimentalisme romantique. C’est dans ce registre que se situe le pathos sur lequel agissent les manipulations médiatiques sur le plan collectif. L’émotionnel peut être provoqué de façon artificielle, par exemple sous l’effet de suggestion de peur, d’angoisse ou de sollicitations du désir. On ne saurait nier que les supporters d’un club de foot dans un stade éprouve des « sentiments » en un sens, mais c’est surtout l’émotionnel qui est sollicité et même sollicité à l’excès. Le téléspectateur qui, rivé devant un spectacle de téléréalité tremble, se met en colère, ricane, verse une larme, tout en continuant à manger du pop corn, est bien « là dedans ». Dans de l’émotionnel. Il ne va pas aller au-delà, il ne va pas de l’émotionnel à l’exercice de l’intelligence ; et puis ce n’est pas pour cela que l’émission est faite. Ce qui compte, c’est le choc des affects, ce choc qui permet de vivre dans l’extase d’une vie qui n’est pas la mienne, mais celle de ces personnages qui sont dans la lucarne colorée. Une princesse lors de son mariage. Un milliardaire qui vous fait visiter son palace. Des petites gens qui vous racontent le suicide du petit frère à la suite de sa galère pour trouver un emploi. Une bonne dame qui s’est converti à la musique des jeunes et leur fait un clin d’œil. Mais c’est aussi tout le spectaculaire de l’information quand, scotché à l’écran, des millions de téléspectateurs regardent les bombes qui explosent lors d’un conflit lointain. Les avions qui s’écrasent sur les tours du World Trade Center. Ou encore l’enquête fort intéressante sur la nouvelle sexualité des français. Le record du monde du lancer d’espadrille et les prodiges de ce type qui mange des circuits d’ordinateur réduits en poudre. Et puis, il y a toutes les publicités comme s’il en pleuvait, cinq ou six coupures dans le même film etc. La course à l’audimat, on le sait, opère une terrible sélection entre ce qui est considéré comme « important » et ce qui est « secondaire ». Or la mesure en est d’abord et avant tout dans le choc émotionnel. L’usage de la négativité est pour cela privilégié. Pour rendre émotionnel un événement neutre, anodin, voire réjouissant, il faut lui rajouter une bonne dose de pathos outrancier. De même, les débats ont tendance à s’organiser sous la forme de joutes,
b) L’émotionnel, peut aussi être étroitement lié au passif inconscient du sujet, c'est-à-dire aux traces de son expérience passée. C’est ce domaine qui a été finement examiné par Swami Prajnanpad. Toute expérience se déroule dans le présent, mais peut être vécue de manière complète ou incomplète. Une expérience incomplète est une expérience vécue dans un état de non-acceptation, de refus, dans une tension. Elle laisse invariablement une trace dans la mémoire, un peu comme un trait profond dans de la pierre. Une expérience complète est une expérience vécue dans l’acceptation lucide. Dans le oui à la vie l’expérience ne laisse pas de trace, mais demeure cependant dans la mémoire. On dit alors qu’elle est comme un trait dans l’eau qui retrouve ensuite sa forme. Les résidus de l’expérience passée sont appelés les imprégnations mentales, les vasanas. Ceux-ci s’agglomèrent dans la mémoire et composent les tendances individuelles appelées samskaras. La compréhension de la nature des samskaras est le pendant indien du concept occidental d’inconscient. Il est dans la nature des imprégnations mentales d’émettre des conditionnements, un peu comme des bulles qui remonteraient du fond d’une eau trouble vers la surface. Du subconscient vers le conscient. Les samskaras sont extrêmement puissants. Ils orientent largement les désirs du sujet et influent sur ses choix, et cela d’autant plus qu’ils ne sont pas remarqués en tant que tels. Ils induisent des situations répétitives dans lesquels le sujet se trouve invariablement confrontés aux mêmes problèmes irrésolus. Quand, dans l’expérience de la veille, le sujet se trouve dans une situation qui entre en résonance avec les imprégnations mentales, il s’ensuit une remontée émotionnelle du passé portant la même couleur, la même charge affective que dans l’expérience initiale. La réponse que le sujet adopte alors consiste invariablement à reproduire un modèle de comportement ancien, à savoir la première réponse qui a été adoptée. Le mental suit une compulsion. La conscience qui dit « moi » est le résultat de cette association de l’esprit à une expérience duelle. L’ego perpétue du passé, et il ne peut rencontrer le présent. La conscience de l’ego transporte en fait de la peur. « A la racine de toute espèce de vikâra (émotion), se trouve le « moi ». Etant confiné à l’intérieur des limites de mon corps, tout ce qui se trouve à l’extérieur, je le considère comme étranger : vous, lui, ceci, cela. La peur, qui prend possession de moi, que tout ce qui m’est étranger et qui est toujours présent va m’attaquer ou immanquablement me créer des difficultés ». (texte) Il faut bien comprendre que l’émotionnel qui surgit du passé est entièrement dans une réaction. Sous l’empire de l’émotion, le mental est subjugué. Il ne voit pas les choses telles qu’elles sont, mais telles qu’il craint de les voir, ou tel qu’il voudrait les voir. Ainsi se produit une projection d’illusion. C’est pour cette raison que l’on dit que les émotions nous aveuglent. En fait elles déstabilisent l’intellect. L’émotion me met « hors de moi », comme dans la colère. Parce que l’émotion est une répétition du passé, elle produit une vision faussée, une vision qui est colorée. Le sujet s’identifie à ce que l’émotion suggère et il lui faut retrouver son calme et voir les choses de manière plus sereine pour enfin avouer qu’il a perdu toute contenance. S. Prajnanpad enseignait qu’il est important de comprendre ce processus et de savoir couler avec les émotions sans être emportées par elles. Les vivre en pleine lucidité permet de voir de mieux en mieux d’où elles remontent et dans ce processus, la racine est dégagée. C’est ainsi que l’on peut devenir libre de son passé. Tout travail sur soi rencontre à un moment les formations subconscientes. Mieux, dans l’optique de Krishnamurti, il est essentiel de les rencontrer à chaque instant ...
De là suit que à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
© Philosophie et spiritualité, 2006, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()