Le mot passion possède une charge affective exceptionnelle. C'est le premier mot qui nous vient à l'esprit pour justifier nos raisons de vivre : ce dont on a besoin c'est d'une passion de quelque chose qui nous motive, qui nous tire en avant, qui nous pousse à l'action. Sans passion on s'ennuierait. Les passions sont là au moins pour nous donner une "occupation". Aussi confondons-nous "passion" et "divertissement" : la passion c'est : aller au cinéma, faire de la danse, c'est aussi tomber amoureux, avoir envie d'aventure etc.
Ce qui est curieux, c'est que le mot passion indique autre chose. Dans passion, il y a passivité. Cela suggère que là où il y a action il y a aussi passion. Mais passivité à l’égard de quoi ? Pourquoi voir une passivité dans la passion alors que nous pensons communément exactement le contraire ? Pour nous autres postmodernes, la passion, c’est l’action, c’est la vie. (C’est marqué sur toutes les publicités ! ) L’élément de passivité échappe à l’appréhension commune. Nous voyons dans la passion « ce qui pousse à agir », ce qui « donne des raisons d’agir ». Il ne nous vient pas à l’esprit que la passion est aussi un subir et un souffrir.
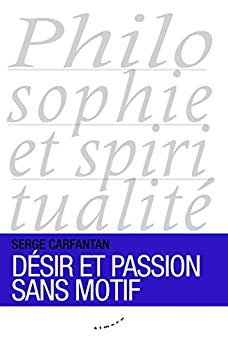
* *
*
Partons de l’intention qui traverse la passion. Si toute conscience est conscience-de-quelque-chose, la passion est intentionnelle, et doit se définir par rapport à un objet. C’est ce que nous admettons quand nous parlons de « passion de quelque chose ». La passion, c’est la passion de ceci ou de cela : des jeux vidéo, des plantes carnivores, du jardinage, du tennis etc. Cela signifie que nous nous représentons la passion à l’intérieur de la dualité sujet/objet et que nous la situons avant tout dans l’objet. La passion a pour thématique l'objet qui la désigne : la natation, le golf, les échecs, la programmation etc. C’est encore cette représentation de la passion que nous trouvons dans une forme d’occupation ou de divertissement. La passion doit avoir un objet et elle est cet objet. Mais cet objet doit surtout être un désir. J’ai le désir du jeu et ce désir est son thème, devenu exclusif, le désir du jeu devient la passion du jeu. J’ai le désir de l’argent et il devient la passion de l’argent de l’avare, j’ai le désir de cette femme et il devient passion amoureuse, j’ai le désir du risque et ce désir devient la passion du risque de l’aventurier, j’ai le désir du pouvoir et ce désir obsessionnel devient passion du pouvoir chez le politique etc.
---------------1) Il semble donc que l’on peut poser autant de passions qu’il y a de désirs, puisque le désir semble donner à la passion son objet, comme la fin qu’il poursuit. Il peut en effet y avoir un désir sans passion, mais il ne saurait y avoir de passion sans désir, car la passion de quelque chose est précisément ce désir langoureux, longtemps poursuivi, secrètement recherché. C’est la tension extrême du désir, c’est le caractère exclusif du désir qui fait la passion. (texte)
Notons bien : La passion est une exigence qui refuse tout compromis. Telle que nous la comprenons dans le cadre de l’intentionnalité, cette exigence se modèle dans une forme, son objet se limite d’ordinaire à l’accomplissement d’un désir. Comme les désirs sont multiples, on dit alors « les passions ».
Nous voyons déjà une conséquence : il est très réducteur d’interpréter le singulier « la » passion comme désignant la « passion amoureuse ». Notre sensibilité romantique y trouve certes satisfaction, mais nous sommes bien forcés de reconnaître qu’il y a bien d’autres passions toutes aussi fortes, éblouissantes, aussi ravageuses que celle de l’amour. D’autre part, nous ne prenons pas garde à ce que le mot passion indique quand il est pris au singulier, il ne veut pas seulement dire telle ou telle passion. La passion est un état de conscience bien particulier, un état de tension de l’âme qui se retrouve dans les différentes passions. C’est ce vécu de conscience qu’il faut cerner. Que se passe-t-il dans la passion ? Je me sens comme emporté dans une direction, celle de mon désir le plus cher.
1) Considérons le jeu. Voyez Dostoïevski Le Joueur. Le plaisir du jeu est somme toute une inclination qui semble naturelle, une tendance qui peut rester comme extérieure à moi. Le jeu est un rapport que nous entretenons spontanément avec la vie quand elle est libre. Mais c’est tout à fait autre chose quand ce plaisir devient le centre de ma vie, quand le désir du jeu est si violent qu’il réduit à néant toutes les autres inclinations. Il y a ce désir, il m’obsède, j’y pense sans cesse et je vis dans l’attente de ce moment d’excitation où je me trouve devant la table de baccara, devant la roulette, devant une table de poker. La passion de a ici sa thématique propre : le jeu. Ce désir me possède, je ne vis plus que par lui, je vis dans le souvenir des émotions éprouvées dans cette salle de jeu, je vis dans l’attente d’y retourner pour retrouver cette jouissance extrême qui est devenu mon absolu, ma divinité de joueur. Ce n’est plus un plaisir, c’est une sorte de transe. Je ne suis plus un homme quelconque, qui trouve parfois plaisir à jouer, je suis devenu un passionné du jeu Je suis dans un tel état que ce désir m’impose un manque, me met dans une véritable accoutumance.
Ce n’est pas pour rien que l’on fait des cures de désintoxication pour les joueurs. Dans la passion, je sais ce que représente le manque du désir. Le plus terrible, c’est que, lorsque je suis dans la passion, je ne peux pas lutter contre car la passion, c’est moi-même, je suis devenu cette passion, elle ne peut pas se détacher de moi. Je me suis identifié à la passion. Ce dont je souffre dans la passion, c’est de moi-même et de rien qui soit « autre ». Comme le dit Alain, la passion, c’est moi et c’est plus fort que moi. La passion, le plus souvent, suit son cours propre, elle me donne sa propre direction, le destin du joueur, le destin d’un passionné. Il y a une sorte de logique qui emporte le sujet passionné. Aussi, dans la passion, j’ai tendance à oublier tout le reste. Mon univers se dépeuple de toute autre présence que celle de l’objet de ma passion. Comme joueur, je vais dépenser l’argent du foyer ou réduire mes enfants à la misère et à une humiliation quotidienne ;
... lucide, je suis aveuglé, fasciné, obnubilé par l’objet de ma passion, le jeu. Il faut que les situations d’expérience de la vie me frappent pour que je m’éveille de cette fascination. Ce n’est qu’à ce moment là que je pourrai me rendre compte de tout ce temps perdu, de cette vie perdue, de ce désert créé autour de moi, de la petitesse de mon existence. Dans la passion, je m’étais enfermé dans mon petit monde, je vivais dans le refus de la réalité, je cherchais à m’isoler du monde pour jouir en solitaire dans un refuge de plaisir. Ma passion n'était qu'une manière de fuir la réalité en m'enfermant dans une bulle d'auto-satisfaction.
2) Considérons un autre exemple, l’amour-passion. Le sentiment de l’amour est naturel, c’est un élan du cœur qui est là ou bien n’est pas là, sans que cela pose une quelconque difficulté. L’inclination amoureuse reste extérieure à moi. Mais qu’advient il dans la passion ? Il y a ce visage et l’éblouissement qui a suivi, le coup de foudre qui m'a traversé, le trouble est venu et avec lui un désir lancinant, celui d’avoir cette femme toute pour moi, de la posséder. La pensée de cet objet du désir prend barre sur moi et je ne peux plus la chasser. Je suis « tombé » amoureux, ce n’est plus une inclination délicate du cœur, c’est une passion. Une belle page de Rousseau dans les Confessions donne une bonne description de cet état qu’est la passion amoureuse.
« Et qu’on n'aille pas s’imaginer ici que mes sens me laissaient tranquilles, comme auprès de Thérèse et de maman. Je l’ai déjà dit, c’était de l’amour cette fois et l’amour dans toute son énergie et dans toutes ses fureurs. Je ne décrirai ni les agitations, ni les frémissements, ni les palpitations, ni les mouvements convulsifs que j’éprouvais continuellement ».
Dès le début du texte, la passion se présente dans sa thématique propre en tant que passion-de-quelque-chose, ici l’amour. Mais ce n’est pas simplement l’amour comme sentiment, c’est l’amour avec l’énergie et la fureur. Cela veut dire une certaine puissance, mais sous un jour particulier, puisqu’il y a ambivalence. La passion un aspect positif capable de créer, "énergie", il y a aussi un aspect négatif capable de détruire, la "fureur". Il y a passion-de, et pas seulement sentiment, parce que la dualité est présente et que l’on peut passer très facilement d’un contraire à l’autre : amour/haine. Celui ou celle que l’on a aimé passionnément, on pourra tout aussi bien le haïr passionnément. La passion est décrite ensuite comme une sorte de catalyseur des émotions, tant et si bien que le passionné, non seulement ressent tout ce qui touche à sa passion de manière plus intense, mais il est perd aisément le contrôle de lui-même. La passion fait de nous un écorché vif, elle nous donne une émotivité au-delà de toute mesure. Elle exacerbe nos réactions. Et c'est d’autant plus étrange que la cause n’est pas réelle, elle est surtout fantasmée, imaginée :
« On en pourra juger par le seul effet que sa seule image faisait sur moi....Je rêvais en marchant à celle que j’allais voir, à l’accueil caressant qu’elle me ferait ».
L’amour passion se nourrit d’images, il fantasme son objet, si bien qu’il doit le plus souvent lutter contre la réalité pour y demeurer. Non seulement il déclenche des émotions vives qui font parfois perdre contrôle, mais il tend à faire en sorte que le mirage émotionnel ait une continuité, une durée. A cet égard, il y a loin de l’émotion à la passion. Une émotion passe, comme le dit Kant, c’est comme une eau qui rompt une digue. On reprend contrôle peut après, quand on « retrouve tous ses esprits ». Mais dans la passion, c’est différent, la passion s’inscrit dans le temps, elle a son projet qui est l’accomplissement d’un désir et elle ne peut s’éteindre qu’avec le désir. Le passionné peut avoir des moments de semi-lucidité, il peut voir un bref instant dans quel état la passion l’a jeté, mais la force du désir est si grande dans la passion, qu’elle a tracé un sillon que la conscience n’a plus qu’à suivre. (texte)
--------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Questions:
1. Définir la passion par son objet est très superficiel, pourquoi?
2. Comment pourrait-on classer les passions?
3. Pourquoi dit-on que la passion nous aveugle?
4. Comment retracer la genèse et le développement de l'illusion passionnelle?
5. Passion et sentiment peuvent-ils réellement se distinguer?
6. La lucidité implique-t-elle nécessairement une froideur glacée des sentiments?
7. Comment se fait-il que le mot compassion contiennent en lui le terme passion?
![]() © Philosophie et spiritualité, 2002, Serge Carfantan.
© Philosophie et spiritualité, 2002, Serge Carfantan.
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()