Dans La Nausée, Sartre, présentant l’expérience de l’absurde, dit de la racine de marronnier qu’elle se présentait comme une masse monstrueuse et molle « qui me faisait peur ».
Est-ce à dire que c’est l’existence face à moi qui est cause de la peur ? Ai-je peur en raison de ce
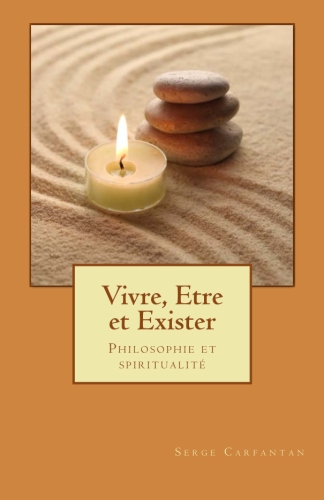 qui existe ou en raison de la situation de face à face, de dualité devant ce qui existe ? Est-ce la brutalité massive de l’existence des choses en-soi qui me fait peur, où est-ce l’affrontement permanent de ma relation au monde des objets ? De la relation avec autrui ? La peur est-elle un sentiment qui jaillit à la suite d’une première chute fondamentale, celle de la déréliction de la conscience dans le monde des objets ?
qui existe ou en raison de la situation de face à face, de dualité devant ce qui existe ? Est-ce la brutalité massive de l’existence des choses en-soi qui me fait peur, où est-ce l’affrontement permanent de ma relation au monde des objets ? De la relation avec autrui ? La peur est-elle un sentiment qui jaillit à la suite d’une première chute fondamentale, celle de la déréliction de la conscience dans le monde des objets ?
Nous ne pouvons pas faire l’impasse sur le problème de la peur, car il semble bien que tout être humain vit avec un sentiment d’effroi permanent. Pascal dit dans Les Pensées que le plus grand philosophe du monde, s’il est placé sur une planche au-dessus du vide, ne pourra avoir recours à de belles théories. Il devra affronter la peur. Et la peur a des conséquences immenses quant à la relation que nous entretenons avec la vie. Toute la question est cependant de savoir sous quelle forme la peur peut être acceptée, reconnue et surmontée ; dans quelle mesure nous pouvons vivre sans la peur. Quelle relation la peur entretient-elle avec notre appréhension de l’existence?
* *
*
Nous vivons une époque qui entretient une étrange ambiguïté autour de la peur. Nous savons bien, en toute rationalité, qu’il n’est pas souhaitable que l’homme vive dans la peur, mais quand nous voyons dans l’actualité des commandos suicide se faire sauter avec une bombe dans un marché, nous avons tendance à justifier la valeur de la peur : « Ces gens là, ils n’ont peur de rien, pas même de mourir, s’ils n’étaient pas fanatisés jusqu’aux oreilles, ils auraient peur et ils ne commettraient pas des actes pareils » ! Le sous-entendu est qu’il est ... e, très libre… trop libre. Incontrôlable. (texte)
1) C’est un discours qui est assez présent dans l’histoire des religions. Que l’homme vive dans la crainte de Dieu. Qu’il craigne le Jugement et se conduise droitement. Dans le Gorgias de Platon, Socrate tente longuement de faire entendre à Calliclès qu’il vaut mieux mener une vie tempérante et intègre que de prendre le parti de l’intempérance et de l’immoralisme. Calliclès s’en contrefiche éperdument. Il ne veut pas entendre la voix de la raison. Alors, à bout d’argument, Socrate tire sa dernière cartouche et emploie un langage religieux et lui tient un discours menaçant sur la sanction des âmes après la mort. Il lui met devant les yeux la peur de l’enfer, l’Hadès. La figure de l’enfer est en effet l’image de la sanction des fautes. Le châtiment est nécessaire pour qui s’est éloigné du juste pour choisir les voies tortueuses du mal. Il distingue les âmes qui peuvent être corrigées par un juste châtiment, des âmes qui sont incurables, tant elles sont défigurées par le vice et pour celles-là l’image est terrible :
![]() --------------- « Quant à ceux qui ont commis les derniers forfaits et sont devenus incurables, ce sont eux qui servent d’exemple. Eux-mêmes ne tirent aucun profit de leurs souffrances, puisqu’ils sont incurables ; mais d’autres profitent de les voir éternellement souffrir, à cause de leurs fautes, les plus grands, les plus douloureux supplices, et, suspendus comme de vrais épouvantails, dans la prison de l’Hadès, servir de spectacle et d’avertissement à chaque nouveau coupable qui arrive en ces lieux ».
--------------- « Quant à ceux qui ont commis les derniers forfaits et sont devenus incurables, ce sont eux qui servent d’exemple. Eux-mêmes ne tirent aucun profit de leurs souffrances, puisqu’ils sont incurables ; mais d’autres profitent de les voir éternellement souffrir, à cause de leurs fautes, les plus grands, les plus douloureux supplices, et, suspendus comme de vrais épouvantails, dans la prison de l’Hadès, servir de spectacle et d’avertissement à chaque nouveau coupable qui arrive en ces lieux ».
Platon parle d’image exemplaire et son propos est surtout de penser aux moyens de redresser l’âme. D’autre part, les grecs admettaient aussi la renaissance, de sorte que l’éternité des supplices de l’enfer n’a pas ici la portée aussi terrifiante que la damnation et les peines infernales dans le christianisme. Et on comprend très bien que ce genre d’épouvantail ait pu avoir, aux siècles de règne sans partage de l’Eglise, un ascendant sur les consciences. Mais un homme qui vit dans la crainte de Dieu hésitera à faire du mal. Sartre reprend Dostoïevski disant : « ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est d’ailleurs une justification que donne Spinoza de la religion : Pour ceux qui sont incapables de faire le bien par eux-mêmes, pour le bien lui-même et non pour une récompense, pour ceux qui ne peuvent comprendre par la raison seule la nature de Dieu, il reste la religion, qui, au moins, incitera le plus grand nombre à faire le bien, par peur de la sanction. L’image d’un Dieu terrible, vengeur et menaçant a cet avantage qu’elle impressionne l’homme le plus simple et qu’elle incite l’homme le plus mauvais à changer d’attitude, pour chercher refuge dans la foi dans l’espoir d’être sauvé de ses fautes. Certes, explique Spinoza, dans le Traité théologico-politique, il vaut mieux persévérer dans le bien pour le bien lui-même, et non par peur d’être p...
2) Maintenir les hommes dans la peur, c’est les maintenir sous un grand pouvoir. Le pouvoir suprême ici-bas est le pouvoir politique. Il n’est donc pas étonnant que les techniciens du pouvoir aient cherché à justifier l’usage de la peur. Une pratique machiavélique de la politique n’a aucun mal à justifier la valeur et l’emploi de la peur. Tous les rhéteurs savent que la peur est une arme de persuasion très efficace et qu’il est habile de savoir passer dans le discours de la peur à la flatterie. C’est là un usage de la parole nécessaire à qui veut assurer la suprématie de son pouvoir. Machiavel enseigne que le Prince doit être craint, mais cependant ne pas être haï. S’il est haï, il retourne le peuple contre lui, s'il est seulement craint, il maintient son autorité et son pouvoir. Aussi est-il de ce point de vue de bonne politique de maintenir la peur, sans pour autant qu’elle se transforme en haine. Un peuple maintenu dans la peur reste « tranquille ». Il n’ose pas se dresser contre le pouvoir. Un peuple qui se met à haïr son souverain cherchera à le renverser et il suivra ceux qui le conduiront à la révolte. Tous les tyrans que l’humanité a pu engendrer le savaient. Il existe une habileté calculée, rusée, machiavélique à manipuler l’insécurité et utiliser la peur. Machiavel dans Le prince, cependant n’en fait pas un système, pour lui c’est surtout une question d’opportunisme politique, de tactique. Il est en tout préférable d’user de la loi que de se servir de la force, car user de la loi est humain, tandis que l’usage de la force relève de la bête. L’usage violent de la peur comme moyen du pouvoir ne peut constituer une règle et ne se justifie que dans des circonstances chaotiques de l’Histoire, circonstances dans lesquelles le Prince doit rétablir l’ordre public, par exemple au milieu du chaos d’une guerre civile. (texte)
3) Il y a dans l’histoire de la pensée politique des systèmes qui ont été encore plus radicaux que le pragmatisme de Machiavel pour tenter de rationaliser l’usage de la peur, pour penser la nécessité de l’État à partir de cette émotion primitive. C’est exactement ce que fait Hobbes dans Le léviathan.
Dans sa généalogie des passions humaines, Hobbes montre que « l’aversion, jointe à l’opinion d’un dommage causé par l’objet est appelée crainte ». Cette définition, à partir de la notion de dommage causé, reste insuffisante, tant que n’a pas été précisé le contexte humain dans lequel l’homme est amené à subir un dommage de l’autre homme. Elle est aussi insuffisante tant que la relation de la crainte avec le temps n’a pas été précisée. Or on apprend plus loin dans le texte que la cause de la religion n’est rien moins que l’anxiété de l’avenir entretenue par l’ignorance. La « crainte perpétuelle qui accompagne sans cesse l’humanité plongée dans l’ignorance… doit nécessairement prendre quelque chose pour objet ». Donner un objet à la crainte, revient à en situer l'origine dans un pouvoir invisible. « Les dieux ont d’abord été créés par la crainte humaine ». Mais le point le plus important, c’est celui qui est développé par Hobbes au chapitre XIII quant au statut de l’égalité naturelle des hommes. Les hommes sont égaux par nature, mais Hobbes interprète cette égalité d’une étrange manière : « pour ce qui est de la force corporelle, l’homme le plus faible en a assez pour tuer l’homme le plus fort, soit par une machination secrète, soit en s’alliant à d’autres qui courent le même danger que lui ». Ils sont égaux de par leur capacité de nuire, de sorte que la compagnie d’autrui est avant tout en puissance insécurité. La relation d’homme à homme est une hostilité première. Ce postulat implique donc que nécessairement, soit constitué un pouvoir qui les tienne en respect. « Les hommes ne retirent pas d’agrément (mais au contraire un grand déplaisir) de la vie en compagnie, là où n’existe pas de pouvoir capable de les tenir en respect ». S’il existe une insécurité première cependant, c’est surtout en raison de la puissance prédatrice du désir et de son corollaire, le désir de reconnaissance. « Chacun estime que son compagnon l’estime aussi haut qu’il s’apprécie lui-même, et à chaque signe de dédain, ou de mésestime, il s’efforce naturellement, dans la mesure où il l’ose… d’arracher la reconnaissance d’une valeur plus haute ». Ce qui conduit les hommes à l’affrontement n’est rien d’autre que le résultat d’une exigence et d’une attente à l’égard de l’autre et conformément à une image de soi « De la sorte, nous pouvons trouver dans la nature humaine trois causes------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------Si on appelle état de nature, cette condition première des hommes entre eux, antérieurement à la constitution d’un pouvoir politique, il est logique de penser que l’état de nature est en fait un état de guerre de chacun contre chacun : « il apparaît clairement par là qu’aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tienne tous en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre et cette guerre est la guerre de chacun contre chacun ». Non pas que la guerre soit en pareil cas un conflit armé, un combat effectif, mais elle est une « disposition avérée » à la violence, et cette disposition persiste, « aussi longtemps qu’il n’y a pas d’assurance du contraire. Tout autre temps se nomme paix ». La fonction de l’état social est donc de remédier à cet état désastreux, de faire en sorte que, de cet homme qui est un loup pour l’homme dans l’état de nature, on puisse par la contrainte civile, faire un dieu pour l’homme dans l’état social. Dans l’état de nature, il ne saurait y avoir une de forme de maîtrise de la Nature, de commerce, de technique ou de culture : « Dans un tel état, il n’y a pas de place pour une activité industrieuse, parce que le fruit n’en n’est pas assuré : et conséquemment il ne s’y trouve ni agriculture, ni navigation, ni usage des richesses qui peuvent être importées par la mer ; pas de constructions commodes ; pas d’appareil capable de mouvoir et d’enlever les choses qui pour se faire exigent beaucoup de force ; pas de connaissance de la face de la terre, pas de computation du temps, pas d’arts, pas de lettres, pas de société », mais, « ce qui est le pire de tout, la crainte et le risque continuel d’une mort violente ; la vie de l’homme est alors solitaire, besogneuse, pénible, quasi-animale et brève ».
Si nous admettons ces prémisses, la conséquence est alors implacable, car si l’état de nature est violent, et justifie donc la peur que l’homme doit nous inspirer, nous devons tout attendre du pouvoir et rien de l’individu. L’aptitude de l’État à juguler la violence et à restaurer une confiance commune, mesure sa valeur. Ce que les hommes ne peuvent pas trouver par eux-mêmes, le système l’instaurera pour eux. Au système politique d’assurer la sécurité et de r...
Hobbes ne se demande jamais si ce qu’il dénomme « état de nature » n’est pas à tout prendre qu’un fait social auquel justement le système politique contribue directement. Au fond, il regarde l’homme naturel comme un parfait bourgeois ambitieux, plein de morgue et de suffisance et en même temps terrorisé du péril qu’il y a à vivre au milieu des autres hommes. Prêt à sortir son couteau, son fusil pour se défendre; admettant même que la défense suppose la nécessité d’attaquer. Hobbes, dira Montesquieu, suppose « les hommes comme tombés du Ciel ou sortis tout armés de la Terre, à peu près comme les soldats de Cadmus, pour s’entredétruire ». Mais cet homme tout armé, prêt à détruire son semblable, cet homme qui a peur et qui fait peur, cet homme qui s’est enrôlé dans une armée qui lui donne une cause et des raisons de se battre, n’est-il pas justement avant tout une créature politique et non pas la créature naturelle ? Un patriote qui défend sa nation. Un citoyen qui, comme soldat, défend son État. Un individu qui défend sa place dans la société. Un travailleur qui défend son métier, sa considération, son salaire et son outil de travail. Un consommateur qui défend son pouvoir d’achat. Comment demander au système politique d’assurer la sécurité, alors que précisément c’est lui qui exacerbe le conflit, l’émulation, la compétition, l’ambition, la lutte pour le pouvoir, qui engendre les formes les plus communes de la peur ?
Après tout qu’est-ce qu’une dictature ? Une dictature est précisément une manière d’user du pouvoir politique en se servant de la peur pour juguler toute tentative de révolte. On peut même maintenir les hommes dans un régime de la terreur des dizaines d’années durant, et dire avec fierté que la nation est « pacifiée » ! Et ce n’est pas tout, qu’est-ce en effet qu’un régime totalitaire ? Un régime ou non seulement la pratique du pouvoir suppose l’usage de la peur, mais où la représentation politique de l’État en tant que structure nécessaire enveloppe aussi l’empire de la peur. L’État achevé, l’état total, devient aisément l’État totalitaire, il devient un monstre. Un Léviathan. Il suffit pour cela qu’il suive un modèle idéologique dans lequel l’individu est sacrifié au dépend de l’abstraction que constitue le « tout », le « parti ». Dans 1984¸Georges Orwell imaginait un monde de ce genre, complètement « pacifié » idéologiquement de toutes différences. Un monde de l'uniformité, un monde où l'unité est remplacée par l'uniformité. Un monde qui était pacifié par la peur, un monde où la « police de la pensée » traquait jusqu’aux expressions des visages pour emprisonner et « effacer » les déviants, comme les effacer de la mémoire historique. Dans ce monde l’emprise de la peur est tentaculaire. Les caméras de surveillance sont partout, tous les gestes sont épiés, la moindre pensée est repérée, la moindre réaction interprétée. Dans ce monde les hommes, maintenus dans la peur, doivent en permanence se conformer au système de l’État, se composer un visage acceptable et aligner leur pensée sur celle du « parti ». Ce monde de l’ordre imposé, ce monde de la paix imposé est un monde de la liberté interdite, un monde où la vie est entrée dans une auto-négation radicale. Monde de la mort.
Pourquoi faut-il donc que nous éprouvions ce besoin d’incarcération ? Pour nous protéger? Derrière la peur qui tente de dominer ce qui fait peur, derrière toutes ces peurs, n’y a-t-il pas une peur de la liberté ? Le pessimisme de Hobbes ne voit dans la liberté laissé aux hommes qu’un péril. Mais qu’est-ce qui nous assure qu’un homme à qui on a rendu sa dignité en lui rendant sa liberté, se conduira de manière asociale, injuste, brutale ? La liberté, portée en pleine lucidité, possède sa propre discipline qui n’est pas une discipline imposée.
L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Vos commentaires
![]() © Philosophie et spiritualité, 2004, Serge Carfantan.
© Philosophie et spiritualité, 2004, Serge Carfantan.
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()