Nous vivons dans une
époque que se prétend une ère de la « communication ». On nous répète sur tous
les tons que nous vivons un monde qui dispose de moyens de communication extraordinaires, dont ne disposaient
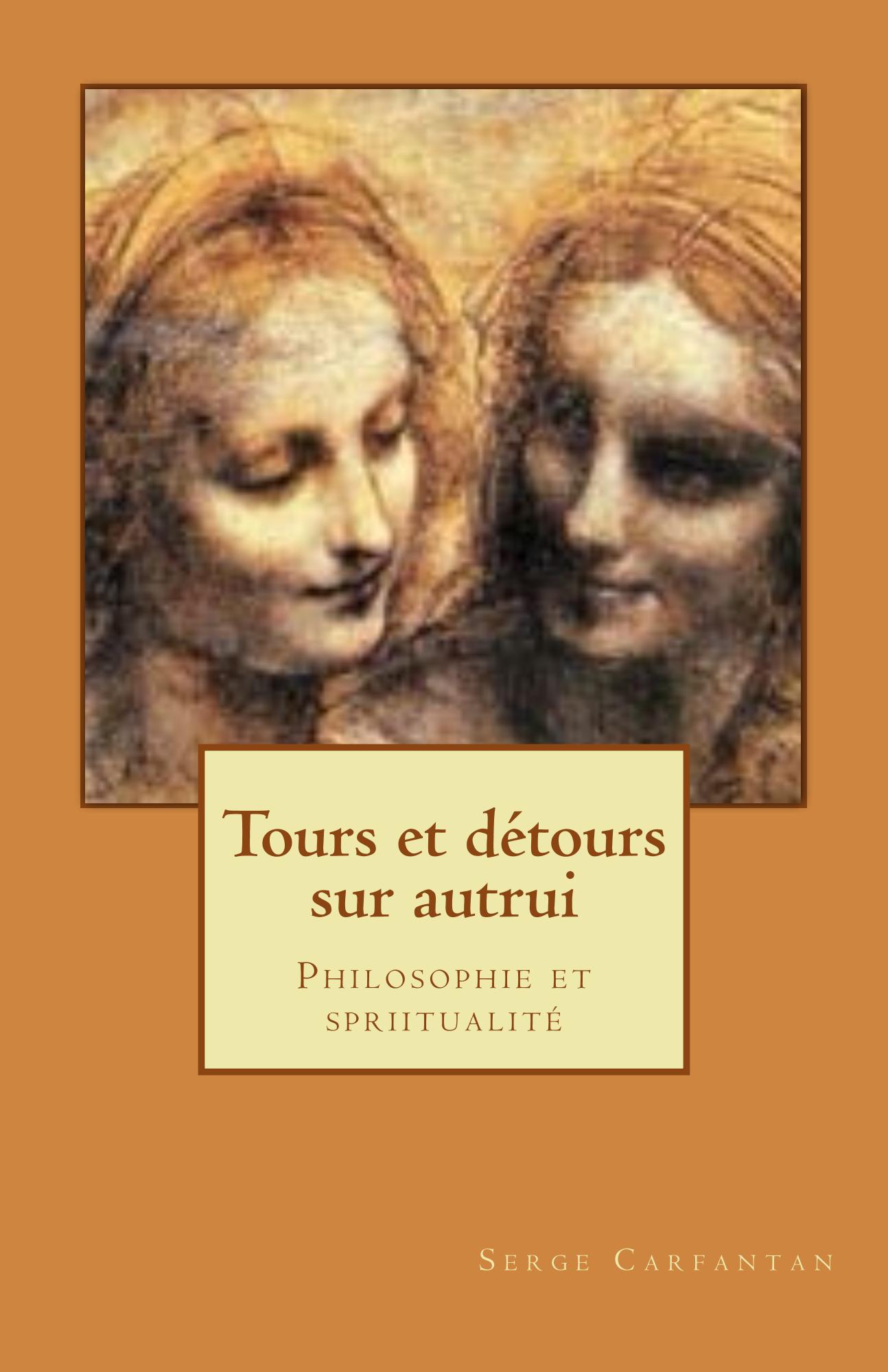 pas les générations précédentes. L’argument tend à nous persuader que, grâce à des moyens techniques modernes, les hommes ont changé de condition et qu’ils sont enfin en relation les uns avec les autres.
pas les générations précédentes. L’argument tend à nous persuader que, grâce à des moyens techniques modernes, les hommes ont changé de condition et qu’ils sont enfin en relation les uns avec les autres.
Mais l’éloge de la communication recoupe beaucoup d’ambiguïtés. Il y a d’abord la confusion qui est faite avec l’information. L’information va à sens unique d’un sujet vers un autre sujet. A proprement parler, la radio et la télévision ne sont pas des instruments de communication, mais des outils d’information. On ne peut pas discuter avec la télévision ! C’est plutôt le contraire, on la subit assez passivement. La communication suppose une information réciproque. Cela veut dire que deux sujets échangent, partagent du sens. D’autre part, si on éprouve un tel besoin irrépressible de communiquer, c’est peut-être justement sur le fond d’une réalité de fait qui est la tragédie de l’incommunicabilité ! l'absence de relation.
Mais avons-nous conscience de ce que suppose une véritable relation ? Ce qui est en question est-ce seulement les « moyens » de la communication ou bien est-ce davantage ?Qu'est ce qu'une relation authentique avec autrui ?
* *
*
Parcourons les degrés de la relation avec l’autre. Le plus bas degré, c’est peut-être celui du sentiment de l’isolement. On se sent isolé quand on souffre d’un sentiment de démarcation vis-à-vis des autres que l’on ne peut effacer. Il y a d’un côté les autres et puis il y a moi qui me sent seul parce que je ne me sens pas enveloppé de la présence de la communauté des hommes. Ainsi de la personne âgée qui vit seule chez elle et qui, ne supportant pas son sentiment d’isolement, allume la télévision du matin au soir, pour « faire une présence ». C’est mieux que rien du tout, ces voix qui parlent dans la lucarne de la télévision, cela donne une présence qui enlève un peu du sentiment oppressant du silence, ce silence qui vous renvoie à votre isolement dans un monde où vous ne comptez guère pour quelqu’un. Pour quitter l’isolement, nous cherchons une présence des autres, et quand c’est trop douloureux, nous fuyons vers les autres de toutes les manières possibles. On va au café pour oublier le cafard d’être si seul. On va partout où des gens sont rassemblés pour quêter un peu de chaleur humaine.Nous espérons qu’un peu de compagnie, même superficielle, parviendra à nous délivrer du sentiment d’isolement. Il y a dans la gaieté des réunions publiques, la gaieté d’une brasserie animée, une forme de contagion qui vous délivre un moment de cet isolement. Mais le sentiment de solitude revient vite après, avec cette tension intérieure particulière, ce sentiment de vide, ce désert intérieur que l’on retrouve de n’avoir personne avec qui communiquer. Mais il y a des processus par lequel on s’isole pour finir peu à peu par se refermer sur soi-même. Le chagrin et la souffrance entretenus tendent à vous isoler des autres et à vous replier sur vous-mêmes. La passion-de-quelque-chose semble vous rapprocher de ceux qui partagent avec vous sa thématique, mais vous coupe aussi du reste du monde qui alors vous indiffère. Les processus égocentriques ont tendance à nous isoler des autres et à nous refermer sur nous-mêmes.
Fuir dans la direction des autres ne résout rien sur le fond. On peut seulement effacer un temps le sentiment d’isolement, au sens où on est placé au dehors d’une communauté. Il suffit d’aller vers les autres. Mais la solitude est autre chose. (texte) Il y a deux figures de l’esseulement de la conscience, l’isolement et la solitude. J’appelle isolement la figure de l’écart avec la communauté des hommes. J’appelle solitude, le sentiment qui vient de la perception de la nature insulaire de chaque conscience. Chacun, qu’il l’accepte ou non, qu’il l’assume bien ou mal, est seul vis-à-vis de lui-même. Je ne peux pas en inviter un autre dans ma tête, je suis le seul à éprouver ce que j’éprouve. Je ne peux pas aller habiter la conscience d’un autre. Personne ne peut vivre, penser, ni décider à ma place. Chaque homme, en tant que conscience, est une île même quand nous sommes en relation avec les autres. On ne peut pas mettre fin à la solitude sur ce plan métaphysique. C’est une illusion de croire que l’on pourrait supprimer la solitude. Ce que l’on peut ôter, c’est la séparation avec autrui qui donne naissance au sentiment d’isolement. ... sentiment de solitude, même au milieu d’une foule .
La leçon que nous donne la solitude sur la communication, c’est de nous indiquer la nature du sujet de la relation. La personne est le sujet et ce sujet doit assumer sa solitude intérieure. Cela ne veut pas dire qu’il faille se replier sur soi - ce serait le solipsisme - cela veut dire que par essence, nous sommes seuls (texte) et qu’il nous faut l’accepter comme tel. Le refus de la solitude est infantile, l’acceptation de la solitude est maturité. La solitude révèle la croissance de l’âme. (texte) D’autre part, assumer la solitude, ce n’est ni fuir la relation, ni s’aliéner dans les autres. L’ermite qui s’est isolé ne connaît pas forcément la solitude, car la seule rupture avec le monde ne suffit pas à donner une conscience profonde de la solitude intérieure. La vraie solitude est solitude avec autrui. L’expérience de la solitude est aussi une nécessité vitale, un véritable besoin, (texte) dans un monde tel que le nôtre qui favorise la confusion. Dans l’agression que le citadin subit tous les jours, dans le grouillement de la présence des autres, dans la violence psychologique des relations, il est bon que nous conservions un droit à la solitude pour nous retrouver nous-mêmes. Tout homme a besoin de solitude pour se retrouver, (texte) pour prendre un peu de recul devant l’existence.
« Et vous, dont le regard me suit éternellement, supportez-moi. Quelle joie, quel supplice, je suis enfin changé en moi-même ! On me hait, on me méprise, on me supporte, une présence me soutient à l’être pour toujours. Je suis infini et infiniment coupable ».
--------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Questions:
1. Que faut-il penser de ces paroles de chansons : "la solitude, cela n'existe pas... j'ai ma place au café du coin"...?
2. Nos attentes à l'égard d'autrui ont elles un rapport avec le caractère conflictuel de nos relations?
3. Le regard est-il par nature conflictuel? Quand le devient-il?
4. Le conflit est-il une forme de relation ou bien est-il l'échec de la relation?
5. Comment se fait-il que l'ego, qui veut être "spécial", apprécie par ailleurs autant le conformisme?
6. Y a-t-il nécessairement un rapport entre la sympathie et la conscience morale?
7. Pourquoi identifions-nous l'amour avec l'attachement?
![]() © Philosophie et spiritualité, 2002, Serge Carfantan.
© Philosophie et spiritualité, 2002, Serge Carfantan.
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()