Nous pourrions
individuellement nous vanter de mener une vie confortable, d’avoir
réussi sur le plan du travail, de conserver une piété religieuse, d’avoir
une moralité irréprochable, ou un sens esthétique raffiné et des valeurs
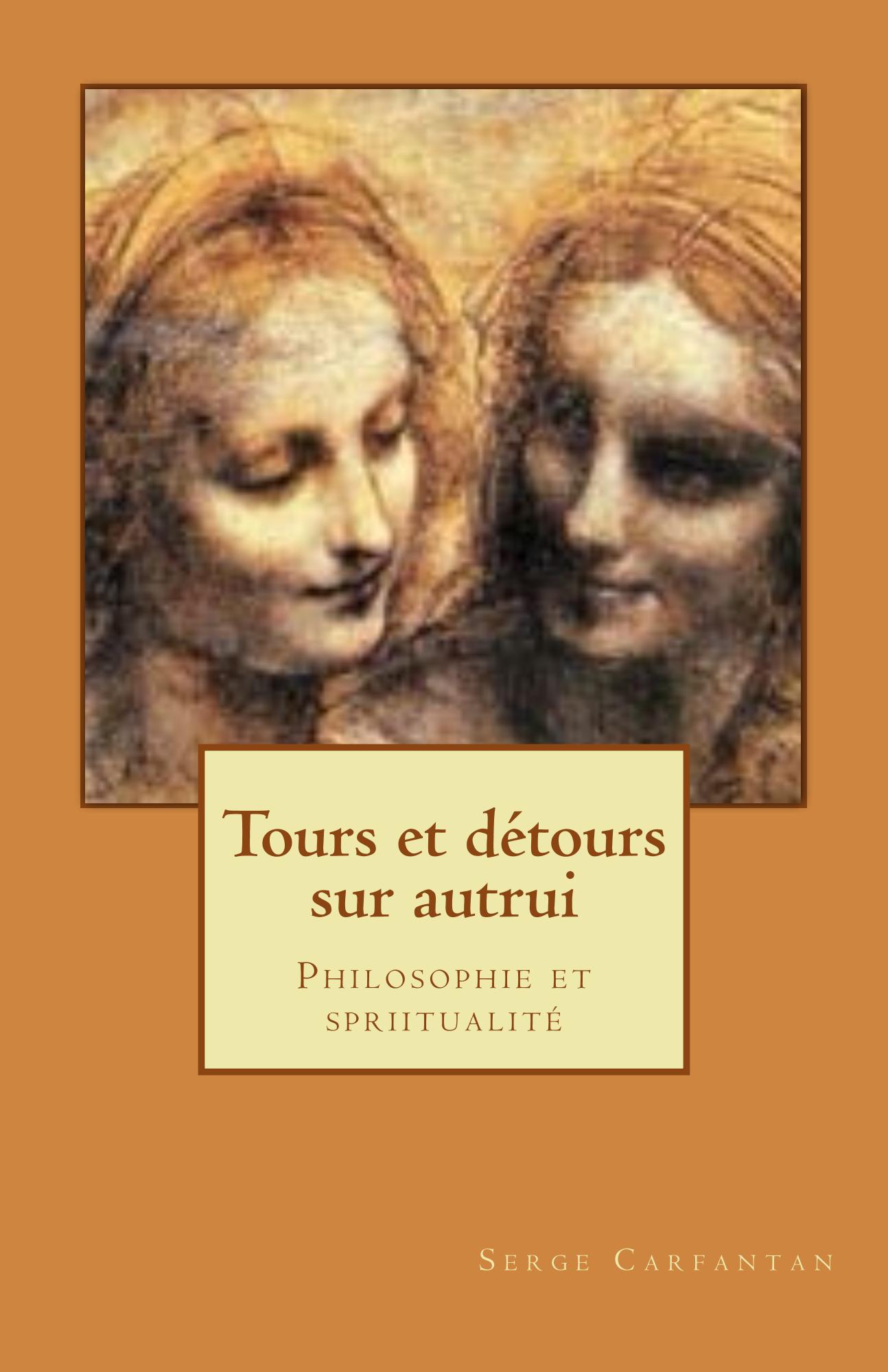 intellectuelles solides. Il n’est pas certain pour autant que le sens de
la relation y trouve son compte. C’est même souvent le point faible des
personnalités les plus fortes dont on dit qu'ils ont réussi. Le sujet qui fait montre d’un
QI élevé peut très bien en même temps être asocial, voire être
un autiste de la communication. Bref, le QI ne rime pas avec le QR (quotient
relationnel).
intellectuelles solides. Il n’est pas certain pour autant que le sens de
la relation y trouve son compte. C’est même souvent le point faible des
personnalités les plus fortes dont on dit qu'ils ont réussi. Le sujet qui fait montre d’un
QI élevé peut très bien en même temps être asocial, voire être
un autiste de la communication. Bref, le QI ne rime pas avec le QR (quotient
relationnel).
Notre époque connaît une extraordinaire débâcle relationnelle. L’homme postmoderne vit replié sur lui-même, il profite de bien des avantages que la société lui offre, mais il communique peu ou mal. Il vit dans l’isolement, car ce sont les processus égocentriques qui font naître son isolement. Il vit aussi dans un déchirement relationnel constant, en reportant indéfiniment ses attentes sur l’autre, en espérant que le prochain amour comblera ce que le précédent a déçu. Ce qui semble invariablement mener d’illusion en illusion, ou bien conduire à cette situation de désespoir tranquille qui résume le plus souvent la vie de couple aujourd’hui.
Nous pourrions examiner ce qu’il en est de la relation entre les peuples et les cultures et le constat serait le même. La relation constitue dans notre société un problème majeur. Même si nous avions réussi à résoudre tous les autres, il resterait celui-là. Et on peut oser retourner la formule : peut être est-ce parce que nous n’avons pas réussi à résoudre celui-là que nous avons aussi tous les autres ! Qu’est-ce qui ne va pas dans notre sens de la relation ? Qu’est-ce qu’une relation humaine accomplie ? Le dysfonctionnement relationnel est-il seulement lié au contexte de nos mentalités ? Il est vrai que l’hyper individualisme de notre temps est peu propice à l’accomplissement de la relation. Nos échecs s...
Pour l'instant, ne prenons pas en compte ce qui a été dit plus haut pour en rester à ce que peut dire l'opinion. Nous pensons communément que le but de la relation est de trouver la joie, le bonheur et l’épanouissement dans le partage de la vie avec un autre. Il faut maudire notre solitude, la défaire, aller vers les autres, car ce n’est qu’hors de soi que l’on peut trouver ce qui nous rendra heureux. Nous avons besoin des autres et la solitude est un repli sur soi dont on doit sortir, pour exploser dans la relation à l’autre. Essayons de donner sa voix à cet implicite très présent dans l’attitude naturelle. Selon les croyances communes, qu’est-ce qu’une relation sérieuse ? Si nous mettions au grand jour les croyances inconscientes sous-jacentes à la plupart de nos comportements cela donnerait à peu de choses près à ceci : (texte)
1) Prosopopée de l'attachement : « La solitude existe là sans que l’on y soit pour rien. Elle vient avec notre vie dans ce monde. On n’est rien sans les autres et on entre dans le monde au milieu des autres ; mais, comme le autres n’ont d’abord de souci que pour lui-même, il nous faut lutter pour détourner leur attention vers nous. Il faut appeler l’autre dans la relation. Soi-même on ne représente rien. Il nous faut quelque chose d’autre ou quelqu’un d’autre pour mettre fin à notre solitude et à notre malaise. Nous débarquons dans le monde perdu, étranger, égaré et il faut bien que les autres nous reconnaissent tel que nous sommes et entendent notre appel. S’il y a bien une chose que je puis exiger de l’autre, c’est qu’il m‘écoute, me réponde et me porte secours. C’est ce que veut dire responsabilité. C’est le sens premier de la dignité de la personne que d’être une individualité capable de réponse. Un être humain n’est pas un pot de fleur, il peut être interpellé, il peut répondre à l’appel d’un autre être humain. Donc me répondre. On naît faible et dépendant, comme de hasard, dans un monde incertain.
________________________________ engager dans la relation». (texte)
2) Voilà qui est dit. Il vaut mieux dire tout haut ce que l'on pense tout bas, cela met nos croyances inconscientes en lumière. Nous comprenons mieux l’insistance de la religion sur la fidélité et en général l’interprétation moralisante de la religion. La religion apporte le poids de son autorité et se porte garant de la fidélité de la relation devant Dieu. Elle fait de la satisfaction des besoins une relation sacrée. La faute par excellence est toujours une faute dans la relation, la faute c’est l’infidélité. L’infidélité à la promesse dans la relation. Dans l’Islam le pêcheur, le fautif, le traître, c’est l’infidèle. Il est dit que Dieu lui-même a des besoins que l’homme doit satisfaire et que s’il ne les satisfait pas, la malédiction va s’abattre sur lui. Si l’homme est maudit, c’est d’avoir renié son engagement envers Dieu. S’il est sauvé, c’est de renouveler l’engagement de sa relation à Dieu. Or cet engagement se traduit par le fait même de devoir se consacrer à la sécurité de l’autre en s’engageant dans une relation éthique et pas seulement passionnelle. Ce qui est une relation dite "sérieuse". (document)
c) Le libertin en un sens adhère aussi d’une certaine manière à ce type de discours et c’est pourquoi il choisit délibérément la fuite : la licence de faire tout ce qui lui plaît, au mépris de la relation. Entrer dans une relation sérieuse, ce serait renoncer à sa liberté, accepter la cage et ses barreaux dorés. Plutôt n’écouter que ses désirs et n’avoir pour guide que l’empire conquérant de sa liberté. Pensons à La non-demande en mariage de Georges Brassens.
Faut-il inscrire la crise des relations dans un contexte plus large, celui des
mentalités de notre époque ? Est-ce une question « sociologique » ?
(texte) Ce serait
une tentative adroite de relativiser le problème des relations vers le «
social » en général. Les analystes les plus lucides de notre temps s’accordent à
reconnaître que la postmodernité est en proie à une situation de crise
relationnelle inédite. Notre époque confond tous les repères, brouille toutes
les relations et retourne allègrement toutes les valeurs. Alors, au milieu des
familles recomposées, des divorces à répétition, des familles monoparentales, des
couples à la dérive, on se cramponne comme on peut et on se débat pour trouver
des assurances où on croit pouvoir en trouver. L’hyper
individualisme postmoderne
a mis l’ego sur un piédestal. Moi se montre, moi s’exhibe, se met en valeur, moi
se démonte, se démystifie, se dénigre, mais moi est toujours là, y compris quand il
fait une véritable fixation sur l’autre. A partir du moment où le culte des
apparences est une préoccupation furieuse et où l’ego a une place aussi
importante, il y a bien peu de chance que les relations se portent bien.
Gilles
Lipovetsky dans
L’Ere du
Vide note que le sujet-consommateur finit par
tout mettre sur le même plan. Consommer-jeter. Une relation amoureuse, cela se
consomme et cela se jette, comme une barquette de frittes et une canette de
soda. Le sexe, c’est de la consommation rapide, comme la cigarette. A partir du
moment où le culte du plaisir est devenu la seule valeur prédominante, le sens
d’une relation morale est délétère. Nous sommes, selon un autre tire de
Lipovetsky à l’ère du
Crépuscule du devoir. Seulement, la boulimie
consommative renforce la frustration, elle fragilise les plus faibles, elle
exaspère les tensions sociales. Elle suscite la colère à l’égard de ceux qui ont
le privilège de pouvoir vivre des fantasmes que le commun des mortels doit se
contenter de regarder à la télé.
... répondre :
Faut-il identifier la solitude avec l’isolement ? On peut
accuser la « société », mais ne sommes-nous pas pour quelque chose dans notre
isolement ? N’y a-t-il pas des processus qui conduisent à l’isolement et le
renforcent ? Que nous soyons interdépendant, cela, personne n’en doute, mais
l’interdépendance et la dépendance, est-ce bien la même chose ? Entrer dans
la
relation, en exigeant la satisfaction d’un
désir de reconnaissance, n’est-ce pas
la meilleure façon de la saboter ? Ce qui est essentiel dans la relation, est-ce
ce qu’on en retire, ou n’est-ce pas plutôt ce qu’on lui apporte ? La
responsabilité n’est-t-elle pas une expression de l’auto-référence ? Ou encore,
la responsabilité, n’est-ce pas surtout le lien auquel je me donne, plutôt
que le profit que j’en retire ? Le propre de l’irresponsabilité, n’est-ce pas de
se dégager soi-même de toute relation ? Est-il bien exact de dire qu’une
relation doit être « construite » ? N’est-elle pas toujours déjà-là, en sorte
que ce qui compte, c’est surtout de la vivre ? Etre relié à un autre, est-ce la
même chose que de le ligoter ? Peut-on vraiment trancher dans la valeur des
relations ? Et si toutes les relations étaient sacrées ? Et si la solidarité
n’avait en fait rien à voir avec la dépendance mutuelle liée au besoin ? Et si
l’amour n’avait rien à voir avec l’attachement ? Et si aimer voulait précisément
dire donner de soi sans attente, (texte) sans tractation, sans espoir de retour ? Et si
l’amour était un don et non pas un échange ? Et si le « contrat de mariage »
religieux et public, fondé sur le seul désir de sécurisation, était une
imposture ? Et si la demande d’un amour exclusif et l’incarcération de la
liberté qui s’ensuit, étaient la meilleure manière de tuer l’amour ? Et si l’amour
et la liberté par essence allaient toujours ensemble ? Et si nous découvrions
brusquement que ce qui grandit une relation, c’est justement de pouvoir
l’aborder sans demande ni exigence ? Et si la caution d’autorité de la religion
qui présuppose en Dieu des « besoins » était fondée sur une mécompréhension ?
- ----------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
![]() © Philosophie et spiritualité, 2005, Serge Carfantan,
© Philosophie et spiritualité, 2005, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()