Si mon existence était résumée dans le seul fait d’être tombé là, dans une sorte de chute au milieu d’un monde existant, je n’aurais
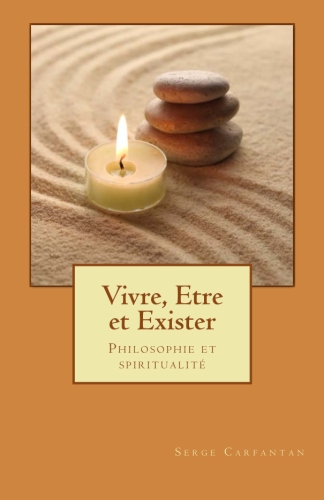 pas d’autre issue que de tenter de la récupérer au mieux, en lui donnant un sens.
Comment me sentir responsable de quoi que ce soit ? Comment pourrais-je me sentir responsable de ce que je suis ? Il est facile d’argumenter en disant que ce que je suis, c’est ce que le monde a fait de moi. J’ai été lourdement conditionné par mon hérédité, par un passé difficile, élevé dans un contexte familial, dans une langue, dans une classe sociale, dans une religion, dans une idéologie politique. J’ai été formé, préformé et même peut être déformé dans ma manière de penser. Comment dès lors puis-je encore prétendre à une quelconque responsabilité
?
pas d’autre issue que de tenter de la récupérer au mieux, en lui donnant un sens.
Comment me sentir responsable de quoi que ce soit ? Comment pourrais-je me sentir responsable de ce que je suis ? Il est facile d’argumenter en disant que ce que je suis, c’est ce que le monde a fait de moi. J’ai été lourdement conditionné par mon hérédité, par un passé difficile, élevé dans un contexte familial, dans une langue, dans une classe sociale, dans une religion, dans une idéologie politique. J’ai été formé, préformé et même peut être déformé dans ma manière de penser. Comment dès lors puis-je encore prétendre à une quelconque responsabilité
?
Seulement, raisonner ainsi conduit à une complète démission de ma liberté. Ce que je suis, ce n’est pas une simple chose disposée là, comme le coupe-papier, ou comme la racine de marronnier dans le jardin. Le je suis porte en lui une conscience de soi, et la responsabilité de ses actes dans le monde. Ce monde c’est mon monde, il n’est pas séparable de moi. Quand je constate avec amertume dans quel état l’homme a pu mettre la Nature, je ne peux pas m’en tirer en disant que cela ne me regarde pas. Aussi bien, je ferais mieux de dire que je suis responsable de tout ce qui arrive dans le monde.
... responsable de ce qu’elle est et quelle responsabilité lui revient donc de droit ? Peut-on dire que l’existence humaine implique une totale responsabilité à l’égard de soi-même ? Ai-je le droit de me défaire de mes responsabilités ? Puis-je dire que je ne suis pas responsable de ce que je suis ?
De quoi puis-je légitimement me sentir responsable ?* *
*
Une remarque : La responsabilité surgit à l’intérieur de l’état de veille, elle est la marque de la vigilance, pour autant que celle-ci se maintient que comme sur-veillance ; elle perd son sens dans l’état de rêve où le sujet est englouti dans un flot d’images. Nous ne parlons pas de responsabilité dans le monde onirique, mais dans le monde de la vie ouvert dans la vigilance. Cependant, encore faut-il que nous comportions pas dans l’état de veille, comme si nous étions dans les nimbes d'un rêve. Alors seulement le mot responsabilité peut prendre son véritable sens, celui d’un engagement entier dans le monde de la vie. (texte)
1) Est responsable celui qui doit surveiller ce qui est sous sa responsabilité dans le champ des objets, dans l’environnement de la nature, qui doit prendre garde à la sauvegarde des personnes vis-à-vis desquelles il est moralement engagé. Je suis responsable si le vase s’est cassé, si je l’ai mis trop près de la fenêtre et qu’un coup de vent l’a renversé. Je suis responsable des rejets toxiques que je répands dans la Nature, je suis responsable de mes enfants, tant qu’ils sont encore mineurs. Par extension, je suis aussi responsable des décisions politiques prises dans l’État et de ce chaos qui règne dans ma société, dans la mesure où je ne peux pas m’en dégager. La responsabilité est individuelle, mais s’étend de proche en proche parce que dans le monde de la vie, rien n’est séparable ; tout est lié. L’écologie nous apprend que si une destruction a lieu en un point de la planète, elle ne peut pas être sans incidence sur le reste du monde.
La responsabilité prend place dans l’unité de l'être et elle a d’emblée une dimension morale. Être responsable, c’est pourvoir et devoir répondre de ses actes, ce qui veut dire qu’il n’y a de responsabilité que par rapport à un devoir-être. On dit que l’on porte la responsabilité, ce n’est évidemment pas un poids matériel, mais le poids d’une exigence, d’une obligation que nous devons satisfaire à l’égard de tout ce qui nous a été confié et que nous avons en garde. Le gardien de nuit est responsable de la sécurité et de l’intégrité des installations de l’usine. S’il s’endort et qu’il y a un vol, c’est lui qui est mis en cause. Il devait surveiller. Les parents sont responsables de leurs enfants jusqu’à leur majorité. S’ils font des bêtises, c’est eux qui en sont responsables, car ils devaient les surveiller. Nous sommes donc essentiellement responsable à l’égard de quelque chose et par rapport aux personnes qui sont enveloppées dans le champ de l’action, à l’égard de l’environnement dans lequel l’action prend place.
La responsabilité suppose une grande lucidité qui voit bien au-delà de la perception à courte vue d’un simple geste sans conséquence, pour anticiper des conséquences lointaines dans le temps et l’espace. Jeter un mégot allumé dans un fourré en plein été, « comme ça », est un acte à courte vue. Ce genre de geste inconscient serait bénin dans le monde onirique, il devient grave de conséquences dans le monde de la vie. Ne pas le faire, parce que ce serait courir le risque d’un grave incendie de forêt, c’est avoir une vision plus étendue. La perception à courte vue est fragmentaire et inconsciente. La vision globale est plus éveillée et lucide, elle rejoint la conscience d’unité de toutes choses.
Dans la tension quotidienne, la r...
Malheureusement, nous ne pouvons pas dire que la condition postmoderne contribue vraiment à tirer la conscience vers l’éveil, pour sortir l’esprit d’une condition quasi-onirique ; à permettre de développer une vision globale, en faisant disparaître toute perception fragmentaire du réel ; à rendre l’esprit plus fort, afin qu’il puisse porter la responsabilité. Nous vivons aux temps de la confusion du virtuel et du réel. La surenchère de l’image, le conditionnement qui invite à vivre la vie par procuration exerce un effet dissolvant sur la lucidité. On s’insurge devant le comportement dangereux des automobilistes sur la route, des jets-ski en mer, des conducteurs de 4X4 en montagne. On s’étonne de l’étalage constant du sexe, de l’immoralisme ambiant, des jeux stupides et violents, des jeunes filles violées en groupe dans des caves de HLM. ; de la délinquance en général etc. Mais c’est ce qui est donné en pâture au téléspectateur. Quand la morale se délite et que la culture devient triviale, il ne faut pas s’étonner que l’influence de l’image engendre des passages à l’acte. C’est le contraire qui serait étonnant. L’image a un empire considérable sur un esprit faible et sans repères ; elle fournit une suggestion, de quoi meubler l’ennui d’une génération désœuvrée, sans but, sans ambition et sans vraie passion. L’atmosphère de gaîté artificielle entretenue par nos médias, l’entreprise constante de la dérision, sapent par avance le sens du sérieux. Quand on est conditionné massivement à vivre la tête dans des petits plaisirs, on vit dans un rêve entretenu, comme dans un clip vidéo. On n’a pas les pieds sur terre et on perd contact avec le réel. La postmodernité travaille massivement sur la culture pub à assurer le contrat tacite des gens qui dorment.
On s’étonne de la légèreté avec laquelle le touriste laisse ses sacs plastiques en pleine nature. On se scandalise de l’inconscience par laquelle le commandant de bord d’un pétrolier va vider ses cuves en haute mer, de la déforestation galopante sur la planète, de la destruction progressive des espèces vivantes. Les ethnologues constatent la destruction progressive des cultures traditionnelles et de l’empire terrifiant du modèle culturel occidental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il y a bien un fil conducteur qui unit tous ces phénomènes : l’absence d’une perception globale de la Nature, de la société, de la vie humaine et une perte complète du sens de la responsabilité dans le consumérisme ambiant. cf. Scott Peck (texte) En conséquence, nous ne pouvons que constater amèrement autour de nous les effets d’une vision myope et fragmentaire. Notre savoir lui-même, est fragmentaire et c’est ce mode de pensée fragmentaire que l’on inculque en guise d’éducation. Comment dans ces conditions pourrait-on enseigner en quoi que ce soit le sens de la responsabilité ?
Enfin, nous ne faisons quasiment rien pour développer l’intelligence, l’intégrité, pour développer la conscience, donner à l’esprit une force de cohésion et une confiance en soi. S’il est un point de convergence des orientations postmodernes, c’est au contraire la tendance constante à émousser l’intelligence, à saper l’intégrité de l’esprit, la confiance et la cohésion avec soi. Nous mettons les fantastiques moyens dont nous disposons au service de l’ignorance. Nous prenons des airs ahuris devant des actes dont la gravité nous insulte, mais nous travaillons implicitement à fabriquer des générations écervelées et des dirigeants irresponsables. Il est indispensable de donner au développement de la conscience la première place. On ne peut pas faire d’impasse sur la lucidité. Croire que l’on peut se contenter de « solutions techniques », sans prendre en compte la nécessité d’un changement de conscience est une illusion. S’il faut regarder ce monde droit dans les yeux, « C’est pourquoi il est très important que ceux qui souhaitent eux-mêmes créer une culture nouvelle, une société nouvelle, un État nouveau, commencent par se comprendre. En prenant conscience de soi, de ses diverses fluctuations et mouvement internes, on perçoit les motifs, les intentions et mouvements internes, on perçoit les motifs, les intentions, les périls cachés ; et seule cette conscience permet la transformation ». (texte)
Bref, dans ce monde, il est très facile de se déresponsabiliser en rejetant la faute sur un « autre ». C’est même une tendance omniprésente (texte), c’est aussi la pente de la faiblesse et du défaitisme.
La prosopopée de l'irresponsabilité , poussée à l’extrême donnerait ceci (document). A peine exagérée. En résumé: la proposition : "je ne suis pas responsable de mon existence", peut se justifier de toutes sortes de manières : « l’hérédité, « l’identité culturelle « , « la classe sociale », le « l’inconscient », la « société », « l’État » etc. Conclusion : je ne suis responsable de rien et surtout pas de moi-même ! D'où ce climat délétère dans lequel nous vivons, comme le dit Krishnamurti, "l'une des astuces des gens irresponsables est de tourner les choses en dérision pour mieux les fuir". (texte)
L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
![]() © Philosophie et spiritualité, 2004, Serge Carfantan.
© Philosophie et spiritualité, 2004, Serge Carfantan.
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()