Nous avons vu que l’homme occupe une place particulière dans la Nature qui n’est pas la même que celle qui est dévolue à l’animal.
Dans une représentation finaliste de la Nature d’Aristote, il n’y a pas de coupure brutale tracée entre l’homme et la Nature. La finalité qui régit globalement la Nature s’applique aussi à l’humain. S’il y a une nature propre des éléments tels que la Terre, le Feu ou l’Eau, une nature de l’animal, il y a aussi une nature propre à l’homme qui est
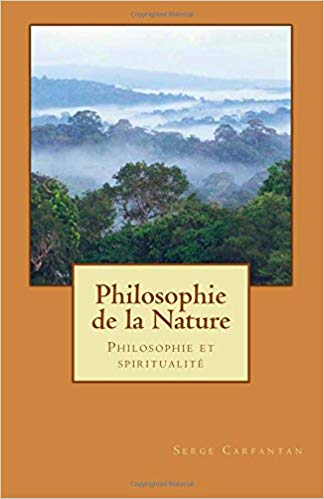 caractérisée par la raison. Comme toute nature, la nature de l’homme doit connaître un développement qui lui est propre, d’un état potentiel, (la puissance), à un état actuel, (l’acte).
caractérisée par la raison. Comme toute nature, la nature de l’homme doit connaître un développement qui lui est propre, d’un état potentiel, (la puissance), à un état actuel, (l’acte).
Par contre, dans la représentation mécaniste, qui se fait jour à l’aube de la science moderne, une coupure s’instaure entre l’homme et la nature. Il y a d’un côté le règne sans partage du mécanisme dans la Nature, de l’autre le royaume de la pensée et de l’humain. La Nature d’un côté, la culture de l’autre. Du coup, l’idée qu’il puisse y avoir une « nature humaine », fait problème. L’homme n’est pas un objet utilitaire ou une moisissure, comme dit Sartre. Seul sa pensée prescrit ce qu’il peut être. L’homme n’est pas « naturel ». L’homme est laissé à lui-même dans la nature en ayant à charge, à travers sa propre culture, de former une humanité que la nature ne peut pas former pour lui. Tel est le rôle de l’éducation. Et nous voilà confronté au problème de savoir comment cette genèse s'opère. En termes simples la question est : en quel sens peut-on dire que l’être humain est un être de culture ?
* *
*
Question simple : Que serait un homme, si on le privait de sa relation à une culture ? Il suffit pour répondre d’examiner ce que devient un être humain oupé de toute société et laissé à lui-même dans la nature. Telle est la problématique de l’enfant sauvage.
La culture, selon l'ethnologie, est l’ensemble des productions signifiantes d’une société humaine organisée, ce qui implique le langage, les mœurs, les traditions, la politesse, la manière de vivre et de se comporter etc. telle qu’elle existe dans une société donnée. Nous vivons dans notre culture, nous y sommes habitués, comme le poisson dans l'eau et il nous paraît de ce fait tout à fait normal qu'elle soit naturelle. Notre conditionnement social nous porte à croire que tout ce qui est normal, selon notre culture, est aussi naturel, donc universel et inscrit dans la nature. (texte)
![]() ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mis dans la Nature. Le cinéma nous a souvent présenté une image du sauvage vivant seul dans la jungle, comme le Tarzan d’Hollywood : un héros bien rasé, maquillé avec de la gomina dans les cheveux, parlant un bel anglais et connaissant déjà les bonnes manières ! Dans le même sens, le dessin animé représente l'animal comme ayant des sentiments très humains : trop humains, des personnages tirés de notre univers culturel et habillés en lapin, en chat, en lion, en souris etc. Cette représentation du sauvage ne correspond à rien de réel, elle relève du mythe.
Nous vivons en Occident avec le mythe de l'homme naturel, mythe qui exprime
toute notre nostalgie d'une vie au milieu de la Nature. Il faut se méfier de la
tendance qui consiste à projeter des éléments empruntés à l’homme actuel sur un
« sauvage » qui n’est que le produit de notre imagination. ... l'image mythique
d'un homme naturel, image qui ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mis dans la Nature. Le cinéma nous a souvent présenté une image du sauvage vivant seul dans la jungle, comme le Tarzan d’Hollywood : un héros bien rasé, maquillé avec de la gomina dans les cheveux, parlant un bel anglais et connaissant déjà les bonnes manières ! Dans le même sens, le dessin animé représente l'animal comme ayant des sentiments très humains : trop humains, des personnages tirés de notre univers culturel et habillés en lapin, en chat, en lion, en souris etc. Cette représentation du sauvage ne correspond à rien de réel, elle relève du mythe.
Nous vivons en Occident avec le mythe de l'homme naturel, mythe qui exprime
toute notre nostalgie d'une vie au milieu de la Nature. Il faut se méfier de la
tendance qui consiste à projeter des éléments empruntés à l’homme actuel sur un
« sauvage » qui n’est que le produit de notre imagination. ... l'image mythique
d'un homme naturel, image qui ...
Les enfants que l’on a pu découvrir seuls dans la nature étaient assez peu humain de par leur comportement. Victor de l’Aveyron par exemple, a été trouvé à l’âge de 6 ans par des chasseurs près d’un village. Il avait vécu comme un jeune animal dans les bois. Cf. Lucien Malson. Les enfants sauvages. Sa gorge n’émettait qu’un cri rauque, il cherchait constamment à fuir, il était indifférent aux mauvaises odeurs, à l’hygiène en général, il ne reconnaissait même pas son image dans un miroir. Il faisait le tour du miroir pour savoir qui était caché derrière. C'était une sorte de petit animal farouche. En bref, il ne semblait manifester aucune des caractéristiques « humaines » : le langage articulé, la sociabilité, la connaissance réflexive de soi, jusqu'à la station debout. Était-ce normal.?
Devant un cas d’école de ce type, suivant la représentation de la nature humaine qui sert de point de départ, on peut prendre deux positions extrêmes :
1) soit partir du principe qu’il existe une nature humaine innée, douée du langage de la sociabilité etc. et confronter l’idée de la nature humaine avec tel ou tel cas. Comme l’enfant sauvage ne semble pas posséder les traits caractéristiques de la nature humaine, on aura tendance à penser que l’enfant est déficient, parce qu’il devrait les posséder, puisqu’elles sont innées. Le premier psychiatre à avoir examiné Victor, Pinel, prit ce parti. Victor ressemblait par son comportement aux idiots de naissance que l’on tente de soigner en psychiatrie. Pinel conclut que cet enfant devait être idiot et pour cette raison devait ...
2) soit partir du principe qu’il n’y a pas vraiment de nature humaine qui soit proprement innée, les éléments de la nature humaine étant plutôt acquis en société. Si Victor est privé de la sociabilité, du langage, de la connaissance réflexive de soi, ce n’est pas parce qu’il est idiot, mais parce qu’il ne les a pas appris, n’ayant pas été mis en contact avec ses semblables dans une société. Le second médecin le docteur Itard adopta ce point de vue.
Seulement, les choses sont complexes, parce que le mot « culture » s’entend en deux sens très différents :
1) Au singulier, la culture, c’est l’éducation que reçoit un être humain qui va faire de lui un homme de savoir, un homme civilisé par l’assimilation d’une richesse de culture physique, intellectuelle, esthétique.
2) Culture se prend aussi au pluriel, au sens d’un milieu dans lequel un être humain est élevé, milieu qui varie d’une région à l’autre du monde. Prenez un exemple au cinéma : dans Les dieux sont tombés sur la tête, on voit la rencontre entre l'indigène nu du désert du Kala-hari et l'occidental en complet veston (le dieu qui vole dans un drôle d'oiseau de métal au dessus du désert). La bouteille de coca-cola lâchée de l'avion va être une source d'interrogation pour le petit peuple du désert. Ils ne comprennent pas ces gens étranges que nous sommes, considèrent l'occidental particulièrement inculte (incapable de lire une trace dans le désert, de survive à la soif etc.) Inversement, l'occidental ne comprend pas le langage de ce peuple, ces manières de vivre, d'où une série de quiproquos dans le film.
Aussi loin que nous cherchions autour de nous, nous ne trouverons jamais « d'homme naturel », mais des formes de cultures dans lesquelles des hommes apprennent le modèle d’humanité qui est le leur. « Humaniser » est un verbe que l’on conjugue au pluriel. Nous n’avons pris conscience de cette diversité culturelle que très récemment dans l’Histoire. Ceux que l’on nomme soi-disant des « primitifs », par opposition à nous autres « civilisés », ne sont pas moins que nous à l’étage de la culture. Ils ne sont pas plus près de la nature. Ils ont seulement développé un modèle de culture qui est différent du nôtre. Comme tous les être humains ils vivent sur le plan de la culture.
--------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Questions:
1. Quelle différence marquer entre le Tarzan du cinéma, l'enfant sauvage et l'homme préhistorique?
2. Comment se fait-il qu'un être humain, à la différence de l'animal, mette autant de temps pour passer à l'état adulte?
3. Peut-on établir une relation entre le racisme, l'ethnocentrisme et l'idée du progrès?
4. De quel point de vue l'hypothèse de l'état de nature conserve-t-elle un sens?
5. Quelle relation établir entre la culture et la liberté?
6. Quel sens prend l'idée d'homme cultivé, si on la détache d'une culture spécifique pour ne 'envisager que sur un plan universel?
7. Faut-il fixer un terme au perfectionnement de l'humanité par l'éducation ou considérer qu'il est indéfini?
![]() © Philosophie et spiritualité, 2002, Serge Carfantan.
© Philosophie et spiritualité, 2002, Serge Carfantan.
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()