Si on en
croit le discours habituel des médias et en particulier celui de la télévision,
nous partageons pleinement l’opinion de Nietzsche : « Le sérieux, ce symptôme
évident d'une mauvaise digestion». Une mauvaise humeur. En français, « sérieux »
est trop près de « serré » et le glissement du vocabulaire courant va tout de
suite vers « coincé » ! Dans un monde où la décontraction est de mise, le
sérieux n’a guère sa place, si ce n’est
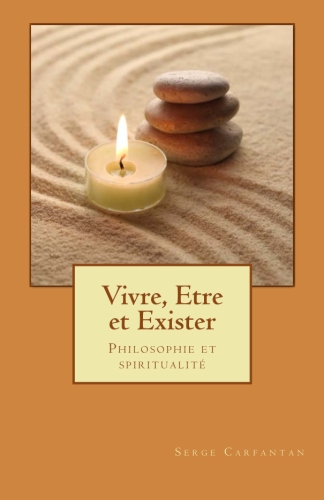 dans la panoplie des personnages
ridicules dont le théâtre et le cinéma on besoin pour produire des effets
comiques. Être sérieux, c’est être rigide, solennel, pesant, donc pour tout dire
ennuyeux et même assommant pour les autres. Et puis, comme le dit la publicité,
« la vie est trop courte pour s’habiller triste ». Nous sommes là pour nous
amuser. C’est d’ailleurs un privilège de la jeunesse : « on n’est pas sérieux
quand on n’a que dix-sept ans » dit Rimbaud. En gros, le sous-entendu est :
« pour rester jeune, soyons léger et moquons nous de tout. Le sérieux, c’est bon
pour les vieux : ceux qui se prennent au sérieux : les journalistes du 20
heures, les hommes politiques, les profs et les curés !».
dans la panoplie des personnages
ridicules dont le théâtre et le cinéma on besoin pour produire des effets
comiques. Être sérieux, c’est être rigide, solennel, pesant, donc pour tout dire
ennuyeux et même assommant pour les autres. Et puis, comme le dit la publicité,
« la vie est trop courte pour s’habiller triste ». Nous sommes là pour nous
amuser. C’est d’ailleurs un privilège de la jeunesse : « on n’est pas sérieux
quand on n’a que dix-sept ans » dit Rimbaud. En gros, le sous-entendu est :
« pour rester jeune, soyons léger et moquons nous de tout. Le sérieux, c’est bon
pour les vieux : ceux qui se prennent au sérieux : les journalistes du 20
heures, les hommes politiques, les profs et les curés !».
Discours caractéristique de nos mentalités actuelles, disions-nous dans une leçon précédente. Discours qui s’allie remarquablement bien avec le conditionnement apte à produire un consommateur obéissant. Un esprit, qui prend tout à la légère, est facilement influençable. Comme il papillonne déjà dans sa tête, il ira papillonner devant les vitrines. Un esprit léger est irréfléchi et il est bon qu’il soit en plus snob et artificiel. Il sera captivé par toutes les nouveautés et cela fera tourner le commerce. La légèreté fabrique des individus très sociaux, toujours dans l’air du temps, bien intégrés dans la convivialité ludique de la consommation. Autre avantage, un individu léger au point d’être écervelé, n’est jamais aux commandes de sa propre vie, il en laisse le soin à d’autres, ce qui est très utile pour ceux qui disposent des rennes du pouvoir.
Alors ? Faut-il prendre la vie au sérieux ou à la légère? N’y a-t-il pas une différence entre le fait d’être sérieux et de se prendre au sérieux ? L’humour, auquel on oppose si facilement le sérieux, est-il si léger que cela ? Avec quelle forme de conscience le sérieux est-il en rapport ? Faut-il ne pas prendre la vie au sérieux ? Mais passer sa vie en touriste, n’est-ce pas rater l’essentiel ?
* *
*
Nous avons affaire à un concept duel : léger/lourd dont le sens premier est tiré du registre de la volonté qui fait effort. C’est dans la dualité que nous devons d’abord chercher. Un sac peut être lourd ou léger suivant mon énergie momentanée. Ce qui est léger est comme une feuille en l’air, allant de-ci delà, sans attache, suivant les caprices du vent. Ce qui est lourd est solidement posé ou tombe comme un boulet par terre. Le sens figuré nous donne l’équivalent spirituel de l’effet physique. Un « esprit léger » est par nature agité et instable, il vole en tout sens, est incapable d’attention soutenue, il est très facilement capté par tout ce qui brille, dans le changement des apparences, autant qu’il peut l’être par le jeu de ses propres émotions. Notons que le terme « léger » n’est pas du tout connoté de façon négative dans notre société actuelle. Par contre, on n’utilise pas le terme « lourd » pour souligner la qualité inverse, car il est péjoratif… trop lié un excès de poids ! On dira aussi : un esprit posé, attentif, capable de diligence dans ce qu’il accomplit, en bref, sérieux. Il est intéressant de regarder du côté du sanskrit. En sanskrit on dit laghucetas pour désigner les esprits légers. laghu est un adjectif qui veut dire léger. Cetas, vient de Cit, la conscience. Quel est le contraire de laghu ? Je vous le donne dans le mille : « guru » ! En fait, le mot guru en sanskrit est un adjectif qui veut dire « lourd », comme substantif, c’est le nom de la planète Jupiter dans jyotish, l’astrologie indienne, c’est aussi le maître spirituel. Ainsi se comprend dans la tradition que le maître est celui qui est « posé », qui est censé avoir un poids de présence, tandis que le disciple est le plus souvent laghucetas, un esprit léger. ... (texte)
---------------1) Partons de ce monde dans lequel nous vivons. Où trouvons-nous la légèreté d’esprit le plus souvent ? J'allume la télévision : annonce d'une prochaine émission : Pom pom girls bronzées en mini short, candidats qui « bougent », déguisés, projetés dans des piscines avec en fond, les cris d'encouragement d'une foule excitée. Coupure de pub : crème de minceur, euros, désir, millions, gagner, acheter, riches, sourires éclatants, vitamines B12 pour la vitalité des enfants, profil d’une nouvelle berline moulée sur la forme d’un dauphin, mer et soleil, filles de rêve, bronzage parfait, le tout en musique, tour à tour charmeuse ou un tantinet rebelle. Nous avons tout loisir de nous laisser absorber dans cette représentation, dans ce défilé d’images qui nous invite à l’insouciance et la légèreté d’esprit. C’est ce que font la grande majorité d’entre nous quand nous parlons de « détente ». Je peux abandonner toute attention et me laisser emporter là-dedans en n’ayant pas plus de pensée et de conscience qu’un courant d’air. Se laisser porter par les images de la publicité, le vent de la mode, le flot des pensées en l’air, des petits potins, des opinions en cours, des rumeurs qui donne un peu de piment à l’existence en éveillant, un moment, l’intérêt avant de passer à autre chose. Cela s’appelle la frivolité.
La légèreté de l’esprit semble avoir d’abord un caractère social et être liée à ce que nous appelons la société de consommation. Mais elle est avant tout un état de conscience qui repose sur une complète identification à des objets, des intérêts qui sont « légers », des petites choses sans grande importance, bref, tout ce qui n’est pas vraiment « sérieux ». Le « on » fonctionne d’abord dans une identification au défilé des représentations. C’est dans l’identification que nous avons cette espèce de fascination pour toutes sortes de sujets légers. Je suis scotché à l’écran et je me laisse emporter dans la griserie des images : la gaieté de la musique, le contrechamp sur la fille splendide qui présente une marque de café, la tentation du désir, la séduction du luxe, de cette vie magnifiquement légère. Du rêve. (texte) De quoi rêver les yeux ouverts. Quand cette représentation est devenue ma conscience, après de longues heures d’absorption, ce que « je pense » n’est que crème de minceur, les euros à foisons, le jeu qui fait gagner des millions, les céréales pour la vitalité, la berline de luxe, la vie sous les cocotiers entre mer et soleil, le jeu de l’insolence et de la provoc… comme dans la pub. « Je pense » est mon contenu mental, je suis glamour, léger (ou légère). Tout ce qui défile sur l’écran et me met benoîtement en extase. - La pensée et son contenu ne sont pas séparables et on ne saurait non plus séparer le mental de ce qu’il pense -. Et puis, ce qui est pratique aujourd’hui, c’est que tout est fait pour que je puisse y rester indéfiniment : il y a des magazines de mode qui sont faits pour cela et dans les magazines réputés sérieux, il y a trois fois plus de pages de publicité que d’articles de fond. On peut donc juste feuilleter sans réfléchir. Si je sors de chez moi, je tombe nez à nez avec les mêmes publicités qu’à la télévision. « Robe légère, prix sexy » titre Elle. Mêmes publicités sur les cartables, les classeurs, les agendas des écoliers et des lycéens. Autour de nous, les images de la légèreté se dupliquent à l’infini. On n’en sort pas et tout nous y ramène. Aucun effort à faire, il suffit de suivre le mouvement, il y a largement de quoi remplir l’esprit. Pour donner du substitut de sens. Et puis, en occident, nous pouvons nous le permettre, la vie est légère et facile pour qui a de l’argent. Au fond, le seul problème, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regardons bien autour de nous. C’est stupéfiant. Jamais une société n’a dépensé autant d’énergie, de ressources intellectuelles, d’argent pour diffuser une manière de vivre légère, sans souci. Une vie extatique, tout dehors. Guy Debord, dans La Société du Spectacle estimait qu’il était indispensable de prolonger la critique sociale du marxisme par la critique de la société de l’image. Le titre de son livre est net : La Société du Spectacle. En effet, quand la vie n’est plus que dans la projection constante dans l’image, elle est comme hallucinée, tout se déréalise, se volatilise dans des images bigarrées. La vie devient aussi légère qu’une feuille au vent. Sans aucune densité, sans poids. Insoutenable légèreté de l'être, selon le titre de Kundera. Une agitation superficielle constamment et savamment entretenue pour le bénéfice des marchands d’illusions qui sont légion autour de nous. L’image, dans sa platitude, son vide ontologique, sa légèreté, sa futilité même, devient le fil conducteur qui relie toutes les productions sociales. D’où le privilège immense accordé à l’apparence, l’exhibition de soi, la vitesse, le changement pour le changement, et la prime accordée par avance à « ce qui en jette », du gadget fluo, à tous les petits trucs qui permettent de marquer une soi-disant différence et son en réalité un conformisme qui entretient la consommation d’objets. Et pas de n’importe quel objet. De l’inutile. Nous vivons aux temps de l’hyperconsommation et de l’inutile, parce que nous sommes aux temps de la boulimie hystérique de la frime. Sans repère ni densité. Légers. Il n’est donc pas étonnant, par exemple, que cette société ait produit de la télé-réalité. N’est-ce pas là que l’on voit de manière éclatante notre mentalité actuelle ?
![]() ---------------2) L’analyse sociale a de la pertinence.
Elle doit être menée. Cependant, elle n’est pas suffisante. Une société ne tient
pas toute seule. Elle repose sur des individus. La conscience collective n’a
aucune réalité si on la sépare de la conscience individuelle. C’est plutôt à
cette conscience que nous devons nous attacher pour la comprendre ensuite
comme phénomène social.
---------------2) L’analyse sociale a de la pertinence.
Elle doit être menée. Cependant, elle n’est pas suffisante. Une société ne tient
pas toute seule. Elle repose sur des individus. La conscience collective n’a
aucune réalité si on la sépare de la conscience individuelle. C’est plutôt à
cette conscience que nous devons nous attacher pour la comprendre ensuite
comme phénomène social.
Plus important encore. Pour pouvoir comprendre ce qu’est la légèreté, je dois en être témoin de manière très lucide, il ne faut pas que je sois jeté dedans. Il faut que je puisse l’observer, que je puisse rester détaché, ne pas y être scotché, et voir. A y regarder de près, la légèreté suppose de l’inconscience, un flottement, une agitation constante de l’attention et l’incapacité d’exercer un regard en profondeur. (texte) Un esprit léger ne parvient pas à s’intéresser vraiment à une question de fond, il décroche aussitôt et prend une attitude distante. Au lieu d’écouter, il va s’exiler dans la rêverie. La légèreté reste en surface, elle flotte dans l’insouciance ; et même, elle entretient une soucieuse indifférence à ce qui déborde le champ de son intérêt. Parce qu’aucune conscience ne peut se délivre d’elle-même, toute conscience existant dans l’état de veille suppose un travail de l’intentionnalité. Il y a toujours le vecteur de l’attention et le mouvement de l’intérêt. Curieusement, on peut aussi dire que la légèreté a son propre sérieux qui concerne un objet, et un objet justement léger. On peut passer une matinée à consacrer toute sa diligence à faire des essayages dans des boutiques de mode. (texte) Le sérieux tourné vers l’objet persiste dans la légèreté. L’objet a une immense importance comme objet du désir. Il a une valeur. Cette valeur qui justifie la poursuite du désir est en réalité plus collective qu’individuelle. L’esprit léger fonctionne de manière mimétique et en ce sens fait comme tout le monde. Il est parvenu à un état de suspension dans lequel il ne se pose aucune question. Il est irréfléchi. Il dépense une quantité immense d’énergie psychique pour éviter de penser réellement. Il fait des efforts pour éviter toute conscience de soi. La frivolité, demeurant dans le domaine de l’objet, suppose aussi une perception très fragmentaire de la vie, coupée de la réalité globale. Le frivole est tout excité autour d’un objet (un nouveau jean, un chemisier « ra-vi-ssant !!!!, un gadget rigolo en plastique, un petit outil informatique fun etc. ») ; il s’exalte devant les petites choses de la consommation qui provoquent sa surprise, qui stimule la différence et donnent envie de se montrer. S’il n’y avait pas de possibilité d’exhibition de soi, tout l’intérêt de l’objet tomberait. Tout est dans la représentation, dans la platitude de la représentation et dans l’image. Il y a plus d’intérêt à pouvoir montrer le dernier cri du téléphone portable qu’à s’en servir. L’important, ce n’est pas le T-shirt, c’est la marque sur le T-shirt. Ce qui compte, ce n’est pas l’utilité du blouson, de la casquette ou des tennis, c’est la marque du blouson ou de la casquette ou des tennis. Ce qui compte, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si d’aventure nous posions la question : « vous vous rendez compte que vous dépensez la moitié de votre salaire dans des fringues ? », ou encore « est-ce que vous savez par qui ces vêtements « made in Taiwan » ont été fabriqué » ? « Cela ne vous dérange pas que ce soit fabriqué par des gamins de douze ans ? » (document) Nous provoquerions une certaine gène. Parce que nous demanderions une perception plus profonde et plus large de l’objet, en laissant tomber la représentation. Mais le consommateur a été dressé contre un telle attaque, il vit dans un bunker idéologique. Avec la multitude des formes de conditionnement publicitaire qui l’entoure, (texte) il lui est très facile d’échapper en permanence à toute interrogation, pour se maintenir dans le jeu ludique de la frivolité. Ce qui est de manière caractéristique une conduite d’évitement de la réalité. En vérité, comme nous l’avions remarqué, (c’est dit dans la publicité) ce que l’on apprend au consommateur c’est se "défoncer" dans la consommation pour « planer » dans des fantasmes. Il faut le comprendre sans détour : nous vivons dans un monde d’illusions qui produit ses propres structures pour se perpétuer lui-même, de sorte que l’illusion devient malgré tout réalité : machine à produire de l’illusion, sous la forme d’une existence fantomatique.
Il est important d’observer autour de nous à quel point notre société mobilise toutes les ressources de l’intellect pour persuader l’homme de masse, le « travailleur de la consommation », (texte) comme dit Günter Anders, de la valeur suprême des objets de la frivolité. C’est un travail de sape constant que de miner l’essentiel avec du superficiel. Il engage tout d’abord de la part du sujet un type de perception hypnotique, qui substitue le réflexe à la réflexion. Il suppose le sabotage de tout ce qui comporterait ne serait-ce que l’ébauche d’une prise de conscience, l’évitement constant du sérieux par la dérision, le détournement systématique de la critique à des fins qui ramène encore et encore vers le profit. L’art de laisser croire à chacun qu’il dispose de son libre arbitre, tout en l’empêchant systématiquement de l’exercer. Il suffit d’écouter les stations FM en direction des jeunes pour le remarquer. « On se mare au sujet des meufs». 90% des programmes de télévision participent de cet esprit et les 10% restant sont mis évidemment en concurrence avec une incitation constante à choisir la facilité et donc à prendre le parti du divertissement. Bref, les moyens de la technique sont investis pour apprendre à tout un chacun à se désinvestir (texte) de tout, à rester dans le léger et le superficiel. La potiche délurée et sans cervelle, et le potache mâcheur de chewing-gum à l’horizon mental confiné dans les limites d’une console de jeux sont très à l’aise dans ce monde ! Il est fait pour eux. Le système de la consommation maintient une mentalité d’ado accro de la consommation. C’est cette légèreté qu’il propose en modèle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Questions:
1. L'insouciance est-elle plus forte que la conscience?
2. En quel sens serions-nous en droit de rejeter notre légèreté sur la société?
3. Ceux qui se forcent à rigoler disent que le sérieux, c'est l'ennui. N'est-ce pas un argument facile?
4. Quelle relation peut-on établir entre la légèreté et l'irresponsabilité? Illustrer.
5. Dans un monde qui vit la tête dans les nuages, faut-il avec Günter Anders, assumer un "devoir d'angoisse"?
6. Faut-il limiter le sérieux à une forme d'engagement?
7. Être sérieux face à la vie, est-ce se donner un rôle ou bien rejeter tous les rôles?
![]() © Philosophie et spiritualité, 2006, Serge Carfantan,
© Philosophie et spiritualité, 2006, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()