Une
société
est composée d’individus, un État fait de citoyens, tous bien sûr
des hommes, mais placés dans des contextes de pouvoir très différents.
Ainsi que Max Weber le reconnaît, l’État possède le monopole de la
violence
légitime, donc une
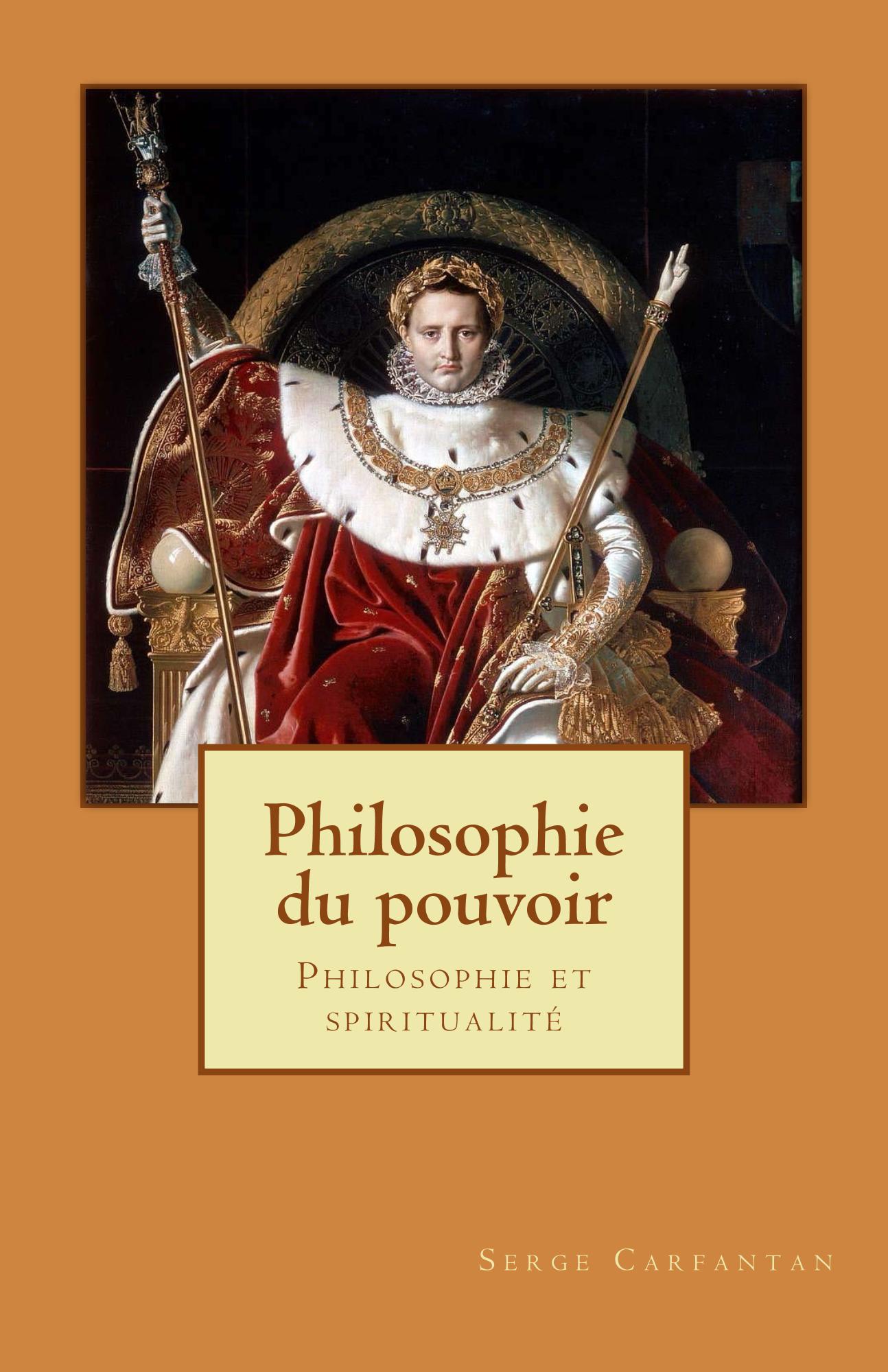 puissance de coercition. Le mystère pour nous, c’est qu’il
puisse exister des sociétés sans État, car nous ne voyons pas comment le pouvoir
d’un chef pourrait être distingué de celui du souverain dans l’État. Comme le
dit Pierre Clastres, (texte) il est de fait exact qu’existe des sociétés sans
État, mais nous sommes à ce point identifiés à nos structures étatique que nous
ne pouvons que penser qu’il doit manquer quelque chose aux sociétés sans
État, le sous-entendu étant qu’elles sont incomplètes. De même, nous ne
pouvons imaginer d’économie que de marché, sans cela, il manquerait
encore quelque chose et l’économie ne serait que de subsistance. Bref, la
société sans État ne serait pas une « vraie » société, une société digne de ce
nom devrait être aussi policée que la nôtre et n’exister que sous la forme de
l’État.
puissance de coercition. Le mystère pour nous, c’est qu’il
puisse exister des sociétés sans État, car nous ne voyons pas comment le pouvoir
d’un chef pourrait être distingué de celui du souverain dans l’État. Comme le
dit Pierre Clastres, (texte) il est de fait exact qu’existe des sociétés sans
État, mais nous sommes à ce point identifiés à nos structures étatique que nous
ne pouvons que penser qu’il doit manquer quelque chose aux sociétés sans
État, le sous-entendu étant qu’elles sont incomplètes. De même, nous ne
pouvons imaginer d’économie que de marché, sans cela, il manquerait
encore quelque chose et l’économie ne serait que de subsistance. Bref, la
société sans État ne serait pas une « vraie » société, une société digne de ce
nom devrait être aussi policée que la nôtre et n’exister que sous la forme de
l’État.
Et si nous étions complètement dans l’erreur sur tous les points? Et si les sociétés sans État s’étaient délibérément érigées pour empêcher l’apparition d’un pouvoir de coercition distinct, devenant au fil des ans presque fatalement l’État tel que nous le connaissons ? Dans les faits (non pas en théorie) comment va-t-on d’une société sans État à la formation de l’État? Dans quel jeu d’équilibre du pouvoir s’établit une société sans État ? Comment une société..
* *
*
Nous avons vu, selon l’analyse de Max Weber dans Le Savant et le Politique, que dans le pouvoir traditionnel, pouvoirs sociaux et pouvoir politiques sont confondus. La coutume se charge de légitimer un ordre des choses qui se perpétue. Le Chef comme le Roi disions-nous incarnent les trois aspects du pouvoir. L’ennui avec cette présentation, c’est qu’elle met dans le même camp le Chef qui effectivement se situe dans un contexte de société traditionnelle et le Roi qui par contre est déjà dans un État. Or la relation de pouvoir n’est pas la même. Faute de documentation anthropologique solide nous en restons à des idées fausses au sujet de la chefferie et de son fonctionnement. C’est tout l’intérêt des recherches de Pierre Clastres que de nous éclairer sur cette question.
...Yanomami, l’histoire du guerrier Fousiwe. Fousiwe était reconnu comme « chef » de son clan en raison du prestige qu’il avait gagné auprès des siens en organisant des raids victorieux contre des tribus ennemies. Tant qu’il dirigeait des assauts voulus par sa tribu, Fousiwe avait l’appui de la société qui le portait. Il mettait alors toute sa force, son courage, son habileté tactique au service des siens. Problème : en temps de paix le prestige acquis dans la guerre se perd très vite. Le chef n’est chef au sens où il possède un pouvoir réel sur ses hommes que pendant la guerre et seulement si cette guerre est voulue par la tribu. « La tribu, pour qui le chef n’est que l’instrument apte à réaliser sa volonté, oublie facilement les victoires passées du chef ». Donc, le Chef pour redorer son prestige doit faire la guerre. « Un guerrier n’a pas le choix : il est condamné à désirer la guerre. C’est exactement là que passe la limite du consensus qui le reconnaît comme chef ». Si son désir de guerre coïncide avec le désir de guerre de la société, celle-ci va le suivre et lui faire honneur dans ses victoires. Mais cette gloire est bien pâle et fragile. Le chef ne peut pas entraîner une société qui veut la paix. « Aucune société, en effet, ne désire toujours faire la guerre ». Si le Chef renverse le rapport qui l’a établi comme Chef en poursuivant des fins individuelles, il n’a aucune chance. Que se passe-t-il si le Chef veut « faire le Chef » de sa propre initiative, comme le roi despote d’un État voulant imposer ses caprices ? S’il veut se lancer dans un conquête personnelle ? Eh bien le résultat n’est pas du tout ce que nous rencontrerions dans un logique de pouvoir étatique. Fousiwe « pour avoir voulu imposer aux siens une guerre qu’ils ne désiraient pas, il se vit abandonné par sa tribu. Il ne lui restait plus qu’à mener seul cette guerre, et il mourut criblé de flèches ».
Geronimo, le Chef Apache. « Geronimo n’était qu’un jeune guerrier comme les autres lorsque les soldats mexicains attaquèrent le camp de sa tribu et firent un massacre de femmes et d’enfants. La famille de Geronimo fut entièrement exterminée. Les diverses tribus apaches firent alliance pour se venger des assassins et Geronimo fut chargé de conduire le combat. Succès complet pour les Apaches, qui anéantirent la garnison mexicaine. Le prestige guerrier de Geronimo, principal artisan de la victoire, fut immense ». _______________________________________________________________________________________________
Mais mis à part le temps de la guerre où le chef gagne un pouvoir de coercition sur ses hommes, qu’est-ce qu’un chef dans une société où le pouvoir ne repose pas sur la coercition ? Il est possible que les deux fonctions soient séparées. « il est remarquable que les traits de la chefferie soient fort opposés en temps de guerre et en temps de paix, et que, très souvent, la direction du groupe soit assumée par deux individus différents, chez les Cubeo par exemple, ou chez les tribus de l’Orénoque : il existe un pouvoir civil et un pouvoir militaire. Pendant l’expédition guerrière, le chef dispose d’un pouvoir considérable, parfois même absolu, sur l’ensemble des guerriers. Mais, la paix revenue, le chef de guerre perd toute sa puissance. Le modèle du pouvoir coercitif n’est donc accepté qu’en des occasions exceptionnelles, lorsque le groupe est confronté à une menace extérieure ».
Il faut maintenant détailler les réponses de Pierres Clastres.(texte) Elles sont remarquables. (texte)
- « Le chef est un « faiseur de paix » ; il est l’instance modératrice du groupe, ainsi que l’atteste la division fréquente du pouvoir en civil et militaire ». « L’autorité des chefs tupinamba, incontestée pendant les expéditions guerrières, se trouvait étroitement soumise au contrôle du conseil des anciens en temps de paix. De même, les Jivaro n’auraient de chef qu’en temps de guerre. Le pouvoir normal, civil, fondé sur le consensus omnium et non sur la contrainte, est ainsi de nature profondément pacifique ; sa fonction est également «pacifiante » : le chef a la charge du maintien de la paix et de l’harmonie dans le groupe. Aussi doit-il apaiser les querelles, régler les différends, non en usant d’une force qu’il ne possède pas et qui ne serait pas reconnue, mais en se fiant aux seules vertus de son prestige, de son équité et de sa parole. Plus qu’un juge qui sanctionne, il est un arbitre qui cherche à réconcilier ».
- Le chef « doit être généreux de ses biens, et ne peut se permettre, sans se déjuger, de repousser les incessantes demandes de ses « administrés » ». (texte) Nous sommes dans la forme d’échange étudiée par Marcel Mauss où le don est la forme première de l’échange. L’ironie ici, c’est que le chef est celui qui donne des cadeau et qui même doit les confectionner parfois. Pierre Clastres y voit encore plus qu’un devoir : « Le second trait caractéristique de la chefferie indienne, la générosité, paraît être plus qu’un devoir : une servitude. Les ethnologues ont en effet noté chez les populations les plus diverses d’Amérique du Sud que cette obligation de donner, à quoi est tenu le chef, est en fait vécue par les Indiens comme une sorte de droit de le soumettre à un pillage permanent. Et si le malheureux leader cherche à freiner cette fuite de cadeaux, tout prestige, tout pouvoir lui sont immédiatement déniés. Francis Huxley écrit à propos des Urubu : « C’est le rôle du chef d’être généreux et de donner tout ce qu’on lui demande : dans certaines tribus indiennes, on peut toujours reconnaître le chef à ce qu’il possède moins que les autres et porte les ornements les plus minables. Le reste est parti en cadeaux. » La situation est tout à fait analogue chez les Nambikwara, décrits par Claude Lévi-Strauss : « … La générosité joue un rôle fondamental pour déterminer le degré de popularité dont jouira le nouveau chef… » Parfois, le chef, excédé des demandes répétées, s’écrie : « Emporté! c’est fini de donner ! Qu’un autre soit généreux à ma place ! » Il est inutile de multiplier les exemples, car cette relation des Indiens à leur chef est constante à travers tout le continent (Guyane, Haut-Xingu, etc.). Avarice et pouvoir ne sont pas compatibles ; pour être chef il faut être généreux ». Cette relation est tout à fait contraire à nos mentalités, car nous pensons plutôt au Roi à la tête d’un État recevant des cadeaux de ses sujets, nous ne voyons pas le travail de lien social qui opère en sous-main. La manière très habile d’interdire ici au chef de posséder. Cette dynamique de l’échange nous échappe. On se souvient de la surprise des Conquistador abordant les rivages de l’Amérique : recevoir des cadeaux des « sauvages » n’avait rien d’unilatéral. Cela voulait dire en retour que les « sauvages » attendaient aussi des dons, comme les armes des Espagnols.
- Enfin, « seul un bon orateur peut accéder à la chefferie ». Immense pouvoir de la parole dans les sociétés traditionnelles, au point que la bonne question à poser dans un village n’est pas « qui est le chef ? », mais plutôt « qui parle ? ». Mais quel est le sens de cette parole ? Est-ce l’art de commander de haut ? Pas du tout. Elle est avant tout rituelle. Elle lie la tribu aux anciens en rappelant leur sagesse : vivons comme nos aïeux ! Le plus étrange c’est aussi la manière dont elle est entendue : « Presque toujours, le leader s’adresse au groupe quotidiennement, à l’aube ou au crépuscule. Allongé dans son hamac ou assis près de son feu, il prononce d’une voix forte le discours attendu. Et sa voix, certes, a besoin de puissance, pour parvenir à se faire entendre. Nul recueillement, en effet, lorsque parle le chef, pas de silence, chacun tranquillement continue, comme si de rien n’était, à vaquer à ses occupations. La parole du chef n’est pas dite pour être écoutée. Paradoxe : personne ne prête attention au discours du chef. Ou plutôt, on feint l'inattention. Si le chef doit, comme tel, se soumettre à l'obligation de parler, en revanche les gens auxquels il s’adresse ne sont tenus, eux, qu’à celle de paraître ne pas l’entendre. Et, en un sens, ils ne perdent, si l’on peut dire, rien. Pourquoi ? Parce que, littéralement, le chef ne dit, fort prolixement, rien. Son discours consiste, pour l’essentiel, en une célébration, maintes fois répétée, des normes de vie traditionnelles : « Nos aïeux se trouvèrent bien de vivre comme ils vivaient. Suivons leur exemple et, de cette manière, nous mènerons ensemble une existence paisible. » Voilà à peu près à quoi se réduit un discours de chef. On comprend dès lors qu’il ne trouble pas autrement ceux à qui il est destiné. Qu’est-ce qu’en ce cas parler veut dire ? Pourquoi le chef de la tribu doit-il parler précisément pour ne rien dire ? À quelle demande de la société primitive répond cette parole vide qui émane du lieu apparent du pouvoir ? Vide, le discours du chef l’est justement parce qu’il n’est pas discours de pouvoir ». (texte) Le discours du chef n’est pas...
La société primitive est si méfiante envers le pouvoir coercitif et sa violence qu’elle a très ingénieusement limité son exercice. Elle ne veut pas de pouvoir séparé et sait très bien qu’elle est elle-même le lieu réel du pouvoir. Elle a donc contraint le chef à se mouvoir uniquement sur le terrain de la parole, donc à l’opposé de la violence. Le résultat imparable c’est que de cette manière la tribu s’assure que l’ordre social ne sera pas modifié. Elle a fait en sorte que l’homme de parole ne puisse pas devenir un homme de pouvoir. (texte) La société doit faire en sorte que le pouvoir lui appartienne et soit toujours encadré quand la situation exige qu’il soit coercitif.
------------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
![]() ©
Philosophie et spiritualité, 2015, Serge Carfantan,
©
Philosophie et spiritualité, 2015, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()