Pour la plupart d’entre nous, le domaine de la finance est très nébuleux. C’est devenu un tel imbroglio qu’il vaut mieux dire franchement que nous n’y comprenons rien. L’admettre, c’est au moins commencer à se poser des questions. Autant aborder le problème avec une certaine naïveté, comme Socrate, pour exiger ensuite des éclaircissements satisfaisants.
Qu’est-ce
qui fait que la question est si confuse ? La finance repose sur la
monnaie. Or déjà la notion de monnaie n’est
pas claire. D’un côté en effet, ce que nous utilisons dans nos
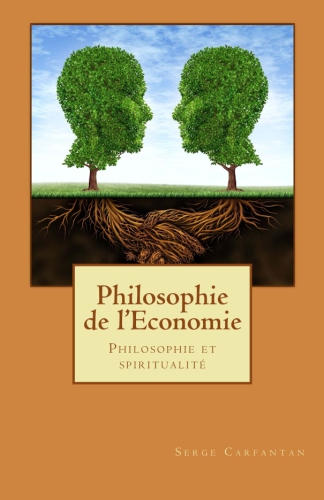 billets de banque
est étrangement abstrait. Un billet,
c’est du papier. Une page de magazine de mode, vaut en général plus cher à
l’impression qu’un billet de banque. Nous savons tous que le billet ne
vaut que parce qu’il représente une certaine somme d’argent. On se
sécurisait autrefois en pensant que la liasse peut être convertie en lingots d’or. Mais en
fait l’idée est archaïque. L’or n’est pas un référent absolu. (R) Il est lui-même évalué. Dans
la sphère de la finance aujourd’hui les mécanismes de régulation de la monnaie
sont complètement opaques. Il est très difficile de répondre à la question de
savoir ce que « vaut » un billet.
billets de banque
est étrangement abstrait. Un billet,
c’est du papier. Une page de magazine de mode, vaut en général plus cher à
l’impression qu’un billet de banque. Nous savons tous que le billet ne
vaut que parce qu’il représente une certaine somme d’argent. On se
sécurisait autrefois en pensant que la liasse peut être convertie en lingots d’or. Mais en
fait l’idée est archaïque. L’or n’est pas un référent absolu. (R) Il est lui-même évalué. Dans
la sphère de la finance aujourd’hui les mécanismes de régulation de la monnaie
sont complètement opaques. Il est très difficile de répondre à la question de
savoir ce que « vaut » un billet.
D’un autre côté, pour la plupart des gens, l’argent c’est très concret. Pour dire tout haut ce beaucoup pensent tout bas : « l’argent, c’est la valeur suprême, le moteur qui mène le monde. Il y a ceux qui ont réussi, qui ont beaucoup d’argent et qui peuvent se payer une vie de luxe, de facilité. Et puis, il y a le loser, celui qui n’a pas d’argent et qui vit dans la misère. Bref, avec l’argent, on peut tout avoir et sans argent on n’est rien ». (!) Là, on est plus dans l’abstraction. Comment en effet, la valeur la plus matérielle pourrait-elle être une abstraction ?
La question deviendrait nettement plus claire si nous disions que l’argent n’est qu’un intermédiaire de l’échange entre des biens et des services équivalents. Comme le troc est malcommode, il est plus facile de déterminer le rapport entre la paire de sandales et la cagette de salades par un chiffre et d’utiliser une monnaie pour faire la transaction. C’est de bon sens. Mais c’est justement raisonner en éliminant la sphère de la finance telle qu’elle opère dans le monde, se placer dans l’idéal et pas dans les faits. Ce qui ne nous aide toujours pas à comprendre. Il faut donc reprendre le problème à neuf. Quelle est la place de la sphère de la finance dans l’échange ?
* *
*
Commençons pas clarifier l’idée de monnaie. Si les hommes utilisent de la monnaie, c’est parce qu’ils échangent entre eux. La monnaie sans échange n’a aucun sens. Elle est là pour faciliter l’échange en permettant de transformer la valeur qualitative d’un objet, d’un service, en une valeur quantitative ; de sorte que deux individus puissent échanger de manière plus rationnelle des objets de nature différente ce que chacun d’entre eux est capable de produire ou de créer.
1) La première idée de monnaie a un rapport étroit avec la fluidité de l’échange, nous pourrions même dire : la circulation de la Vie. La seconde idée est indépendante : elle introduit le concept d’un calcul de l’intellect pour établir un rapport. Nous ne pouvons pas accuser ici l’argent d’être un facteur de corruption. Même dans le troc l’échange peut être très injuste, s’il y a une très grande disproportion entre ce qui est échangé, ce qui reviendrait à une escroquerie manifeste. Non, on ne peut pas dire une salade = une paire de sandale ! Ce n’est pas juste ! La proportion n’est pas respectée (texte). Notons, comme l’avait bien compris les grecs, que le premier concept de justice se situe bien dans les choses et est associé avec l’égalité proportionnelle. La troisième idée, c’est qu’il faut faire correspondre un nombre à chaque élément de l’échange, ce qui évitera le flottement du qualitatif et fera passer l’échange dans le domaine économique. De cette manière, l’idée de proportionnalité devient plus précise. La quatrième idée, c’est qu’il devient nécessaire d’admettre au sein de la conscience collective, la convention par laquelle les hommes accepteront l’usage d’une monnaie qui matérialisera l’évaluation mathématique. La reconnaissance de la valeur de la monnaie est purement conventionnelle. On peut parler de contrat implicite en un sens. Nous avons vu précédemment pourquoi la société humaine était conventionnelle, ce qui voulait dire qu’elle n’est pas naturelle, mais fondée sur le langage. (texte) Nous pouvons dire dans le même sens que l’argent est conventionnel et donc artificiel. On peut utiliser n’importe quel support à cette fin. Si le rapport entre la paire de sandale et la salade est de 150, donnons à l’artisan 150 coquillages, ou 150 grains de sel ou 150 rondelles de cuivre, ou des rectangles de papier avec marqué « 100 », « 50 ». C’est une question de convention passée entre nous. Il est même possible de conserver en externe les rectangles de papier appelés « billets » et en interne (au village) de garder les grains de sel pour les services mutuels que se rendent les gens. Pas de problème. Ce sera aussi fonctionnel. Notons le langage : on parle de monnaie fiduciaire, (du latin fides, la confiance). En anglais, on dit fiat money, « monnaie décrétée ». L’ancien assignat n’a que la valeur qu’on lui assigne. (document) Aristote faisait dériver nomisma, la monnaie, de nomos, la loi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dans ces conditions, l’argent peut devenir un instrument de pouvoir, puisqu’il représente une relation d’obligation entre individus. Historiquement, le pouvoir politique s’est très vite arrogé le droit de battre la monnaie. La symbolique du pouvoir s’est retrouvée sur l’effigie des pièces de monnaie : celle du roi, de l’empereur etc. Cependant, la crédibilité de la monnaie ne peut pas venir de l’argument d’autorité. Il faut qu’elle soit garantie. D’où l’idée simple d’une correspondance avec un équivalent de métal précieux. La contrepartie or. Historiquement, seules les banques reçurent le privilège d’émettre des billets. La Banque centrale sous Napoléon devait posséder pour chacun des billets émis la garantie or correspondante. Nous avons vu que par définition l’État possède le monopole de la législation sur son territoire. L’État apportait sa caution d’autorité à la monnaie. Or à partir du moment où l’État possédait le monopole du contrôle de l’argent, il devenait possible de se passer de la garantie or, ce qui permettait aux États d’émettre plus de monnaie que ne l'autorisait la contrepartie physique en métaux précieux déposée dans les banques centrales. Seulement, dans le contexte actuel, il faut bien comprendre que dans les pays développés, les États sont en fait dépossédés du pouvoir monétaire ! Ce sont les banques centrales qui se chargent de la régulation de la monnaie. Nous allons devoir suivre cette piste plus loin.
2) Les distinctions fondamentales ne datent pas de la période moderne, elles apparaissent très tôt dans la pensée économique chez Aristote. Aristote explique en effet que la monnaie n’est pas la condition de l’échange, car celui-ci existe avant la monnaie dans le troc. Pourtant c’est « par nécessité » que les hommes sont passés du troc à la monnaie. Elle est en effet un méson, un milieu intermédiaire pour l’échange. Le lien avec son caractère conventionnel est facile à repérer. Aristote appelle symbole le signe linguistique. Or, justement, le symbolon, était à l’origine une pièce de monnaie cassée en deux, que se partageaient deux amis, ce qui permettait d’avoir un moyen de reconnaissance pour ne pas avoir affaire à un étranger. Le signe linguistique est conventionnel. La monnaie l’est aussi. Elle est un simple moyen de convertir dans l’échange une chose en une autre. Ainsi, le langage, comme la monnaie, ont une fonction de lien permettant d’orchestrer l’échange de différences, dans le contexte qui leur est propre. Mais ce qui est plus spécifique de la monnaie, c’est d’être aussi métron, une mesure. Elle permet d’exprimer le rapport réciproque de produits, sur le plan des choses. D’un point de vue qualitatif, il existe une hétérogénéité complète dans le réel, ce qui rend les choses incomparables les unes aux autres, ou encore, incommensurables. L’évaluation économique suspend l’hétérogénéité, et elle applique une proportion arithmétique ; ce qui fait qu’en définitive, une chose devient exprimable dans une autre. « Appelons par exemple une maison A, dix mines B, un lit L. Alors A est moitié de B si la maison vaut cinq mines, autrement dit est égale à cinq mines, et le lit est la dixième partie de B : on voit tout de suite combien de lits équivalent à une maison, à savoir cinq ». La monnaie permet de transformer la qualité en quantité et ainsi de la rendre numéraire. Toutefois, il faut se garder de tout fétichisme de la monnaie. De même que le nombre n’est pas les choses qu’il permet de compter, la monnaie n’est pas la valeur de ce qu’elle évalue, elle n’en n’est que l’expression. En bref, la monnaie n’a pas de valeur en elle-même. Elle ne fait que représenter la valeur. On peut dire que la monnaie est mesure de toutes choses, mais à condition de ne pas se laisser abuser par la représentation : à condition de ne jamais oublier que cette mesure, elle ne fait que la recevoir et la redéployer dans l’échange.
Il faut rester les pieds dans le réel. Dans l’échange, les choses, les œuvres, les marchandises, ne s’évaporent pas pour se transformer en monnaie. Pour en exprimer la raison dans un couple de concepts aristotélicien, on dit que la chose n’est qu’en puissance (R) dans son prix. Elle n’existe en acte qu’en elle-même de par sa nature propre. Le prix c’est du virtuel, pas du réel. Le réel, c’est la nature de la chose dans sa donation qualitative. Aussi pouvons-nous apprécier infiniment la richesse du monde sensible qui nous est offert, tout en gardant conscience que sur le plan sensible et vivant, les choses n’ont pas de prix. Il y a même des cas où la nature véritable d’une chose ne peut pas être virtualisée sous la forme d’un prix. L’exemple que donne Aristote est celui de la Connaissance. « Science et richesse n’ont pas de commune mesure ». La Connaissance a une si haute valeur qu’elle n’a pas de prix. Souvenons-nous de la différence d’attitude entre Socrate et les sophistes sur la question de faire payer l’éducation. En ce qui concerne l’Enseignement, un prix payé, n’importe lequel, serait de toutes façons injuste, puisque les termes échangés seraient de très loin incommensurables. C’est pourquoi il est nécessaire, pour comprendre ce type d’échange, de quitter le terrain strictement économique pour se placer sur celui du don. Le don est la seule manière de rendre justice à une valeur au sens le plus élevé du terme.
Aristote donc ne condamne pas la monnaie, il en justifie la nécessité, de même, il ne condamne pas non plus le commerce dont il justifie aussi la nécessité. Ce sur quoi il insiste, c’est le fait que la valeur réside avant tout dans l’œuvre. Le commerçant qui prend le risque d’acheminer par mer une cargaison de blé de Sicile vers le Pirée doit être considéré comme producteur d’une œuvre, ergon, au même titre que le maçon et le cordonnier, pris comme exemples dans les textes. Notons aussi que le terme d’ergon, œuvre, ne désigne pas ici seulement une chose, la sandale ou la maison, mais aussi un service. Ainsi le médecin qui contribue à la santé produit une œuvre (on dirait aujourd'hui de la valeur). Il est même dans une position idéale dans l’échange social, (cf. Ethique à Nicomaque texte) car nous pouvons tout à fait parler d’échange de services entre médecin et paysan. De même, nous ne saurions concevoir dans un monde ouvert un isolement complet des Cités et Aristote, tout en gardant à l'esprit l'idéal de l'autarcie, admet aussi clairement l’importance du commerce extérieur.
Où la position d’Aristote devient critique, c’est précisément sur la possibilité que naisse dans l’échange une forme d’activité qui ne soit plus une œuvre, qui ne produise rien et n’offre pas non plus de réel service, mais se contente d’acheter bon marché et de revendre plus cher. A côté du commerce sain, fondé sur le plan des choses, qui distribue de la prospérité, il y a une forme de commerce suspecte exclusivement fondée sur l’argent.
----------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Questions :
1. En quel sens la monnaie est-elle actuellement inséparable de la dette?
2. Est-ce l’argent qui corrompt ou bien le fait que toute l’avidité humaine s’est cristallisée en lui ?
3. Qu’est-ce que le fétichisme de la monnaie?
4. En quoi l’usure produit-elle l’illusion de la richesse ?
5. La marchandisation du monde est-elle une conséquence de la spéculation?
6. Comment comprendre cette formule « l’économie a pris le pas sur la politique »?
7. Comment pourrait-on distinguer une crise conjoncturelle d’une crise systémique?
© Philosophie et spiritualité, 2007, Serge Carfantan, Eric Fricot.
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()