« A quoi bon
étudier les textes du passé ? Ils étaient bons pour leur époque, mais
aujourd’hui, on en sait bien plus, ils sont dépassés ». Remarque banale et
exemple caractéristique de relativisme. En l’occurrence ici le
relativisme historique. Le relativisme
est une attitude ou une doctrine qui dénie une valeur absolue (R)
à son objet. Il consiste à soutenir que
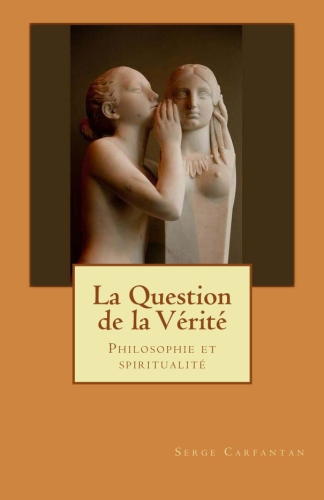 nos opinions, nos idées n’ont pas en soi
de valeur, mais sont seulement « relatifs » à quelque chose d’autre: une période
historique, une culture, des goûts, des dégoûts ou des humeurs personnelles etc.
Nous avons vu précédemment le relativisme
esthétique en matière de beauté qui se décline en relativisme
subjectif, relativisme
historique et relativisme
culturel. Le relativisme est une
attitude si répandue qu’il est très facile de le repérer, car il se réplique
partout, dans le domaine de la politique, de la science, de la morale, de la
philosophie ou de la religion. C’est aussi une tendance caractéristique de la
postmodernité qui est marquée par un
relativisme complet des
valeurs.
nos opinions, nos idées n’ont pas en soi
de valeur, mais sont seulement « relatifs » à quelque chose d’autre: une période
historique, une culture, des goûts, des dégoûts ou des humeurs personnelles etc.
Nous avons vu précédemment le relativisme
esthétique en matière de beauté qui se décline en relativisme
subjectif, relativisme
historique et relativisme
culturel. Le relativisme est une
attitude si répandue qu’il est très facile de le repérer, car il se réplique
partout, dans le domaine de la politique, de la science, de la morale, de la
philosophie ou de la religion. C’est aussi une tendance caractéristique de la
postmodernité qui est marquée par un
relativisme complet des
valeurs.
En toute logique, celle de la dualité, le contraire du relativisme, c’est l’absolutisme. Il consiste à soutenir qu’il y a des valeurs absolues, par exemple, un Bien ou un mal absolu, une Beauté, un Pouvoir, une Culture, des Valeurs, une Volonté, un Goût etc. absolus et donc non relatifs.
Et si on persiste dans cette logique duelle en admettant le principe du tiers exclus, (texte) alors, c’est tout l’un ou tout l’autre et il n’y a pas de milieu : si vous êtes partisans du relativisme, vous être en guerre contre l’absolutisme et réciproquement, si vous campez dans l’absolutisme, vous êtes en guerre contre le relativisme. Ce qui est source de bien des affrontements stériles. En fait, l’ennui avec le relativisme, c’est qu’il renvoie à une très grande complexité et qu’il est très difficile de démêler dans les faits où il possède une pertinence et où il n’en n’a pas. C’est d’ailleurs à se demander si ce n’est pas seulement une attitude polémique. Le relativisme est-il une doctrine ou une attitude ? Dans quelle mesure peut-il être soutenu sans contradiction et dans quels domaines ?
* *
*
Il est important pour commencer de bien marquer la différence entre une attitude relativiste qui est irréfléchie et dilettante en matière de vérité, d’un relativisme qui serait réfléchi et aurait ses raisons.
1) Quand on n’a pas d’autre identité que celle de consommateur, on finit par n’avoir de la relation à la vérité que sur le mode « je prends ce qui me plaît et je vais d’une boutique à l’autre », sauf qu’ici les boutiques seraient les auteurs. On finit par considérer les idées comme des articles de supermarché : vous prenez ce que vous voulez sur l’étalage, c’est au choix et à chacun ses goûts ! « A chacun ses opinions » est une formule qui a une résonance très commerciale, elle évoque la liberté de choix dans une grande variété d’options. Pour faire les courses quand on a de l’argent, on peut aller le nez en l’air et acheter de manière écervelée, sans réfléchir ; et bien, sur le plan de la pensée, on peut faire de même : prendre une idée çà ou là et remplir le caddy de « mes opinions » histoire d’avoir quelque chose à dire dans la conversation. C’est ce qui justifie le recourt au prêt-à-penser ambiant dans lequel chacun peut piocher n’importe quelle idée… alors qu’en réalité tout le monde s’en fout. Le relativisme postmoderne est en fait porté par une complète indifférence à l’égard de la question de la vérité, pour une raison toute simple : il procède du culte de l’ego et il alimente le narcissisme. S’il n’y a que « moi » qui m’intéresse, je ne peux évidemment pas m’intéresser à la vérité qui est toujours au-delà de « moi, moi » ; ou bien, et cela revient au même, je fais de la vérité, un attribut de « moi, moi » : donc « mes opinions », que je peux choisir comme mon polo, mon jean ... et conditionnés pour ne penser qu’en consommateurs, il ne faut s’étonner que le relativisme soit si répandu. Au risque de me répéter : le consommateur, il ne pense pas, il dépense. L’ébriété consommative, c’est le degré zéro de la réflexion, la non-pensée du consumérisme ambiant. Ainsi, l’individu formaté dans cette Matrice, comme le dit Günter Anders, (texte) ne fait qu’ondoyer… dans le courant du « on », dans le flux mouvant et bigarré de l’opinion. (texte) Et l’emprise est si forte que l’éducation ne parvient que rarement à l’en extraire.
_____________en contexte de crise, c’est de force que l’individu finit par s’extraire de l’hypnose ambiante. Il commence à faire un pas en retrait de l’illusion. Quand il en a marre d’être traité comme un veau, le consommateur devient citoyen. Le citoyen se rend bien compte que tous les choix ne s’équivalent pas, qu’il y a des opinions fausses, dangereuses, ou carrément toxiques. Il se rend bien compte que le sous-entendu du relativisme « tout se vaut » conduit à des absurdités. Non, il y a des choix qui sont meilleurs pour l’humanité à venir et d’autres qui sont moins bons, des affirmations qui sont des contrevérités manifestes, des opinions qui ne sont pas des « options », mais des intentions trompeuses ou manipulatrices. Sans discernement, le « tout est relatif » mène à la soupe à l’égout du « tout se vaut ». On peut comprendre que dans le monde de la consommation, le souci exclusif du profit trouve avantage dans le manque de discernement et même qu’il puisse chercher à le provoquer. Cela fait partie de la guerre économique, qui est toujours une guerre de l’esprit contre l’intelligence. Après tout un esprit confus est bien plus malléable et plus facile à séduire.
Mais nous avons notre esprit frondeur, notre fierté politique et notre goût de l’indépendance. Rien que pour cela, nous n’aimons pas les généralisations hâtives et irresponsables, les tirades verbeuses, les insinuations, les sous-entendus dans lesquels s’égare souvent le relativisme. Nous ne pouvons que souhaiter que les êtres humains cheminent dans le discernement dans une conscience plus élevée, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas sciemment encourager un relativisme généralisé et irréfléchi, car il mène droit à la confusion. A une dilution totale de la vérité dans les eaux mêlées de l’opinion - ce qui est l’opposé du discernement. L’éducation à la citoyenneté enveloppe nécessairement une éducation au discernement. Ou alors elle ne veut plus rien dire. Cela veut dire que si nous avons de vraies convictions, cela ne peut être au petit bonheur en faisant nos emplettes en ce qui concerne nos idées à la télé, ni en tirant profit de l’argument d’autorité (quand on en a besoin) ou du consensus d’opinion (quand c’est utile). Il faut bien se poser la question de savoir ce qui est vrai et le distinguer de ce qui est faux et pas se contenter du vague et du blabla du « tout est relatif ».
2) Ceci dit, le relativisme, en tant qu’attitude réfléchie cette fois, se défend et il se défend surtout en invoquant une raison qui est la tolérance. En effet, il n’y a rien de plus arrogant que l’attitude de l’absolutisme ; en matière de prétention et d’intolérance, on ne peut guère faire mieux. Le relativisme passe alors pour son antidote le plus efficace.
L ccepter qu’un autre n’aime pas les épinards. Par contre je ne serai pas d’accord s’il affirme de manière péremptoire que les épinards c’est « mauvais » dans l’absolu, non c’est seulement mauvais pour celui qui ne les aime pas et c’est tout. Ce n’est pas mauvais dans l’absolu. « Bon » et « mauvais » sont relatifs au sujet qui fait l’expérience. Le principe de la tolérance s’applique ici dans la reconnaissance qu’il existe une variété de goûts, il dit que je dois accepter cette diversité comme tel, sans chercher à établir une quelconque hiérarchie. Ce qui est une formulation très claire du relativisme. En bref, dans un domaine qui ne met en jeu que des préférences individuelles, chacun peut avoir ses propres opinions, les opinions se valent et il est inutile d’argumenter.
b) Dans le champ d’une culture, par rapport à une autre culture aussi. Dans l’exemple précédent nous invoquions la prévalence de l’ego dans le goût, mais le goût est aussi très largement déterminé collectivement par des habitudes. Le goût est largement une affaire de culture, donc en quelque sorte d’ego collectif. La plupart des Occidentaux seront très rétifs à manger des vers blancs et des insectes comestibles et pourtant ils mangeront des crevettes. Même si on insiste pour dire que les grillons sont délicieux et ont une forte valeur nutritive, l’Occidental refusera d’en manger. Question de conditionnement culturel. Lévi-Strauss, nous l’avons vu, a montré qu’en matière de culture, l’ethnologue doit partir du relativisme. On ne peut pas dire que l’africain a « absolument » tort de manger des insectes, pas plus que le français a raison de manger du lapin ou des escargots. Le relativisme culturel consiste à dire que l’humanité se conjugue au pluriel, chaque culture a ses propres normes. Il est vain de vouloir hiérarchiser dans l’absolu les différences et la tolérance demande de les accepter comme telles. L’esprit du colonialisme, l’impérialisme occidental ont prétendu montrer la supériorité de la civilisation occidentale sur les civilisations dites « primitives ». De cet absolutisme a résulté non seulement un ethnocentrisme étroit, stupide et méprisant, mais aussi et surtout, la justification du racisme sous toutes ses formes. Et avec ce cocktail, on a conduit l’extermination des peuples et des cultures traditionnelles un peu partout sur la planète. Le mérite du relativisme est ici de nous rappeler qu’après tout, la civilisation occidentale n’est qu’une civilisation parmi d’autres et rien ne prouve qu’elle soit meilleure, si ce n’est la conviction fanatique de ses représentants.
c) Si nous avons fait la Révolution en 1789, c’était pour renverser l’absolutisme en matière de politique. (texte) Nous ne supportons plus l’idée qu’un individu, fusse-t-il monarque de droit divin, puisse selon son bon vouloir prétendre décider de la volonté d’un peuple. L’histoire à choisi de suivre Rousseau contre Hobbes ; elle a vu le déclin de la monarchie et la montée de la démocratie. Dans la confiance qu’il accorde à la volonté des peuples, dans la légitimité de la majorité des voix, on voit bien que l’idéal de la démocratie accepte un certain relativisme. Nous soutenons que les droits d’un citoyen sont relatifs à ceux d’un autre citoyen, nous acceptons une majorité relative ; nous refusons que la volonté générale soit confisquée pour les intérêts de quelques uns, ou d’une classe, nous cherchons à protéger les libertés individuelles et il nous semble normal qu’un régime politique garantisse le droit à une diversité d’opinions.
d) La Modernité s’est aussi construite en Europe en portant des coups sévères à l’absolutisme en matière de religion. Les Lumières ont lutté pour la tolérance en prônant clairement un relativisme en matière de croyances. Il faut dire que l’histoire du christianisme a été suffisamment sanglante, l’absolutisme y est devenu inquisition. Nous admettons que l’idée qu’une seule religion possèderait le monopole de la vérité sur Dieu ou sur nos origines est fortement suspecte et qu’un bon régime politique doit pour être vivable accepter un relativisme, en matière de croyances, chacun gardant le droit de suivre les voies qui sont les siennes. Le relativisme est tolérant, il accepte sans difficulté la diversité des cultes, comme il accepte l’incroyance.
e)
----------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Questions:
1. Quelle relation y a-t-il entre relativisme et nihilisme?
2. L'attitude de la critique systématique, la philosophie à coup de marteau, combat-elle ou favorise-t-elle le relativisme?
3. Peut-on fonder la politique sur le relativisme?
4. En quoi l'esprit religieux ne peut-il admettre le relativisme?
5. Que veut dire cette expression "le relativisme des valeurs"?
6. N'y a-t-il pas un fondement psychologique du relativisme?
7. Peut-on dénoncer une erreur manifeste, sans pour autant s'estimer en possession de la vérité?
![]() ©
Philosophie et spiritualité, 2010, Serge Carfantan,
©
Philosophie et spiritualité, 2010, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()