Nous avons déjà abordé le thème de la démocratie, mais les débats actuels ont mis en exergue des points nouveaux qui méritent une analyse approfondie, notamment, nous allons le voir, dans la lignée des critiques de Castoriadis. Dans cette leçon nous allons prolonger de ce qui précède, pour rendre compte notamment des recherches sur la démocratie menées par Etienne Chouard.
Nous avons
vu en quoi la démocratie était un régime politique
tout à fait singulier, dans
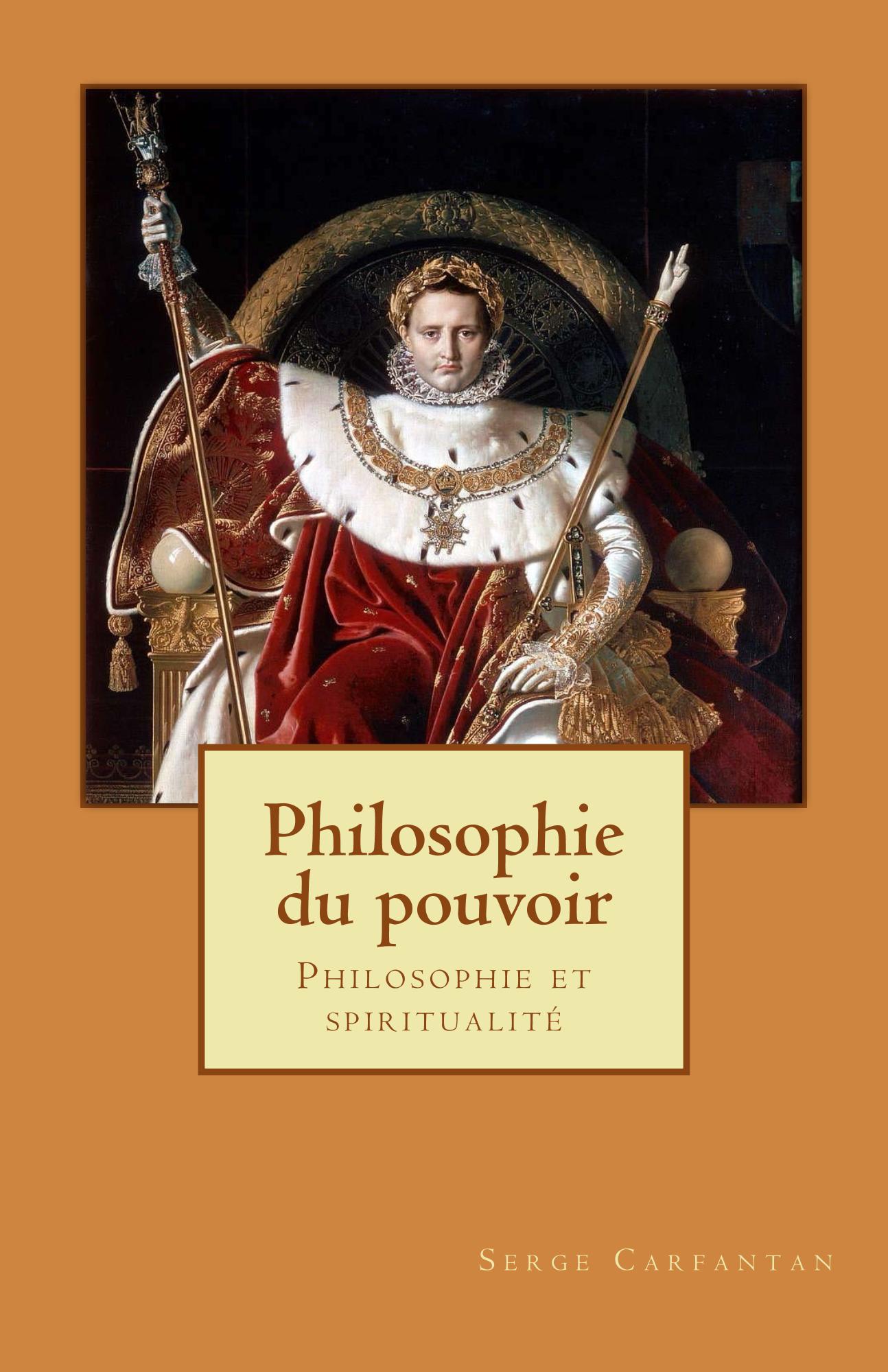 lequel le
kratos, le pouvoir
était exercé par le demos,
le peuple. C’est ce que dit la définition. Reste à savoir si on entend par là le
régime actuel, qui existe un peu partout dans les États
prétendument démocratiques, ou bien si c’est un régime qui a un sens,
mais n’est pas véritablement réalisé à l’heure actuelle. Dit autrement,
si nous nous posions la question : vivons-nous véritablement en démocratie ? Que
faudrait-il répondre ? On nous répète du matin au soir et de la
maternelle à l’Université que nous vivons ne démocratie mais justement, une incantation si souvent
relancée peut éveiller quelques soupçons.
Peut-être que l’opinion est
entretenue dans l’idée que nous vivons en démocratie, mais qu’en réalité ce
n’est pas le cas. Jacques Ellul disait que c’est quand on répète un mot
désignant une valeur tout le
temps dans les médias, c'est que justement la chose en question n’existe plus (texte).
lequel le
kratos, le pouvoir
était exercé par le demos,
le peuple. C’est ce que dit la définition. Reste à savoir si on entend par là le
régime actuel, qui existe un peu partout dans les États
prétendument démocratiques, ou bien si c’est un régime qui a un sens,
mais n’est pas véritablement réalisé à l’heure actuelle. Dit autrement,
si nous nous posions la question : vivons-nous véritablement en démocratie ? Que
faudrait-il répondre ? On nous répète du matin au soir et de la
maternelle à l’Université que nous vivons ne démocratie mais justement, une incantation si souvent
relancée peut éveiller quelques soupçons.
Peut-être que l’opinion est
entretenue dans l’idée que nous vivons en démocratie, mais qu’en réalité ce
n’est pas le cas. Jacques Ellul disait que c’est quand on répète un mot
désignant une valeur tout le
temps dans les médias, c'est que justement la chose en question n’existe plus (texte).
La difficulté majeure dans ce questionnement est le statut exact de la représentation politique. On nous dit que nous vivons dans une démocratie représentative, On l’oppose d’ordinaire à la démocratie directe où les citoyens participeraient activement aux décisions publiques. Et si c’était déjà un glissement de sens ? Nous pourrions aussi bien penser que par essence la démocratie doit être directe, ou bien ce n’est plus vraiment le peuple qui gouverne, auquel cas parler de « démocratie directe » serait un pléonasme. La démocratie est directe ou bien ce n’est plus la démocratie et dans ce cas il faut s’inquiéter très sérieusement des dérives auxquelles nous conduisent toutes les formes de représentation. Nous voyons bien dans les « affaires » que les soi-disant représentants du peuple finissent souvent par ne représenter qu’eux-mêmes, des intérêts de classe ou les intérêts des puissances de l’argent. (texte) Autant jeter le mot en trompe-l’œil de démocratie et tout de go dire la vérité : contrairement à ce que l’on veut nous faire croire, nous ne vivons pas en démocratie aujourd’hui, nous vivons dans une oligarchie, ou encore, dans une ploutocratie. En quoi la représentation politique est-elle pour la démocratie un problème et non une solution?
* *
*
Rappel : une re-présentation, c’est une présentation seconde par rapport à la présentation première de la chose même, et non la chose même qu’elle re-présente justement avec laquelle il ne faudrait pas la confondre. Si je me présente devant le tribunal pour donner des explications, ce n’est pas comme si je me faisais représenter par un avocat chargé de me défendre par les moyens du droit. En tout état de cause, on attend d’une représentation qu’elle exprime au mieux ce dont elle est la délégation, qu’elle soit fidèle et non qu’elle déforme. Une représentation serait trompeuse si, non seulement elle ne portait plus rien de ce dont elle devrait être le porte parole, mais qu’elle en venait à représenter tout à fait autre chose. Concrètement, en quoi consiste la représentation politique ?
1) Surtout ne confondons pas ce qui devrait être avec ce qui est. ... extrêmement fréquent chez les intellectuels qui a un effet dissolvant du sens de l’observation, ou tout simplement du bon sens. ...
L’État moderne est une organisation gigantesque qui comporte un corps de fonctionnaires de compétences diverses, avec à leur tête des décisionnaires qui sont les représentants élus. Écartons tout de suite les jugements à l’emporte-pièce qui font le jeu des extrémistes : l’argument des « tous pourris » qui veut mettre dans le même sac tous les acteurs du corps politique. Il y a des gens dévouées et sincères dans la classe politique, des personnes qui ont un souci d’intégrité de leur fonction et qui déploient une énergie formidable pour faire au mieux ce pour quoi ils se sentent missionnés. La recherche du bien commun et le service de la volonté générale. On remarquera cependant qu’on les trouve plus facilement à une échelle très modeste, locale, et dans des postes qui relèvent quasiment du bénévolat. Le maire d’une petite commune, les conseillers municipaux. Il existe des gens bien, des gens de bien au service des autres et c’est magnifique. Mais dès que l’on monte dans l’échelle du local vers le global et le national, cela se corse et l’argent occupe une place de plus en plus prépondérante. C’est un fait. Soyons honnêtes et regardons les choses en face : partout dans le monde dans ce que nous appelons les « démocraties », le pouvoir se constitue comme une élite à part, qui tend à se détacher pour faire société avec elle-même, et tourner en vase clos, se retrouver dans les mêmes cercles, et toujours en connivence étroite avec le monde de l’argent. Insensiblement, on passe du pouvoir avec les hommes à un pouvoir sur, qui ne vaut alors par les avantages qu’il procure. Et dans ce milieu propre à exciter la volonté de puissance de tous les egos rassemblés, toutes les frontières se dissolvent dans un environnement unique : l’argent.
L’opposition ...tout cela n’a aucun sens, il s’agit de se lancer dans une carrière en occupant les places les plus élevées et de faire fortune. Pour le reste ! … Dans ce détournement de la fonction politique, de manière subreptice, s’introduit alors une double discours : la langue de bois officielle que l’on sert quotidiennement aux électeurs et qui inonde les médias et en secret les manigances en tout genre. Dans la logique égotique du toujours plus : cumuler les mandats, les rémunérations, empiler les salaires, jouer des coudes pour obtenir les faveurs des multinationales, et faire ensuite du lobbying moyennant rémunération confortable etc. Et tout cela s’organise en sous-main dans des réseaux qui mettent en place de manière systématique les petits arrangements avec le droit, les combines, la corruption, la pratique des renvois d’ascenseur et le copinage à tout va. C’est un peu comme du temps de l’Union Soviétique : il y avait l’organisation, la vitrine officielle du communisme et le marché noir manipulé par les apparatchiks. Le capitalisme, c’est de la combine universelle pour le profit de ceux qui font déjà du profit et qui en veulent encore plus. Qui ne s’oppose pas à la démocratie représentative, mais qui l’enveloppe dans ses tentacules.
Quand le phénomène est parvenu à ce point, de façon si universelle, partout sur la planète, il faut avoir une sacrée couche de poussière sur les lunettes pour ne pas voir que nous ne sommes pas en démocratie et que le mot oligarchie serait bien plus pertinent. Il représente bien mieux la réalité pour le coup. On dira : oui mais c’est toujours mieux que la tyrannie des dictature ; Oui, mais enfin, on pourrait tout de même faire mieux non ? Concernant les preuves de ce que nous venons de résumer, il existe sur le sujet une littérature solide, qui pourra convaincre sans difficultés les plus sceptiques : Que les grands principes de la démocratie sont en permanence bafoués par les conflits d’intérêts et le cumul de mandats. Que l’égalité républicaine devant l’éducation est tout au plus une parole en l’air, quand ce sont toujours les rejetons de la même caste qui ont accès aux meilleures écoles. Que la prétendue liberté des échanges est de fait complètement détournée au profit des financiers, des affairistes, des managers des grands groupes internationaux. Que le système du pouvoir tend de lui-même à tourner en circuit fermé, jusqu’à en devenir héréditaire. Que le plaidoyer que l’on ressasse partout sur la démocratie est un voile épais qui ne fait que masquer une immoralité et une cupidité universelle.
2) Il y aurait de quoi se taper la tête contre les murs, ... C’est parfaitement compréhensible, à la limite plutôt sain en tant que réaction, c’est mieux que le conformisme béni oui-oui de la postmodernité, mais cela ne résout rien. Plutôt que de réagir de manière impulsive et de se précipiter dans des solutions expéditives, il importe avant tout de comprendre. Et c’est là qu’entre en scène la démarche d’Etienne Chouard que nous allons examiner. Partant d’un précepte d’Hippocrate, il demande de se mettre en quête de la cause et mieux de la cause des causes. L’idée se discute, mais disons que si nous pouvions saisir à sa racine ce qui a conduit aux dérives du monde actuel, nous pourrions reconstruire un système fiable. Capable de nous protéger des abus de pouvoir. Le précepte d’Hippocrate veut dire qu’il ne sert à rien de badigeonner chaque feuille d’une plante malade, c’est interminable et inefficace tant que l’on n’agit pas à la racine pour la soigner. Dans le champ qui nous occupe, les « mesurettes » que l’on propose d’ordinaire pour soigner le grand corps malade de la démocratie sont du même ordre, elles ne vont pas ....
Si on remonte le processus à l’œuvre dans la démocratie actuelle, on va depuis les élus vers l’élection et de l’élection vers son principe, l’idée selon laquelle dans une démocratie le peuple devrait être représenté. Il est possible de s’interroger sur le bien-fondé de l’élection et sur la pertinence de l’idée même de représentation.
Comme l’état de chose actuel est la résultante de conditions précédentes, il est intéressant de consulter l’histoire à ce sujet. De remonter à la Révolution française. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Sieyès, grand penseur de la révolution, écrivait : « les citoyens qui se donnent à eux-mêmes des représentants doivent renoncer eux-mêmes à faire les lois. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient leurs volontés, la France ne serait plus un état représentatif mais ce serait un état démocratique. Le peuple -dans un pays qui n'est pas une démocratie- et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants». (cit) On ne peut être plus clair. Même avant 1789 on savait fort bien que le procédé de l’élection était aristocratique, Aristote l’a dit de manière explicite (texte). Montesquieu ne s’est pas non plus privé de le répéter (texte). Mais c’est Rousseau qui a formulé les critiques les plus nettes. « Le peuple ne peut avoir de représentants, parce qu’il est impossible de s’assurer qu’ils ne substitueront point leurs volontés aux siennes, et qu’ils ne forceront point les particuliers d’obéir en son nom à des ordres qu’il n’a ni donnés ni voulu donner». Le risque encouru par l’élection est de donner aux représentants une indépendance vis-à-vis de la volonté des citoyens participant à l’élection, en sorte que la volonté générale dont ils devraient être l’expression nécessaire risque d’être trahie. Et dans ce cas, même si en apparence, dans le discours, elle semble exprimée, en réalité, la volonté du peuple n’est plus la puissance organisatrice du pouvoir politique. Rousseau va jusqu’à dire que confier le pouvoir politique à des représentants est irrationnel. La Souveraineté ne peut être représentée, elle appartient en totalité au Peuple (texte) lui-même qui se démettrait de son pouvoir en la déléguant. D’où ce passage du Contrat social commenté par Castoriadis (texte) : « Le peuple anglais pense être libre; il se trompe fort, il ne l'est que durant l'élection des membres du parlement ; sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde ». Ainsi s’explique qu’au moment d’une élection crépite dans l’air un petit air de liberté, mais qui ne dure pas, puisqu’elle est à nouveau confisquée.
Ce qu’il faut comprendre c’est que Rousseau ne formule pas seulement une crainte d’ordre psychologique, il a une intuition en profondeur de la logique de la représentation politique. Les véritables révolutionnaires de s’y sont d’ailleurs pas trompé. Témoin John Oswald, un écossais débarqué en France pour participer à la Révolution, comme d’autres plus tard iront faire la guerre d’Espagne, publie avant de se faire tuer par les contre-révolutionnaire, un pamphlet, Le Gouvernement du Peuple où il écrit : « la représentation est le voile spécieux à l'ombre duquel se sont introduits tous les genres de despotisme ». La formule nous intéresse au plus haut point car, dans les leçons précédentes, nous avons longuement montré que justement l’illusion comporte toujours un voilement de la réalité. Une belle entrée en matière pour une étude de l’illusion de la démocratie représentative. Nous comprenons dès lors pourquoi ces représentants ont beau jeu une fois élu de parler de Souveraineté du Peuple, dans la mesure où celui-ci vient d’abdiquer sa Souveraineté à leur profit. Rousseau a même le culot de dire que la représentation n’est jamais qu’une fiction héritée du Moyen Age où existait des parlements institués par les rois pour collecter des taxes ! Le mot exact qui conviendrait serait de dire que la démocratie représentative est une mascarade. Et on voudrait, ...
------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Questions:
1. Réhabiliter le tirage au sort en politique, est-ce s'en remettre à l'arbitraire?
2. Avons-nous raison de penser que la politique est une affaire de techniciens et de professionnels?
3. Devons-nous préférer le bipartisme, le multipartisme ou par de partis du tout?
4. Y a-t-il moyen de rendre la procédure de l'élection plus démocratique ou est-ce une illusion de le croire?
5. La démocratie directe est-elle faite pour des dieux ou faites pour des hommes?
6. Pourquoi la Constitution d'un État est-elle si importante?
7. Le discrédit actuel de la politique peut-il être porté au compte d'un manque de courage des dirigeants ou un vis de forme du système dans lequel nous vivons?
© Philosophie et spiritualité, 2013, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()