Nous
utilisons aujourd’hui le terme de révolution avant tout dans sa signification
politique, mais il faut noter que son sens premier est astronomique. On parle de
révolution de la Terre autour du soleil, de
révolution des astres dans le
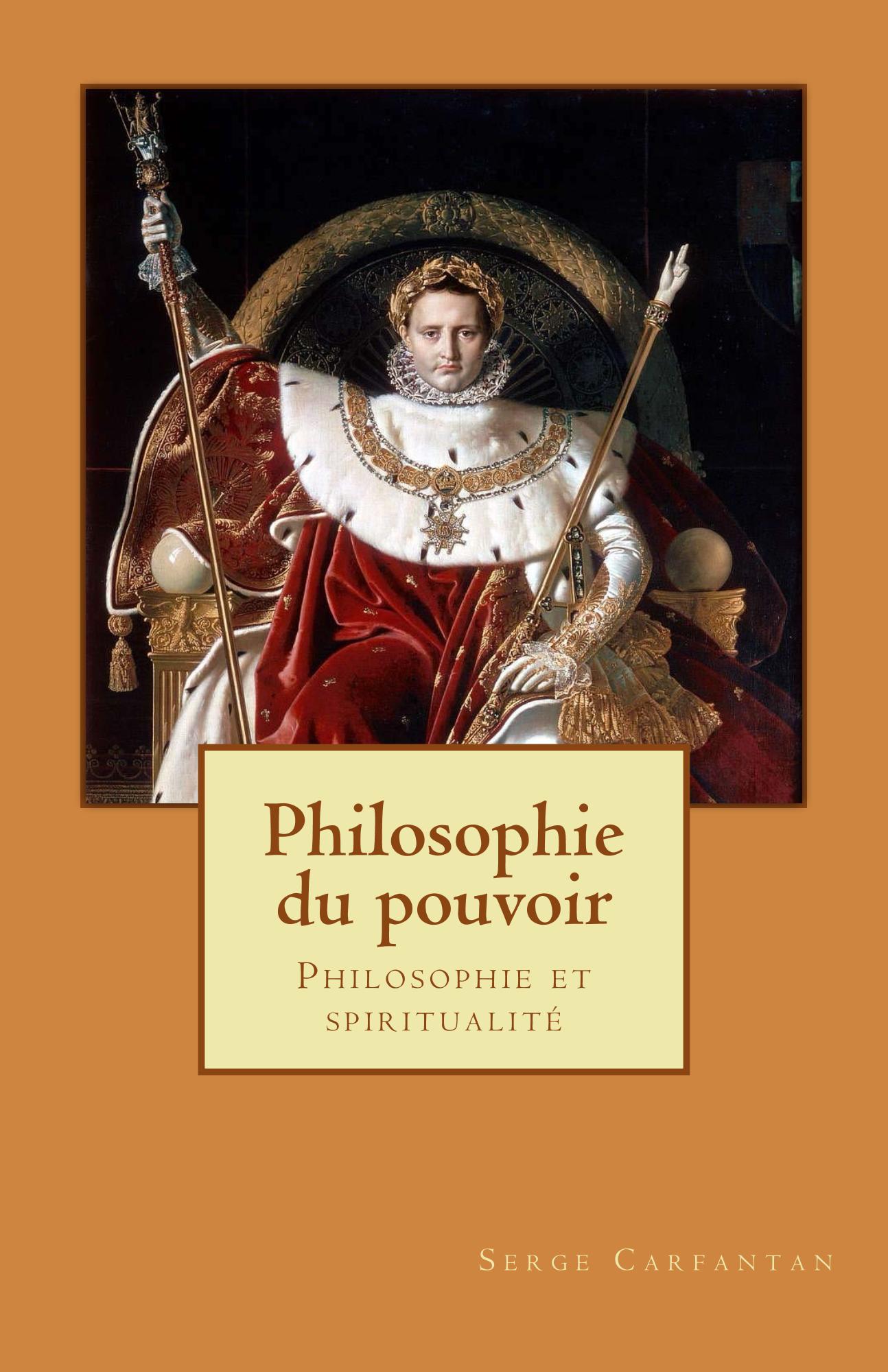 temps circulaire
des transformations de la Nature. Une révolution complète c’est le
passage entier qui vient boucler un cycle
avant d’en commencer un nouveau.
temps circulaire
des transformations de la Nature. Une révolution complète c’est le
passage entier qui vient boucler un cycle
avant d’en commencer un nouveau.
A la différence, une révolution politique semble s’inscrire plutôt dans le temps linéaire qui est celui de l’Histoire. L’idée qu’elle transporte est celle d’un retournement complet, idée proche de celle que nous avions rencontré avec Platon en parlant de la conversion de l’homme à la Vérité, sauf qu’ici nous devons nous exprimer autrement : Dans une révolution politique, il y a un bouleversement complet de l’ordre établi et son remplacement par un nouvel ordre, ce qui veut dire une autre forme de gouvernement. Noter aussi que l’on parle de révolution scientifique dans le même sens : renversement d’un ancien paradigme et remplacement par un nouveau paradigme qui change radicalement notre représentation du monde.
La puissance et l’envergure d’une révolution politique exclut que nous la traitions comme un simple changement de surface, il faut plutôt parler d’une lame de fond qui soulève de manière brutale et souvent sanglante, l’ordre établi pour instaurer de manière irréversible un ordre nouveau. Se pose alors toute une série de questions : quel est le moteur d’une révolution politique ? S’agit-il d’un phénomène terminal dans lequel se rassemble et se libère brusquement un changement qui a été longuement préparé sur un terrain social et économique ? N’est-ce pas la puissance des aspirations humaines qui portent les peuples vers un changement radical ? Est-ce que ce sont les souffrances accumulées de conditions de vie impossibles, ou bien les idéaux qui provoquent les révolutions ? Qu’est-ce qu’une révolution politique ?
* *
*
Commençons par déblayer le terrain avec quelques distinctions. On peut toujours jouer le relativisme en disant que « tout dépend de quel côté on se place ». Ce que le pouvoir appellera « désordre inacceptable », « trouble provoqué par des malades drogués », (cf. Libye) le peuple lui l’appellera révolte et révolution. Mais en rester là est très superficiel. C’est dans les choses-mêmes qu’il faut se situer et non dans un parti-pris ou dans l’autre. La difficulté est de bien discerner entre coup d’État, violence, révolte, insurrection, ce qui fait la force de l’événement.
1) Revenons sur les précédentes leçons. Nous avons vu que pour Camus la révolte porte en elle une exigence de justice. Le révolté dit « Non ! » face à la corruption, le mensonge, la cupidité, l’exploitation etc. il en a assez et demande la justice et l’intégrité. La révolte est d’abord morale avant que d’être politique. Nous avons vu que le révolté qui attend la résolution d’une situation d’injustice n’est pas au service d’un intérêt limité. Il n’est pas porté à engager directement la violence. Par contre l’homme violent demeure dans l’égocentrisme de ses intérêts et impose le rapport de force. Il prendra l’initiative de l’affrontement. Il peut y avoir une expression de la révolte sans violence. Il existe même des stratégies non-violentes très efficaces pour combattre l’injustice. Il est évident que toutes les révolutions commencent par des révoltes, mais une révolte reste limitée à quelques uns et n’a pas l’envergure d’une révolution qui implique tout un peuple. Toutefois, nous pouvons observer que rares ont été dans l’Histoire les révolutions non-violentes. L’exemple de la libération de l’Inde de la tutelle anglaise avec très peu de pertes en vies humaines reste emblématique. Quand le peuple manifeste dans la rue, il y a toujours des casseurs pour se joindre aux émeutes. Le pouvoir en place peut même chercher la provocation pour qu’il y ait des débordements de violences, ce qui justifie l’usage de la force. Mais de toute manière, même s’il n’y avait pas de violence, il y a dans toute révolution des rapports de force. Un point important sur lequel nous pourrons revenir : Camus, prenant appui sur un concept de révolution tiré du communisme marxiste, dit que la révolution trahit la révolte. L’idée intéressante ici c’est que l’idéologie (que l’on marque souvent avec un –isme : nazisme, fascisme, communisme, islamisme etc. ) récupère à son profit le sentiment d’oppression, d’injustice, de frustration d’un peuple et le détourne vers ses propres fins. Donc, au lieu d’autoriser dans la poussée révolutionnaire une libération de l’utopie cherchant ses propres voies, elle planifie selon des buts arrêtés, dans la direction d’un régime qui finit par être autoritaire. A l’inverse, on dira du révolté qu’il sait très bien ce dont il ne veut pas, ce dont il a assez, mais il ne sait pas encore ce qu’il veut. Le révolté se cherche. Dans la révolte, rien n’est planifié, la voie est libre pour la construction d’un monde meilleur qu’il s’agit de créer.
---------------Ceci mis à part, disons qu’il faut que la révolte se transforme d’abord en insurrection pour qu’éclate une révolution. Mais là encore, il peut y avoir ambiguïté. Une insurrection peut être seulement la fronde d’un corps institutionnel, d’un parti, d’un pouvoir social, d’une classe ne recherchant qu’à défendre ses intérêts contre le pouvoir en place. Défendre un corporatisme par la force ce n’est pas conduire une révolution. On parlera d’insurrection des magistrats, de l’armée, des étudiants, des ouvriers, des paysans, etc. mais il faut encore que le mécontentement soit global et que les motivations de la révolte soient très largement partagées de sorte qu’il y ait un vrai soulèvement populaire. Il faut donc dépasser les intérêts de classes. On peut même aller plus loin. Une révolution commence là où un mouvement de révolte de grande ampleur se met en place dans lequel il y a non seulement contestation, mais prise de pouvoir. On dira qu’en 1968 les étudiants sont entrés en insurrection contre le pouvoir, mais le mouvement de grève générale menait le pays vers une révolution. C’est dans les situations insurrectionnelles se répandant comme par contagion, que naissent les révolutions. Quand l’insurrection devient générale, on est au bord de la révolution. Le pouvoir politique doit céder.
Le mot réforme est employé pour désigner une initiative du pouvoir face à la montée de la contestation et en réponse à celle-ci. Quand la rue manifeste, le gouvernement propose des « réformes ». La réforme est ...On peut réformer des institutions, mais ce n’est pas du tout la même chose que de mener une révolution ! Un coup d’État aurait certes plus d’audace, mais un coup d’État n’est pas une révolution, c’est une prise du pouvoir par la force. Rien ne garantit que les aspirations d’un peuple soient portées, le risque étant que ceux qui s’emparent du pouvoir, le plus souvent les militaires, veuillent le conserver pour eux-mêmes et s’installer à demeure. Un coup d’État peut être réactionnaire et donc contre-révolutionnaire. A partir du moment où un peuple ne se reconnaît plus dans le pouvoir politique qui le dirige, s’instaure une situation de résistance. Normalement ce mot désigne un mouvement qui lutte contre un occupant, ou bien contre un gouvernement à la solde d’un occupant. C’est pour cette raison que l’on parle de la Résistance dans les années du gouvernement de Vichy. Cependant, quand le fossé se creuse entre les intérêts du pouvoir, confisqués au bénéfice d’une famille, d’un clan, d’une ethnie, d’une classe d’apparatchiks etc. et le bien de tous, naît un mouvement de révolte qui fait entrer en résistance ceux que l’on appellera des opposants, voire parfois les dissidents. Si une révolution éclate, ils en seront les acteurs de premier plan.
En résumé, une révolution implique un changement rapide, un soulèvement de masse dans lequel tout un peuple se trouve engagé, mouvement qui a des implications dans le domaine social, culturel, économique et politique, et qui traduit la volonté de liquider un passé et d’ouvrir une ère nouvelle. Sans un changement radical des normes, des valeurs et des principes de gouvernement, nous ne parlerions pas de révolution.
2) Une révolution marque donc une rupture importante dans le cours de l’Histoire qui brise une continuité qui était auparavant considérée comme normale, en d’autres mots, nous pouvons parler d’un saut révolutionnaire, un peu comme en physique on parle d’un brusque changement d’état d’un système. En nous appuyant cette fois sur l’histoire, nous pouvons, juste par commodité, ajouter quelques distinctions :
Par révolutions sociales on entend des transformations politiques ayant une portée radicale et un poids de conséquences considérables ayant changé la donne de l’Histoire : telle que la l’abolition de l’esclavage, ou encore le 4 août 1789 l’abolition des privilèges, le droit de vote accordé aux femmes etc. On dira qu’en France les événements de mai 1968 n’ont pas produit de bouleversement dans les institutions, cependant ils ont mené aux accords de Grenelle et provoqué un changement des mentalités. Cette expression « révolution sociale » est souvent généralisée. Rétrospectivement, nous avons tendance à louer certaines décisions politiques en disant par après « … cela a été une véritable révolution sociale ». On l’a dit par exemple à propos de la légalisation de l’IVG ou l’introduction de la pilule.
Par révolutions communistes on entend historiquement les révolutions inspirées par la doctrine marxiste de la lutte des classes, essentiellement du combat mené par le prolétariat contre la bourgeoisie : victoire du parti communiste en Chine lors de la guerre civile de 1949, révolution Russe de 1917, Révolution cubaine en 1959, etc.
Par révolutions islamiques on entend les révolutions faisant chuter un régime pour l’instauration d’un État islamique. Telle que la révolution iranienne de 1979 qui a aboutit au renversement de la monarchie du Shah. De même, la prise du pouvoir par les moudjahiddines lors du renversement de la République démocratique d’Afghanistan en 1992, comme celle des talibans en 1996, revendiquent cette appellation.
Par révolutions libertaires on entend les révolutions qui ont cherché à revenir à un idéal populaire d’autogestion se passant de la tutelle et de la hiérarchie d’un État. Ce sont des idées que l’on rencontre notamment dans l’anarchisme. Les historiens citent en exemple la Commune de Paris en 1871. La révolution de l’Ukraine libertaire de 1918 à 1921, ou la révolution espagnole de 1936-1939.
Enfin, ce qui fait surtout l’objet de cette leçon, on entend par révolutions politiques, le fait historique marquant dans l’histoire d’une nation, d’une transformation radicale des institutions et du personnel politique, suite à un soulèvement populaire. La Révolution française de 1789-1799 s’est imposée comme référence, car elle a instauré une République dont les principes ont servi de modèle par la suite. Après à la guerre d’indépendance de 1775-1783, la révolution américaine elle aussi s’est imposée comme modèle, car elle a conduit à la formation des États-Unis en tant que nation. Citons encore le florilège poétique de : la révolution de velours en Tchécoslovaquie en 1989, la révolution des œillets au Portugal en 1974, la révolution des roses en Géorgie en 2003, la révolution orange en Ukraine en 2004, la révolution des tulipes au Kirghizstan en 2005, la révolution de safran en Birmanie en 2007 et plus près de nous, la révolution de jasmin en Tunisie. Dans cette même catégorie on peut aussi inclure les guerres d’indépendance, comme la révolution haïtienne de 1791.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Questions:
1. En quoi une révolution "idéologique" pourrait-elle se distinguer d'une véritable révolution politique?
2. Quelles sont les forces qui sont en jeu dans le mouvement contre-révolutionnaire?
3. Le temps joue-il contre ou pour la révolution?
4. Les marxistes disent qu'il ne saurait y avoir de révolution sans théorie révolutionnaire, que faut-il en penser?
5. Vouloir planifier idéologiquement une révolution, n'est-ce pas par avance justifier des massacres pour la bonne cause?
6. Qu'est-ce qui dans nos démocraties actuelles justifierait le déclanchement d'une révolution populaire?
7. Peut-il avoir de véritable changement sans révolution?
© Philosophie et spiritualité, 2011, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()