Au cours des
leçons précédentes nous avons longuement abordé la question de la
synchronicité.
Tout d’abord en
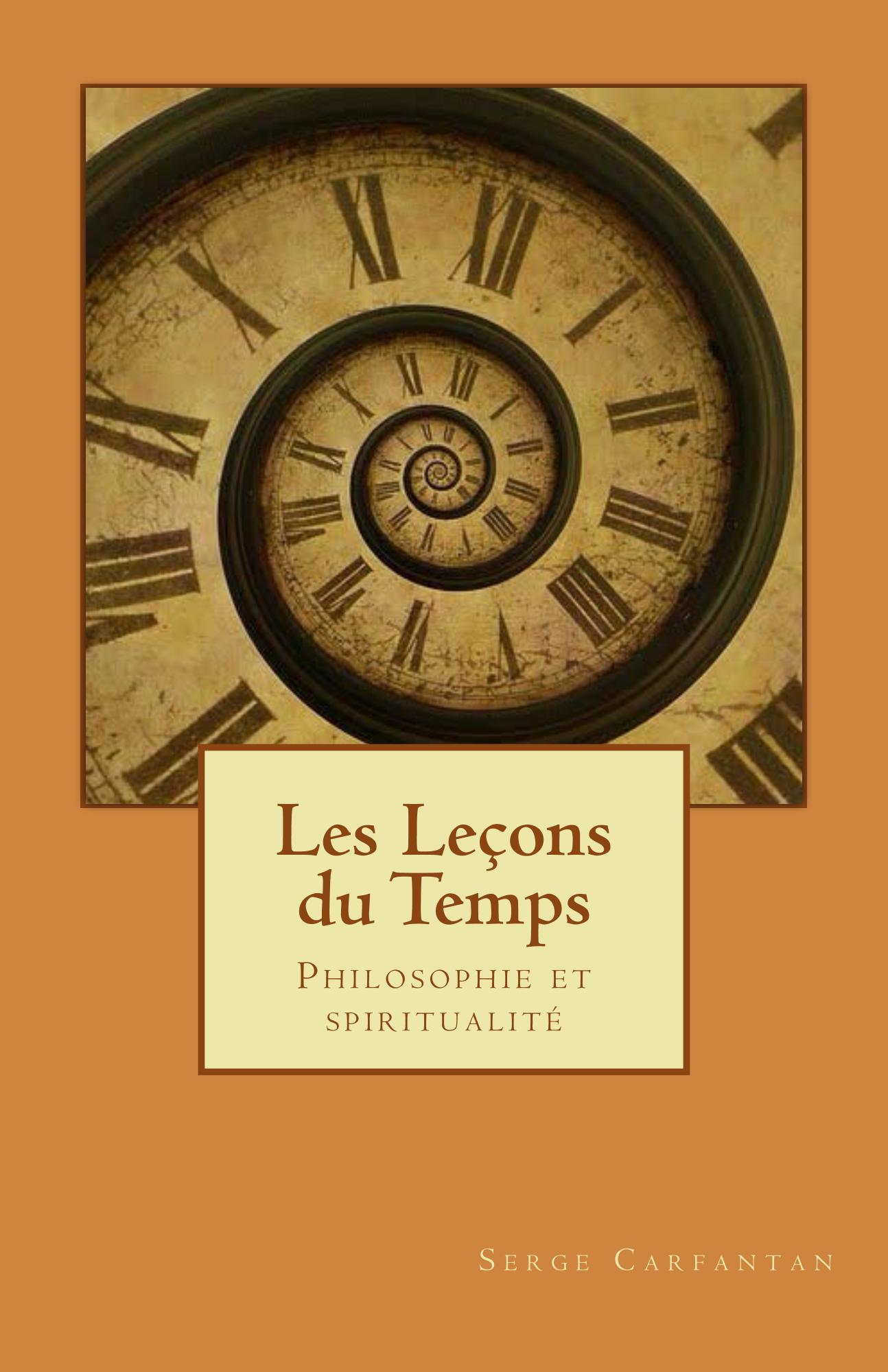 examinant la théorie du hasard dans
la physique classique et les nouvelles avancées de la physique quantique. Nous
avons consacré une leçon entière aux thèse de Carl
Gustav Jung dans ses recherches menée en relation avec Pauli. Nous avons aussi
examiné la non-causalité qui est sous-jacente à la théorie de la
synchronicité.
examinant la théorie du hasard dans
la physique classique et les nouvelles avancées de la physique quantique. Nous
avons consacré une leçon entière aux thèse de Carl
Gustav Jung dans ses recherches menée en relation avec Pauli. Nous avons aussi
examiné la non-causalité qui est sous-jacente à la théorie de la
synchronicité.
De nombreuses publications ont paru depuis, les vannes sont ouvertes et nous sommes très loin d’avoir épuisé le sujet. Une problématique en particulier peut être entièrement renouvelée avec l’introduction de la synchronicité. Celle de la liberté. En effet, nous avons vu que tant que nous raisonnons dans le cadre conceptuel du déterminisme classique, nous aboutissons nécessairement à des apories insurmontables. La causalité linéaire du paradigme mécaniste instaure une interprétation très statique de l’univers dans laquelle il ne peut y avoir irruption d’un potentiel spirituel. Pas étonnant dans ces conditions que les penseurs qui ont cru dans le déterminisme en soit venus à nier la possibilité du libre-arbitre.
Cependant, si, comme nous l’avons largement montré, l’univers est dans son essence infiniment plus souple que nous pouvons l’admettre, si la réalité est bien plus floue et bien plus dynamique que nous pouvons le croire, alors il est tout à fait possible que nos intentions tracent un chemin dans le réel. Nous ne sommes pas comme un train sur des rails. Nos intentions sont créatrices et elles provoquent des bifurcations au sein de ce que nous pourrions appeler notre arbre de vie. Le phénomène qui est en résulte est précisément la synchronicité des événement qui se manifeste dans notre quotidien. Donc, dans quelle mesure la théorie de la synchronicité vient-elle justifier notre libre-arbitre ?
* *
*
Revenons sur ce que nous avions dit auparavant, concernant l’interprétation de la causalité dans le cadre du paradigme mécaniste. Nous disions que de ce point de vue, un événement D est considéré comme déterminé s’il est l’effet d’une cause C telle que, si elle n’était pas apparue, C n’aurait pas été manifesté non plus. Dans ce schéma, la causalité est linéaire en allant de C vers D. Il est alors facile de s’imaginer une régression à l’infini qui précède l’apparition de C, depuis B et ainsi de suite. Comme le tracé A, B, C, quand il est regardé en se retournant vers le passé montre une ligne, la pensée n’a aucune difficulté à reproduire le même tracé vers le futur et à en imaginer le prolongement dans la séquence de l’avenir. Rien que de très banal. En fait, il ne s’agit pas d’une inférence tirée de la considération des lois physique. Il est dans la nature du mental de fonctionner au passé, donc d’avoir perpétuellement tendance à le projeter sur le futur. C’est ainsi que l’esprit fonctionne d’ordinaire à son niveau le plus élémentaire. Le plus grégaire pourrait-on dire. Par conséquent, l’idée d’un futur unique n’a aucun mal à s’imposer : non pas pour des raisons logiques, mais parce qu'il s'agit d'une projection habituelle de la pensée.
1) Bergson a très bien expliqué cette illusion rétrospective, qui est rendue par une image. Le promeneur qui marche sur une plage de sable fin au bord de l’océan, en se retournant voit ses propres traces dans une longue ligne sinueuse. S’il tourne à nouveau son regard devant lui, il peut imaginer que chacun des pas qu’il va faire va s’engager dans des traces tout aussi déterminées que celles qui sont derrière lui. Ce qui constitue une illusion car dans le présent il n’y a pas qu’un seul chemin de tracé à l’avance mais plusieurs sont possibles. De là l’idée que nous allons explorer selon laquelle dans le présent sont dessinés des futurs multiples. L’illusion du mécanisme aurait tendance à nous faire croire que nous sommes comme une locomotive sur des rails vers une destination déjà écrite, ... L'explication suit la paresse naturelle de l’esprit. L'aspect mécanique de la pensée. Elle néglige l’ingrédient essentiel qui lui échappe : le dynamisme infini présent dans l'univers sa puissance de Création. Comme Bergson a bâti toute sa philosophie sur l'intuition du dynamisme vivant du Devenir, il ne peut laisser passer pareille erreur. D’où son insistance à bien distinguer le temps chronologique de la pensée, de la Durée qui est intimement liée au Devenir réel de la Manifestation. L’Univers se crée à chaque instant, ce qui veut dire qu’à chaque instant il y a du Nouveau, qui n’est jamais la stricte répétition de ce qui a été, sans qu’il y ait une subtile déclinaison de l’inédit. Ce qui bien sûr est très dérangeant pour le mental qui, fonctionnant au passé, préférerait que le changement ne soit que répétition, ce qui est la seule représentation qui confère à l'ego un sentiment de maîtrise de la réalité. Bergson dit que nous résistons au changement ! (texte) Nous ne voulons pas l’affronter en face. Mais ce n’est pas de cette manière que les choses se passent. On a beau ..., nous continuons à entretenir la pensée selon laquelle nous avons raison de persister dans l’idée que nous pouvons tirer de nos cogitations égotiques une ligne vers le futur et que ce sera la bonne, que l..___________________________________________________________________________________________________________
de tous les jours est complexe. Dans un univers où tout est relié, une infinité de causes contribuent à l’apparition de chaque événement. Nous avons condensé cette thèse en disant que l’Univers tout entier contribue à l’apparition de chaque événement qui se produit en son sein. Donc il faut oublier toutes ces histoires de boules de billards qui se cognent, ces objets séparés dans le vide, c’est de la simplification abusive. Donc, laisser tomber l’idée de causalité linéaire qui n’est qu’une approximation grossière de ce qui a lieu réellement pour une appréhension plus systémique. Nous avons montré de manière assez détaillée que c’est ce qui fait le caractère révolutionnaire de la manière de penser de l’écologie.
Le déterminisme intégral n’a jamais été qu’une hypothèse commode, rien de plus. Il a été battu en brèche même sur le terrain où on le croyait confirmé. On peut très bien s’en passer en physique dans l’infiniment petit. La théorie quantique fait un pied de nez au paradigme mécaniste classique, elle démontre que l’on peut très bien bâtir une physique extraordinairement efficace en se passant de ce postulat encombrant. Il restait cependant aux partisans du déterminisme un terrain de chasse gardé : bon, d’accord, il ne marche plus au niveau microscopique… mais au moins il fonctionne au niveau macroscopique ! (texte) Jusqu’au jour où la thermodynamique a pu montrer que les systèmes chaotiques comportent aussi une dimension indéterministe fondamentale. Et qui n’est pas simplement une sorte de défaut de notre savoir. Même à notre échelle, l’imprévisibilité est substantielle ... La texture du réel est bien moins rigide, moins mécanique, que nous pouvons le croire ; ce qui nous a amené à parler d’une sorte d’élasticité de la Nature. Image qui est assez cohérente avec l’idée selon laquelle la matière dans son intégralité n'est rien d'autre qu'une fantastique distribution d'énergie. Le concept de « chose » lui-même ne se justifie que sous le regard d’un observateur placé dans la vigilance.
2) Venons en maintenant aux formulations du livre de Philippe Guillemant avec lequel nous allons faire un bon bout de chemin dans cette leçon, La Route du Temps. Admettre l'existence des futurs multiples, explique-t-il, c'est considérer le mouvement du temps selon un arbre de vie, thèse qui est très visiblement «en contradiction totale avec le déterminisme». L'image de l'arbre, comme arbre des possibles est intéressante à plus d'un titre. Si « on descend d'un arbre le long de ses branches, on aboutit invariablement au tronc selon un mécanisme visiblement déterministe qui, contrairement au cheminement vers le haut, nous dispense d'avoir à faire le moindre choix». Nous l'avons vu. Nous nous inclinons alors devant la nature déterminée du passé. Toutefois, ce n'est pas du tout l'option doctrinale du déterminisme qui n'a jamais eu cette modestie. « C'est en direction du futur, c'est à dire vers le haut, que le déterminisme prétend nous dispenser de tels choix, et non l'inverse. En direction du passé, nous comprenons bien qu'aucun choix n'est possible, puisque nous ne vivons pas dans ce sens et que pour choisir, encore faut-il vivre».
Pour que la thèse de l'arbre de vie soit sérieusement prise en compte, il est donc indispensable de montrer qu'il est possible d'inverser le sens du déterminisme, ce qui « revient à trouver une logique de cheminement lorsqu’on remonte le temps, qui nous permette de déduire le passé du présent, comme le permet l'Arbre de vie ». Mais comme passé et présent sont représentés dans une relation de causalité, inverser le sens du déterminisme « imposerait donc l'idée que des causes passées puissent être déterminées par des effets présents ». Ce qui est un défi. ... : « il ne s'agit pas cependant de nier la causalité, mais tout simplement de la rendre réversible ».
En clair, et pour aller droit au but, de même qu'il y aurait une procession causale séquentielle qui va du passé vers le présent, il est possible, en vertu de la nature même de la conscience, qu'à travers nos intentions portées vers le futur, nous fassions redescendre des effets sur notre présent. Ce qui rejoindrait admirablement la théorie de la synchronicité.
Commençons par une remarque : il est incontestable que « les équations fondamentales de la physique sont bel et bien réversibles par rapport au temps ». C'est le scandale qu'a soulevé Bergson. Il est désormais possible d'examiner ce problème sous un nouveau jour. Contrairement à ce que nous avons tendance à croire, la séparation de la causalité et du déterminisme est parfaitement envisageable du point de vue de la physique. ___________________________________________________________________________________________________________
Mais c'est sans compter avec une argumentation massive, que nous avons précédemment exposée, qui plaide en faveur de l'existence de la flèche du temps dans l'univers. Restons dans le contexte de la physique. Nous n'allons pas revenir sur tous les détails, mais il s'agit là, comme le dit Guillemant d'un panneau sens interdit planté en plein dans son territoire ! (Le seul selon lui). La flèche du temps « provient de l'irréversibilité « de fait » de nombreux systèmes physiques, comme par exemple une machine à café, une voiture, un moteur, un mélange, une cellule, une turbine, un être vivant, etc. Il semble en effet impossible de voir fonctionner ces systèmes à l'envers ». Mais pour les appuyer, nous avons tendance à nous replier sur le vieil argument d'Héraclite, « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Tout est dit dans un seul mot qui sonne comme une incantation menaçante : « l'irréversibilité » !
Sauf dans quelques audaces de science fiction. Il y a une très belle histoire dans la saga de Dan Simons, Hypérion, un père tente avec angoisse de sauver sa fille archéologue, contaminée aux Tombeaux du Temps, elle régresse tous les jours en âge vers la petite enfance, et il va devoir bientôt lui donner le biberon en espérant qu'elle ne disparaîtra pas. Exactement le genre de phénomène qui serait le contraire exact de ce qui constitue notre expérience.
Quand bien même l'irréversibilité aurait l'appui de notre expérience à l'état de veille (ce qui est faux dans le rêve), il y a malgré tout des physiciens qui se posent des questions sur son statut exact en physique, au-delà du simple constat empirique. Du point de vue de la vigilance, j'ai beau faire, comme dit Bergson, si je veux me préparer un verre d'eau sucrée, je dois attendre que le sucre fonde et il ne va pas sortir du verre d'eau pour se reconstituer en morceau de sucre. Bon !
Mais le problème reste entier pour le physicien, rien à faire, les équations de la physique sont réversibles et mêmes symétriques en fonction du temps. Est-ce parce qu'il manque quelque chose à la représentation des physiciens ? Il faudrait, sous la menace du revolver les sommer de se rendre à une « évidence » de l'irréversibilité ? Ou bien ont-ils quelques raisons solides de poser des questions gênantes qui prendraient à rebrousse-poil notre représentation de l'état de veille ?
-------------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Questions:
1. Quelles sont les implications de la rétro-causalité?
2. En définitive sur quoi se fonde le fatalisme?
3. En quoi l'option du déterminisme est-elle justifiée d'un point de vue scientifique?
4. Et si le temps était une illusion?
5. Le libre-arbitre est-il seulement un présupposé moral?
6. Quelles seraient les implications de l'existence d'une logique non-causale dans l'univers?
7. Ignorer le pouvoir de nos intentions, n'est-ce pas s'aveugler soi-même?
© Philosophie et spiritualité, 2013, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
Leçons (1)
et (2)
sur la synchronicité
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()