La crise de notre époque actuelle, est une crise des valeurs. cf. Ellul (texte) Quand plus rien ne semble avoir de sens, c’est que nos valeurs ont cessé de faire l’unanimité et sont à la dérive. L’intégrisme fait front sur la déliquescence des valeurs et prône un retour à la lettre des Écritures sacrées, une restauration des valeurs à partir du religieux. Le civisme commande le respect des valeurs humaines, mais c’est à peine si l’éducation civique parvient à assurer la transmission des valeurs de la laïcité. Le phénomène de perte des valeurs est lisible dans la perte des repères dont souffre la jeunesse. La consommation de masse, en véhiculant une image publicitaire de l’humain, n’assure pas de transmission de valeurs. Elle est un culte de l’image de marque et une glorification du spectaculaire, de l’immédiat et de l’éphémère, qui contribue au sens diffus de déracinement.
Nous vivons dans les décombres d’une lente déconstruction des valeurs entamée dans le XXième siècle, sous les coups de boutoirs de toute une série de remises en cause. Nietzsche s’est fait le héros du renversement des valeurs en accusant la morale chrétienne d’être une idéologie décadente. Le marxisme a réduit les valeurs à être un sous-produit d’un système économique. C’est contre les « valeurs bourgeoises » que se sont dirigées toutes les critiques, pendant cette période d’effervescence intellectuelle qu’a été la période des années 60-70.
Nous en sommes là, à employer le mot « valeur » pour essayer de laborieusement fixer ce qui pour nous a une importance, ce à quoi nous tenons par-dessus tout et qu’il ne faudrait pas lâcher. Mais il faut avouer que le terme de valeur est assez flou. On a toujours l’impression d’être dans le vague quand on en parle. C’est d’avantage un concept opératoire dans des champs différents de connaissance, qu’une idée précise. Qu’est-ce qu’une valeur ? Qu’est-ce qui la différencie d’une norme sociale ? Toute valeur est-elle avant tout morale ? Peut-on parler de valeur en dehors du domaine de la morale ? Une valeur vaut-elle par elle-même, ou par référence à un idéal qui permettrait de la fonder ? La valeur est-elle d’essence religieuse ? Sociale ? Politique ?
* *
*
Partons d’une définition simple : une valeur est ce qui fait l’objet d’une préférence, ce qui est estimé, préféré ou désiré par un groupe de sujets déterminés. Par exemple, pour un aristocrate, la noblesse constitue une très haute valeur. Toute valeur, de ce point de vue, est sociale. Il n’y a pas de valeur strictement individuelle et les jugements de valeur ont toujours un caractère collectif. En disant : "un groupe de sujets déterminé", nous voulons préciser ici que les valeurs peuvent aussi être discutées et même parfois rejetées, et elles sont en tout cas différentes d’un groupe social à un autre. C’est d’ailleurs une manière de se situer au sein d’une entité collective que de se définir par des valeurs, en rejetant celles d'une autre entité collective : « nous n’avons pas les mêmes valeurs eux et nous !».(texte) Si on tente une classification approximative, on peut marquer les distinctions suivantes en faisant la différence entre les :
a) Valeurs économiques :
La réussite sociale, est une valeur partagée par les américains. La préférence avouée en faveur du gain, du profit, et de l’argent en font des valeurs. Ce type de valeur est très visiblement une valeur matérielle. Le
financier manie cette valeur, l'économiste l’étudie. Pour la préciser, l’économie, avec Adam Smith, a marqué une distinction entre la valeur d’usage et
valeur d’échange. L'objet d’étude spécifique de l’économiste est avant tout d’expliquer comment s'établit un prix sur un marché. Pour résoudre ce problème, il doit définir l'essence de la valeur économique des choses. Il distingue donc valeur d'usage et valeur d'échange et distingue ce qui est dû, dans la constitution de la valeur, à la  matière première, au
travail humain, au rapport de l'offre et de la demande. Il est important de noter que dans le contexte
postmoderne qui est le nôtre, un glissement de sens très important s’est effectué en faveur de cette définition de la valeur. Notre
matérialisme ambiant se reconnaît en ce que le mot même de valeur dans l’opinion évoque immédiatement l’argent.
(texte) Il est patent que l’argent est notre première valeur et il est implicite que nous croyons que c’est justement avec de l’argent que l’on peut obtenir les autres valeurs. Personne n’ose le dit haut et fort, mais c’est bien ce que pense la plupart d’entre nous et c’est ce que globalement la
société de consommation propose. Le luxe, la richesse
en sont des valeurs explicites.
matière première, au
travail humain, au rapport de l'offre et de la demande. Il est important de noter que dans le contexte
postmoderne qui est le nôtre, un glissement de sens très important s’est effectué en faveur de cette définition de la valeur. Notre
matérialisme ambiant se reconnaît en ce que le mot même de valeur dans l’opinion évoque immédiatement l’argent.
(texte) Il est patent que l’argent est notre première valeur et il est implicite que nous croyons que c’est justement avec de l’argent que l’on peut obtenir les autres valeurs. Personne n’ose le dit haut et fort, mais c’est bien ce que pense la plupart d’entre nous et c’est ce que globalement la
société de consommation propose. Le luxe, la richesse
en sont des valeurs explicites.
Nous pouvons aussi noter que ces valeurs sont marquées par une logique de la dualité. Rigoureusement parlant, les termes sont duels : luxe/austérité, richesse/pauvreté, gain/perte, réussite sociale/échec social, abondance/misère etc.
Quand on interroge le public pour savoir quelles sont les valeurs les plus importantes, parmi les premières à être citées, il y a bien sûr la santé. Il est assez étonnant de remarquer que le mot français valeur dérive en fait du latin valere où ce terme est un verbe qui veut dire, entre autres, « être bien portant ». Les auteurs latins terminaient leurs lettres par des formules du genre Si vales, bene est (si tu te portes bien, c'est bien) ou encore, Si vales, gaude (si tu te portes bien, je me réjouis).
![]() La santé est une valeur qui se rattache au plan du
vital en nous, elle est liée à une valeur centrale qui est la vie. Nous avons construit autour de la valeur santé d’énormes institutions, des corps de métiers, une spécialisation et des compétences. Notre préoccupation pour la santé a une importance qui dépasse le cadre des institutions officielles, témoin l’énorme activité des médecines parallèles et l’intérêt général pour tout ce qui touche à la valeur bien-être ; témoin l’engouement collectif, le culte qui entoure le sport et toutes les disciplines corporelles. Nous sommes dans une époque postmoderne et la valeur centrale entre toutes est le
plaisir. Valeur vitale par excellence, celle du plaisir
sexuel, des plaisirs de la table, du jeu et des
émotions fortes etc. Il est inutile de développer ce point. Il suffit de jeter un regard par la fenêtre pour lire les
publicités. On peut même se demander à juste titre si dans notre monde, le plaisir vital n’est pas devenu l’unique valeur.
La santé est une valeur qui se rattache au plan du
vital en nous, elle est liée à une valeur centrale qui est la vie. Nous avons construit autour de la valeur santé d’énormes institutions, des corps de métiers, une spécialisation et des compétences. Notre préoccupation pour la santé a une importance qui dépasse le cadre des institutions officielles, témoin l’énorme activité des médecines parallèles et l’intérêt général pour tout ce qui touche à la valeur bien-être ; témoin l’engouement collectif, le culte qui entoure le sport et toutes les disciplines corporelles. Nous sommes dans une époque postmoderne et la valeur centrale entre toutes est le
plaisir. Valeur vitale par excellence, celle du plaisir
sexuel, des plaisirs de la table, du jeu et des
émotions fortes etc. Il est inutile de développer ce point. Il suffit de jeter un regard par la fenêtre pour lire les
publicités. On peut même se demander à juste titre si dans notre monde, le plaisir vital n’est pas devenu l’unique valeur.
Par ailleurs, notre attachement à la valeur vie se traduit aussi par la virulence des polémiques autour de sa remise en cause : l’euthanasie, le rejet du suicide, l’horreur de la mort, la révolte contre la guerre, le rejet de la douleur, des mutilations, de la torture etc.
A la valeur vie est aussi liée en grande partie notre souci du respect de la Nature, du respect de l’environnement. Nous savons que notre existence et celle de la vie en général sont inséparables. A chaque fois que nous semble remise en cause la valeur vie, nous parlons de comportements morbides, de la négation par la mort.
« La valeur n’attend pas le nombre des années » dit Corneille. Un homme peut manifester de la grandeur, de l’honnêteté, de la droiture, de la véracité, un courage, un sens

élevé de la responsabilité, etc. sans que l’expérience en soit le fruit. Nous reconnaissons collectivement dans ces vertus des valeurs qui méritent notre respect. On ne parle plus des vertus. On parle surtout des valeurs morales. C’est toute la différence entre Aristote et nous. Nous disons de celui qui manifeste de grandes qualités morales qu’il a un certain « sens des valeurs ». Le code moral de la chevalerie, le code d’honneur des samouraïs, la chartre des compagnons du devoir, supposent l’attachement a des valeurs morales. Il est entendu ici que les valeurs sont enveloppées dans un idéal commun. On voit la différence avec la catégorie précédente en ce que la valeur implique ici une pureté d’intention, une générosité, un don de soi qui se situe à l’opposé de la valeur économique. Le don n’est pas l’échange. Celui qui vient incarner une valeur se donne à elle et ne se situe pas dans le contexte de ce qui peut s’acheter et se vendre. La différence est tellement nette que justement on attend d’un responsable d’entreprise qu’il ait les qualités morales nécessaires et pas seulement une compétence dans son métier. Ce qu’attend un chef d’entreprise qui embauche, c’est non seulement une efficacité pratique, mais aussi des qualités morales qui puissent justifier sa confiance dans son employé.
Malheureusement, il est clair que cette éducation aux valeurs morales n’est pas dispensée par les organismes de formation.
On peut dans cette catégorie ajouter les valeurs morales qui ont une dimension politique forte : la liberté, l’égalité, la fraternité, la solidarité, la suprématie du droit etc.
Enfin, c’est aux valeurs morales que se rattachent les valeurs religieuses. Il est évident que le croyant fait sienne certaines valeurs qu’il considère comme la spécificité de sa religion et c’est par là qu’il a souvent tendance à s’opposer à la spécificité des autres religions. Les valeurs religieuses ne constituent pas en fait une catégorie à part, mais une manière de fonder les valeurs morales différemment, en les appuyant sur une autorité incontestable. Celle du texte sacré, celle de Dieu.
Les valeurs morales sont très marquées par la dualité, car il est sous-entendu en chacune une opposition bien/mal. Il y valeur/non-valeur, vertu/vice, courage/lâcheté, honnêteté/malhonnêteté, véracité/mensonge, responsabilité/irresponsabilité, liberté/servitude, égalité/inégalité, etc.
d) Valeurs esthétiques :
Parce que nous sommes la plupart du temps englouti dans la considération des valeurs économiques, nous avons tendance, par réaction, à souligner ce qui dépasse la trivialité de nos valeurs matérielles. C’est alors vers l’art que nous nous tournons pour montrer que notre civilisation ne vaudrait guère son content de peine et de misère, si l’art n’était pas là pour racheter notre existence. Comme le dit Giono, l’homme a besoin de s’entourer de beauté, tout autant qu’il a besoin de pourvoir à sa propre survie. Nous entourons les musées de vénération et ils sont de fait devenu les temples de notre dernière spiritualité. Nous ne visitons plus un cathédrale parce qu’elle est la maison du seigneur, mais parce qu’elle est un monument qui vaut pour sa beauté esthétique. Nous souhaitons que nos enfants trouvent le goût du commerce des grands écrivains. Nous voudrions leur faire partager notre amour de la musique. Nous attendons de l’art qu’il élève l’homme intérieur et le sorte de sa brutalité ordinaire. Le sublime de Shakespeare, la naïveté et le charme d’Homère, la perfection de Bach, méritent largement que l’on consacre sa vie à vouloir les communiquer. Ce sont des valeurs plus éternelles que les séductions passagères des modes. Nous admettons que l’enseignement artistique a toute sa place dans l’éducation et il nous semblerait très inquiétant de le voir disparaître. Personne ne veut livrer le monde aux technocrates ou aux requins de la finance. Nous ne voyons pas comment un être humain pourrait être réellement développé sans le raffinement de la culture et tout particulièrement de la culture esthétique.
![]() Les valeurs esthétiques ne sont pas soumises à une emprise de la pensée duelle aussi forte que les valeurs morale. Le sens esthétique est justement tout en nuance. Seul un esprit inculte tranche brutalement devant une œuvre d’art en disant c’est beau/c’est moche. Une sensibilité éveillée ne dirait jamais cela. Il en est de même pour tout ce qui relève des sentiments esthétiques les plus raffinés.
Les valeurs esthétiques ne sont pas soumises à une emprise de la pensée duelle aussi forte que les valeurs morale. Le sens esthétique est justement tout en nuance. Seul un esprit inculte tranche brutalement devant une œuvre d’art en disant c’est beau/c’est moche. Une sensibilité éveillée ne dirait jamais cela. Il en est de même pour tout ce qui relève des sentiments esthétiques les plus raffinés.
e) Valeurs intellectuelles :
Notre époque parle dans le langage de la science, comme d’autres époques ont parlé dans le langage de la philosophie ou dans le langage de la religion. S’il est une chose qui pour nous a une valeur suprême, c’est bien la pensée. La culture occidentale est avant tout une culture intellectuelle. Une culture qui est aussi marquée, depuis la modernité, par l’approche objective de la connaissance que constitue la science. De fait, la vérité, la clarté, la rigueur, la cohérence logique, la fécondité intellectuelle, l’objectivité, par exemple, sont effectivement des valeurs auxquelles nous tenons et pas seulement des exigences formelles. Notre éducation est un héritage de la Modernité et des valeurs intellectuelles qu’elle nous a laissé. Certes, il ne fait pas bon, dans un monde postmoderne, de mettre en avant des exigences intellectuelles très élevées. C’est en contradiction avec l’air du temps. Cependant, - cela fait partie de notre inconséquence - de fait, il faut bien remarquer que c’est exactement par ce moyen que nous pratiquons la sélection des meilleurs. Se servir des mathématiques comme d’outil de sélection n’est pas seulement une question de facilité (la correction d’un devoir de mathématiques a une réputation d’objectivité), mais c’est un choix qui vient de ce que nous privilégions avant tout les valeurs intellectuelles, sous leur aspect le plus formel. Platon avait mis au fronton de l’Académie « nul n’entre ici s’il n’est géomètre », mais il accordait aussi une grande importance à la culture physique et esthétique. Il évoque dans le Philèbe.

l’importance de la vie mixte, ce qui ne fait pas de l’élan de la philosophie une ascèse. Platon plaçait au sommet du développement de l’humain le développement de l’intuition, l’art du raisonnement en vue l’acquisition de la sagesse. Nous autres, nous n’avons que faire de la sagesse, nous attachons surtout de l’importance au calcul, à la gestion, à l’organisation. Personne ne songerait aujourd’hui à tester la culture, la finesse de la pensée d’un candidat à une institution, par une dissertation de philosophie. Il nous semble normal de sélectionner les futurs médecins par des épreuves de mathématiques.
Nous sommes attachés aux acquis de la physique, aux prodiges de la génétique, aux développements de l’histoire et des sciences sociales. Nous sommes fiers de notre histoire intellectuelle. Ce serait un retour à la barbarie que d’y renoncer. Ce que nous souhaitons, c’est qu’il soit largement vulgarisé. Ce que nous souhaitons aussi, c’est que notre technique ne produise pas de désastre et qu’un supplément d’âme couronne notre savoir. (texte) Ce qui est une timide concession à l’espoir que notre savoir puisse servir à plus de sagesse et à moins de folie.
Remarquons que les valeurs intellectuelles sont aussi soumises à la dualité et qu’il est très facile de les convertir en jugements moraux. Vérité/erreur, clarté/obscurité, cohérence/incohérence, objectivité/subjectivité savoir/ignorance, science/non-science etc. invitent une logique duelle et le passage de la discussion à la dispute.
f) Valeurs affectives :
Le petit meuble qui m’a été volé et que je tenais de ma grand-mère, j’y tenais. Vendu aux puces, il n’aurait pas rapporté grand-chose. Sa valeur n’était économique mais affective. Je tiens à la bague de ma mère, pour tous les souvenirs qui sont associés à cet objet, même si personne ne comprend que je puisse à ce point y être attaché. La valeur affective de l’attachement s’enracine dans la subjectivité pure : celle de l’ego et de ses appartenances, dans le contexte de ce à quoi je suis attaché. Mais les valeurs affectives sont aussi ce que nous partageons dans une culture. Il est clair que le concept de nation par exemple n’aurait aucun contenu si on lui enlevait les valeurs affectives qui lui sont liées. Nous ne pouvons comprendre un peuple, sans comprendre les valeurs affectives auquel il est attaché. Un anglais est anglais en vertu d’une fierté qui enveloppe une histoire insulaire, il ne se sent pas continental, il a un british sense des relations, d’une approche pragmatique des problèmes,

de l’humour, de la référence à sa royauté etc. Un indien reste indien par son attachement aux valeurs spirituelles, fier d’une tradition plusieurs fois millénaire qui reçoit la diversité des religions comme allant de soi, avec des autorités qui restent proche de son cœur. L’italien est bien plus attaché à la valeur famille que le français. Nous sommes donc bien ici sur un terrain de valeurs affectives.
La première de toutes les valeurs que l’on nomme c’est l’amour. L’amitié, le bonheur, la compassion sont des valeurs liée à l’affectivité auxquelles nous tenons par-dessus tout. Il est très difficile de préciser le contenu d’une valeur affective. Elle parle davantage au cœur qu’à l’intellect, mais elle commande aussi de manière plus forte et plus impérative. Les sociologues font remarquer que, dans la déliquescence des valeurs qui caractérise notre temps, il en est cependant une qui résiste tout et c’est l’amour. On l’a dit, jusque dans la mièvrerie la plus insipide, sans la valeur de l’amour, la vie se trouve privée de son sens et inversement, quand la valeur de l’amour est vivante, la vie s’épanouit dans la grandeur.
Les valeurs affectives ne sont pas rationnelles. Au niveau le plus élémentaire de l’expérience humaine, elles sont marquées par la dualité : attachement/haine, bonheur/malheur, amitié/inimitié, sensibilité/insensibilité etc.
Le jeu de la dualité dans le désir/aversion joue dans l’appréciation des valeurs. Ce qui est considéré comme une valeur par les uns, peut être considéré comme non-valeur par les autres, ou au moins être complètement relativisé . Les valeurs font l’objet de préférences personnelles, préférences qui peuvent être partagées par d’autres individus, mais sans recouper des communautés très précises. Ce qui change, c’est surtout la hiérarchisation des valeurs (texte) et en elles les préférences. Comme l’a très bien montré Shri Aurobindo, dans Le Cycle humain, on reconnaît l’homme-vital, à ce qu’il met au sommet de l’échelle des valeurs la réussite sociale et le profit, et en bas les valeurs esthétique et intellectuelles. L’homme-mental place au sommet les valeurs intellectuelles et les valeurs esthétique et en dessous, les valeurs économiques. L’homme-éthique porte au sommet de l’échelle des valeurs, les valeurs morales. La prévalence qu'il accorde par exemple à la responsabilité, à l'honnêteté ou à l'instruction l'oppose à la hiérarchie spontanée que construirait l'homme-vital. Nos jugements de valeur font donc toujours référence à une échelle des valeurs qui est le reflet de ce que nous sommes Collectivement, les systèmes de valeurs sont des constructions complexes dont la géométrie est variable, à la fois dans l’espace (différence culturelle), dans le temps (différence historique). Ils sont changeants et ne font pas l’objet d’une unanimité, et cependant, ne sont jamais neutres. Ils requièrent de la part du sujet une implication affective et un appel direct à la sincérité. Nous pouvons avoir des opinions flottantes sur à peu près n’importe quoi et en changer comme de chemise ; par contre, sur le plan des valeurs, notre implication personnelle est bien plus ferme et assurée.
Nous tenons à nos valeurs, nous savons faire preuve de rectitude, de constance, de fidélité envers nos valeurs. Nous disons que les valeurs donnent un sens à la vie ; les valeurs sont ce par quoi la vie prend un sens. Si les valeurs donnent un sens, la perte des valeurs est donc la perte du sens. Est-ce à dire que la vie n’a pas de sens par elle-même ? Les valeurs que l’on donne à la vie n’ont-elles aucun rapport avec elle ? Ou encore, n’est-ce pas parce qu’elles finissent par ne plus avoir de rapport avec la vie que les valeurs entrent en crise ?
1) Leibniz posait la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? ». Nous avons vu que Jonas, dans le Principe Responsabilité, répondait en disant que puisqu’il y a de l’être, il y a aussitôt une responsabilité à l’égard de ce qui est. Qu’il y ait de l’être implique, pour l’homme qui en a la garde, un devoir-être qui soutient, protège, promeut ce qui est dans la continuité du futur. Ce qui n’existe pas n’élève pas de revendication : « la revendication d’être commence avec l’être ». Or « toute vie revendique de vivre et peut être est-ce là un droit qu’il faut respecter ». C’est dans cette perspective ontologique que se situent toutes nos valeurs. Ce que Jonas entreprend de montrer, dans le cadre d’une ontologie qui opère un retour à Aristote, c’est qu’en un sens très précis, la Nature promeut déjà des valeurs. La Nature promeut des fins, cherche sa propre expansion et sa tendance naturelle la porte vers la promotion de la vie. « La nature cultive des valeurs, puisqu’elle cultive des fins et que donc elle est tout sauf libre de valeurs ». L’être se veut lui-même et la puissance par laquelle l’être se veut lui-même n’est rien d’autre que la Vie. La Vie se veut elle-même antérieurement à toutes les raisons que nous pouvons lui donner, car ce vouloir de soi est précisément son essence la plus intime. La Vie est la Valeur des valeurs. (texte)
![]() Cependant, dans la représentation humaine, la fin est consciente et intentionnelle. Loin de se situer au cœur du vouloir le plus intime de la vie, en deçà de toute pensée, la fin, telle que l’homme se la propose, est posée par la pensée dans la représentation. La re-présentation est une présentation seconde, par rapport au surgissement premier de l’Être. Aussi, le sens de vie est-il celui que nous choisissons de lui donner, celui que nous voulons créer. Un système de valeurs n’est rien d’autre que la configuration conceptuelle de la manière dont nous représentons ce qui pour nous a sens.(texte)
Cependant, dans la représentation humaine, la fin est consciente et intentionnelle. Loin de se situer au cœur du vouloir le plus intime de la vie, en deçà de toute pensée, la fin, telle que l’homme se la propose, est posée par la pensée dans la représentation. La re-présentation est une présentation seconde, par rapport au surgissement premier de l’Être. Aussi, le sens de vie est-il celui que nous choisissons de lui donner, celui que nous voulons créer. Un système de valeurs n’est rien d’autre que la configuration conceptuelle de la manière dont nous représentons ce qui pour nous a sens.(texte)
Toutefois, devant la vie, tous les systèmes de valeurs ne sont pas équivalents, de même, si toutes les créations de l’art sont artificielles, toutes ne sont pas pour autant grandioses. Notre représentation peut de ce fait donner naissance à des systèmes de valeurs qui en viennent justement à dénier toute valeur à ce qui est, ou à ramener la question de Leibniz à une réponse brutale : il vaudrait mieux qu’il n’y ait rien plutôt que quelque chose. Telle est la quintessence de ce que l’on appelle le nihilisme. Le choix du néant contre l’être.
2) Pourquoi choisirait-on le néant contre l’être ? Le nihiliste, par-devers lui pense ceci : parce que, mesuré à la hauteur de nos désirs, l’être se révèle insatisfaisant, décevant et imparfait, parce que le monde est désespérément fini, que l’histoire ne semble mener nulle part, que notre savoir est pauvre et limité, parce que l’homme est imparfait ... c’est donc que la « perfection » n’est pas de ce monde. Si le sens ne nous est pas « donné », tout sens n’est peut être qu’une illusion et une illusion qui doit être détruite. Plutôt rien que quelque chose d’imparfait. Comme le dit Jonas, on n’a encore « rien soustrait au nihiliste » en se contentant de dire qu’il y en ce monde le désir et la jouissance, l’attirance et la répulsion,

l’espoir et la crainte, les choses désirées et les choses non-désirées. Il pourra toujours rétorquer que l’existence est un drame pénible qui n’en vaut pas la peine et à ce compte, le néant serait plutôt une délivrance. cf. Günter Anders (texte)
Quand une telle pensée rode dans la conscience collective, le nihilisme chuchote dans les oreilles des plus puissants et la maladie de la vie se répand. Il y a une perte des valeurs quand le sol semble se dérober sous nos pas et que le nihilisme vient miner de l’intérieur le rapport que l’homme entretient avec la vie. Le nihilisme est le sous-produit d’une pensée malade qui se pose à tout moment la question « à quoi bon ? », et « jusqu’à quand ?». Le nihilisme est présent lorsque la tentation du rien hante l’esprit, que la spontanéité créatrice fait défaut et que tout semble conspirer dans un inéluctable mouvement vers le néant.
a) Le nihilisme a incontestablement une signification historique. (texte) Il a partie liée avec le processus de développement même de la Modernité dans la civilisation occidentale. Alors que les Modernes annonçaient pour l’humanité à venir une perspective heureuse de bonheur, de paix, de libération de l’effort, par le progrès indéfini de la moralité et de la culture, alors que la société industrielle prenait un essor prodigieux, Nietzsche lançait un cri d’alarme : « ce que je raconte, c’est l’histoire des deux prochains siècles. Je décris ce qui viendra, ce qui ne peut manquer de venir : l’avènement du nihilisme ». Le nihilisme accompagnait de façon souterraine le mouvement de l’Histoire et se traduisait par des formes de négations de plus en plus radicales. On peut parler de nihilisme actif, pour désigner les tendances qui prennent fait et cause pour le néant et en revendiquent la nécessité. On peut repérer la trace du nihilisme dans le cours du XXième siècle dans les idéologies les plus morbides que l’occident a pu produire. L’ombre portée du nazisme et de sa solution finale dans les camps d’extermination, les persécutions, la répression, des régimes totalitaires, la menace constante du terrorisme mondial, le recours délibéré à la guerre pour résoudre les problèmes, l’obligation imposée à des millions d’être humains de vivre dans la peur, dans un monde resserré à l’extrême, sans espoir d’une aube nouvelle, en sont des manifestations. Le nihilisme actif a été identifié dans les sciences par Husserl dans la Krisis, la Crise de la Conscience européenne sous la forme d’une crise des fondements du savoir. Il a été identifié dans les tendances de la conscience collective par Freud dans Malaise dans la Civilisation. L’audience phénoménale que reçoit à l’après-guerre la littérature de l’absurde avec ses thèmes de l’angoisse, de la nausée, de la contingence en est encore la confirmation dans la philosophie. C’est dans ce milieu que Sartre écrit L’Être et le Néant. Il y a un fil conducteur évident entre La Nausée de Sartre, Voyage au bout de la Nuit de Céline, En attendant Godot de Beckett et le théâtre Ionesco, la destruction comme idéal de l’art et de l’art comme idéal dans le mouvement Dada etc. La liste serait trop longue, mais les symptômes sont clairs. Nietzsche a voulu lui-même, en « philosophant à coups de marteau », être un champion du nihilisme actif. Il l’a été en proclamant « la mort de Dieu », en faisant le procès de la décadence de son siècle et en prenant violemment à parti le christianisme comme responsable de ce déclin.
b) On peut parler de nihilisme passif, (texte) pour désigner le phénomène collectif de dépréciation dans l’inertie des valeurs supérieures. (texte) Ainsi les journalistes titre devant des faits d’actualité en parlant de "crise du sens », de « perte des repères », et Lipovetsky a même désigné l’ère postmoderne comme L’Ere du vide. Le nihilisme passif n’est pas spectaculaire. Il est insidieux. Il n’est pas l’apocalypse de la destruction du monde dont parle la religion, il n’exclut pas l’aisance matérielle, il n’exclut pas le la frénésie de l’action, ni la fuite éperdue et brillante dans le divertissement. Il est parfaitement compatible avec la société de consommation. (texte) Il ne fait qu’orienter toutes ses activités vers le rien. Le nihilisme passif c’est l’empire grandissant de l’inertie et de la négativité, et son glissement sur la pente de la mort, dans une transformation qui n’a d’autre finalité qu’un retour à l’état inerte. Il est là quand tout se consomme avant même d’avoir été utile, quand le mode d’action consommer-jeter devient omniprésent. Quand l’indifférence aux conséquences nocives de l’action est telle que toute le monde s’en fiche et que le laisser-aller et le laisser-faire est devenue une règle. Ou plutôt quand il n’y a plus de règles. Quand l’indifférence est partout. Quand on consomme l’amour, pour le jeter aussitôt, comme on mange des frittes en jetant le papier sur la pelouse. Quand on consomme des savoirs en classe, sans jamais s’y intéresser

et que le professeur est devenu une sorte de distributeur automatique. Quand la littérature ne fait que servir des lieux communs, ce qui se dit et se fait, dans une totale complaisance, en jouant seulement sur l’effet. Quand l’art ne produit plus aucune nourriture pour la sensibilité, mais ne fait plus que jouer dans la surenchère de la provoc’. Quand le savoir ne nourrit plus l’esprit, mais remplit la mémoire et ne produit plus que l’ennui. Quand le climat intellectuel est morose et le reste. Comme le dit Jean Daniel : « quand on est sûr que demain sera pire qu’aujourd’hui. Et que l’on ne peut se raccrocher à l’espoir, ici et maintenant, demain et ailleurs, d’une société non pas idéale, non pas heureuse, mais simplement meilleure ». En bref, selon les paroles de Nietzsche, quand le dernier homme est parmi nous et qu’il est devenu l’un d’entre nous et nous tous !
Que reste-t-il au dernier homme comme dernier souci ? Le souci de profiter. De profiter pendant qu’il en est encore temps. Francis Fukuyama, dans La Fin de l’Histoire et le dernier Homme dit ceci : « Un chien est heureux de dormir au soleil toute la journée, pourvu qu’il soit nourri, parce qu’il n’est pas insatisfait de ce qu’il est. Il ne se soucie pas de ce que d’autres chiens fassent mieux que lui, ou que sa carrière de chien soit restée stagnante ». Il ne fait que commenter Nietzsche et le rapprocher de Tocqueville. Il veut dire que l’achèvement universel de la démocratie revient à réhabiliter le retour à l’animalité. La vie démocratique sera achevée quand l’existence de l’homme quand « sa vie finira par ressembler à celle du chien ».
Nous entendons parler tous les jours dans les média des « valeurs démocratiques ». Nos politiques se font fort de donner des leçons de morale et d’insister sur leur attachement aux « valeurs démocratiques ». Mais les esprits les plus perspicaces savent entendre à quel point ce discours est vide. Alan Bloom, l’auteur de L’âme désarmée, remarquait il y a peu, à quel point cette incantation était creuse. C’est un discours de la langue de bois. C’est un discours somnifère pour les masses. Dès que l’on parle réellement de valeur, on sous entend un système de valeurs, au sens fort, une morale, une idéologie ou même une religion. La démocratie est un régime politique qui a une spécificité : le foisonnement et la relativisation de toutes les valeurs. La démocratie rend possible le foisonnement, elle rend possible le creuset dans lequel on peut fonder un nouveau modèle de valeurs. Elle n’est pas un modèle de valeurs. La démocratie, contrairement à l’aristocratie, aux régimes autocratiques, est l’absence de valeurs instituées. Elle n’est ce qu’elle est que parce qu’elle nie tout autre loi que celle de la volonté générale. Par conséquent, se servir d’une formule du genre «les valeurs démocratiques », c’est oublier ce que signifie justement la démocratie. Le pouvoir donné au peuple. C’est seulement en démocratie qu’il n’y a plus de valeur en dehors de celles que choisissent librement les individus. C’est seulement dans le cadre général de la démocratie que toutes les valeurs se relativisent et deviennent respectables. Mais comme l’inertie même y prévaut, il faut bien s’attendre à ce que la valeur la plus communément partagée, parce qu’elle est justement lesté du « commun », soit celle du consensus et du dernier homme. La vie de chien gras, somnolent et repu. La démocratie devait accoucher de la postmodernité. Comme elle peut aussi accoucher de la cosmodernité, si elle ne vire pas à la dictature larvée ou au totalitarisme nationaliste et intégriste. C’est un choix.
3) C’est un choix qui est en relation intime avec la vie, avec ce que nous choisissons d’être en montrant par là qui nous sommes et ce que nous sommes capable de créer. Ce qui nous ramène invariablement à Nietzsche. Si Nietzsche est un auteur tortueux et complexe, c’est qu’il ne se contente pas d’effectuer, en psychologue, un diagnostic sur son époque et sur les temps à venir. Cette position imposerait une neutralité, la lucidité, sans le cynisme. Il entend apporter une contribution majeure au "renversement des valeurs ", Umwertung aller Werte, qui doit permettre, dans son langage, l’avènement du « Surhomme » qui viendra après le dernier homme. Dans Ainsi parlait Zarathoustra, il y a un passage célèbre où la métamorphose de l’itinéraire vers l’Homme le plus élevé est résumée dans le passage du chameau, au lion, puis du lion à l’enfant. Le chameau est la figure de l’homme qui porte le devoir comme une lourde charge, dont la rectitude est un

fardeau où il trouve sa joie dans l’humiliation. C’est la « tartuferie morale du vieux Kant ». Mais l’esprit doit se hâter vers son désert et se transformer en lion. Le lion refuse le « tu dois !» et affirme le « je veux !». Il doit affronter le grand dragon sur le dos duquel brilles les écailles les valeurs. Les valeurs sont millénaires. Le dragon dit qu’il n’y a pas de «je veux !», mais seulement un « tu dois !». Le lion doit accomplir la terrible tâche de trouver arbitraire et non-sens jusque dans les valeurs. Il doit les renverser. Cependant, le conte ne s’arrête pas là. En fait, dans la personne de Nietzsche il s’arrête bien là, puisque Nietzsche a dit clairement qu’il aurait voulu être le plus grand des affirmateurs, mais qu’il n’a pu aller jusque là, et est resté le plus grand des négateurs. Le lion doit se transformer en enfant.
Seul l’enfant affirme, crée, seul la spontanéité de l’enfant peut créer des valeurs sans les subir comme le chameau. L’enfant dit Oui à la Vie telle qu’elle est, l’enfant dit Oui à la puissance magistrale du Devenir. L’enfant est recommencement perpétuel et l’oubli, l’enfant est le Jeu éternel de la création. Seul l’enfant peut faire advenir une aube nouvelle. L’enfant peut être le créateur d’une vie nouvelle dont les valeurs ne seront pas séparées de la vie, mais au service de la Vie.
C’est à partir de cette grille d’interprétation que Nietzsche lit toute l’histoire de la philosophie. C’est ce qui explique les condamnations sommaires qu’il effectue. Il s’en prend à Platon, parce qu’il y voit une division entre la vie réelle et un arrière-monde, le monde intelligible. Il qualifie le christianisme de « platonisme pour le peuple » pour la même raison, parce que le christianisme prône une fuite dans un arrière-monde et dénie la valeur de la Terre. Nietzsche ne manque pas de jugements à l’emporte-pièce pour expédier toute la métaphysique occidentale, rejetée pour la division qu’elle aurait effectuée entre la vie et la représentation. Son but est de montrer que l’individu doit s’accomplir ici bas, en restant « fidèle à la Terre », sans projection idéaliste dans un arrière-monde.
Nietzsche définit
l'idéologie comme un ensemble de jugements de valeur Wertschätzungen. Il appelle
morale toute système de jugements de valeurs en relation avec les conditions d’existence d’un être. Qu’est-ce qui fonde réellement la valeur ? Qu’est-ce qui enracine la valeur dans la Vie ? Pour le comprendre, il est indispensable d’appréhender la Vie, non pas à partir de la biologie, mais essentiellement dans une phénoménologie de la Vie. La Vie est un Soi qui cohère avec soi et s’éprouve dans les modalité affective de son expérience, de la souffrance à l’extase, de la joie à la tristesse, de la peur à l’envie, de la force à la faiblesse. Cette puissance qui est source de toute affirmation de la vie par elle-même, Nietzsche la nomme
Volonté
de puissance. Comme l’explique Michel
Henry dans La Généalogie de la
Psychanalyse, il y a chez Nietzsche trois sens de la valeur :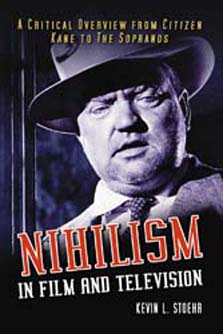
1- En premier lieu la volonté de puissance est valeur en tant que l’originel accroissement de soi en lequel l’être s’édifie intérieurement et se produit.
2 -Valeur en second lieu sont les titres sous lesquels cette œuvre intérieure de l’être est exposée : force (en tant qu’hyperpuissance), débordement, surabondance, noblesse, égoïsme, oubli, beauté, bonté, vérité, tout ce qui est positif (avec comme corrélat l’horreur du négatif), soit les déterminations ontologiques de la vie, tout ce qu’elle trouve en soi, et pour autant que cet acte de trouver est l’ivresse, ne peut s’empêcher de changer et de louer la célébration de soi (nous les nobles, les bons, les beaux, les heureux).
3- Valeur s’entend enfin en un troisième sens, désignant alors tout ce qui dans le monde de la représentation est représenté par la vie comme susceptible de favoriser et d’accroître son essence, à savoir ce qui sert l’accroissement de soi ».
Toute la question du renversement des valeurs tient donc à la relation entre la Vie et la représentation. La primauté absolue et la prééminence fondamentale réside dans la Vie elle-même. Il n’y a de valeur que dans la vie, par la vie et que pour elle, pour autant qu’elle se donne à elle-même, qu’elle s’éprouve elle-même, qu’elle se connaît et crée les conditions de son accès à une conscience plus élevée d’elle-même. « Les valeurs en tant que représentation des conditions de l’accroissement de soi… ne signifient nulle part le primat… de la représentation … bien au contraire réaffirment-elles partout sa dépendance à l’égard de la vie ». Quand la valeur devient un idéal coupé de la vie, détaché de son pouvoir le plus intime, elle engendre l’asservissement. Quand le système des valeurs humilie le Soi, sans jamais l’honorer, il devient morbide. Quand il tue la grandeur, quand il se complaît dans la médiocrité, la trivialité, la bassesse, il n’honore pas le Soi, il l’aliène. Il choisit en définitive le néant contre l’être.
Il est vrai que la vie n’a pas de « sens », parce que le sens posé dans la représentation est seulement représentation de la Vie. Le but de la Vie est précisément de vivre. La Vie s’accomplit dans sa propre expansion et sa propre jouissance de soi. Mais cela ne signifie pas, bien au contraire, que toute valeur donnant un sens à la vie soit arbitraire. Le service de la Vie est la tâche la plus haute et la plus noble et un système de valeurs doit savoir l’incarner. Il ne doit pas devenir un carcans, un dépotoir de préjugés, une promesse pour un ailleurs, cautionné par on ne sait quelle malédiction. Ce dont la religion la trop souvent montré l’image, elle qui n’a su que faire un Dieu à l’image de l’homme ou pour le dernier homme. Comme si l’unique fonction d’un système de valeur n’était que de tenir le chien en laisse. Ce qui justifie les critiques de Nietzsche.
1)
Un système de valeur est l’expression de ce que nous sommes et de notre rapport intime avec la Vie.
Ainsi, pour Michel Henry, le vrai nom de la crise des valeurs qui traverse notre civilisation s’appelle la maladie de la vie. Et quand la maladie de la vie attaque une civilisation, celle-ci s’oriente vers La Barbarie. Titre d’un texte phare de Michel Henry. La maladie de la vie qui consume notre époque se développe dans des pratiques, toutes marquées par la projection dans l’évasion. « La fuite de soi est le titre sous lequel on peut ranger presque tout ce qui se passe sous nos yeux ».L’hyperactivité ne concerne que le système social et sa frénésie habituelle, il a cessé de coïncider avec le don de soi d’un investissement pathétique. Nous voyons autour de nous dans quel état désemparé se trouve notre jeunesse. Quand l’actuel impose son diktat et qu’il n’est plus compris à la lumière des valeurs spirituelle, l’imagination et l’intelligence ne sont plus développées que dans le sens de l’utilité pratique ou de la projection dans l’imaginaire. L’enfant n’a d’autre issue devant lui que de grandir dans un monde artificiel, qui fait tout pour le dispenser d’une interrogation vivante sur le sens des événements et le sens des choses. L’étude se borne au choix d’une carrière et encore, ce n’est pas un choix, car en fait, on ne fait que suivre le marché du travail. La connaissance n’est plus développée pour elle-même, en direction de l’enrichissement de soi. La création artistique n’est pas perçue comme une expression magnifiée de soi, mais n’est plus qu’un divertissement. Le travail a perdu toute attache dans la réalisation de soi. Le travail devient technique et dépersonnalisé. Ce qui dès lors commande la finalité des entreprises, ce n’est plus que la production de masse. Partout se répand une unique orientation dans le sens de l’efficacité et de l’habileté purement technique. Le concept de « performance » devient une valeur et on prétend dispenser des cours pour former la « personnalité », alors qu’il ne s’agit à tout prendre que d’inculquer le sens des affaires. Les relations sociales sont ramenées à des relations de droits ou à des relations fondées sur l’intérêt purement matériel. Ce qui relie n’est plus la relation de soi à soi de la complétude qui donne et se donne, mais l’échange marchand, sa comptabilité, ses investissements, ses calculs, ses fourberies, son hypocrisie, ses secrets et ses mensonges. Plus personne ne sait ce que signifie une relation humaine authentique, honnête et juste, une relation ouverte à autrui et dans laquelle on donne de soi. Tout le temps que nous passons avec les autres est d’abord compté et escompté dans le temps psychologique. Exit la dimension existentielle de l’instant. Le temps, c’est un décompte de périodes, avec des obligations et des échéances. La valeur des objets c'est leur valeur marchande. Que dire des personnes, puisqu’elles sont dans ce contexte ramenées à leur fonction, et leur pouvoir mesuré à la solvabilité de leur compte en banque !
coïncider avec le don de soi d’un investissement pathétique. Nous voyons autour de nous dans quel état désemparé se trouve notre jeunesse. Quand l’actuel impose son diktat et qu’il n’est plus compris à la lumière des valeurs spirituelle, l’imagination et l’intelligence ne sont plus développées que dans le sens de l’utilité pratique ou de la projection dans l’imaginaire. L’enfant n’a d’autre issue devant lui que de grandir dans un monde artificiel, qui fait tout pour le dispenser d’une interrogation vivante sur le sens des événements et le sens des choses. L’étude se borne au choix d’une carrière et encore, ce n’est pas un choix, car en fait, on ne fait que suivre le marché du travail. La connaissance n’est plus développée pour elle-même, en direction de l’enrichissement de soi. La création artistique n’est pas perçue comme une expression magnifiée de soi, mais n’est plus qu’un divertissement. Le travail a perdu toute attache dans la réalisation de soi. Le travail devient technique et dépersonnalisé. Ce qui dès lors commande la finalité des entreprises, ce n’est plus que la production de masse. Partout se répand une unique orientation dans le sens de l’efficacité et de l’habileté purement technique. Le concept de « performance » devient une valeur et on prétend dispenser des cours pour former la « personnalité », alors qu’il ne s’agit à tout prendre que d’inculquer le sens des affaires. Les relations sociales sont ramenées à des relations de droits ou à des relations fondées sur l’intérêt purement matériel. Ce qui relie n’est plus la relation de soi à soi de la complétude qui donne et se donne, mais l’échange marchand, sa comptabilité, ses investissements, ses calculs, ses fourberies, son hypocrisie, ses secrets et ses mensonges. Plus personne ne sait ce que signifie une relation humaine authentique, honnête et juste, une relation ouverte à autrui et dans laquelle on donne de soi. Tout le temps que nous passons avec les autres est d’abord compté et escompté dans le temps psychologique. Exit la dimension existentielle de l’instant. Le temps, c’est un décompte de périodes, avec des obligations et des échéances. La valeur des objets c'est leur valeur marchande. Que dire des personnes, puisqu’elles sont dans ce contexte ramenées à leur fonction, et leur pouvoir mesuré à la solvabilité de leur compte en banque !
Toutes les valeurs postmodernes s’organisent autour d’une valeur matrice, celle de la consommation. Un médecin qui sert le bien-être des hommes, est de ce fait moins « honoré », ce qui veut dire « rémunéré », qu’une vedette de sport ou du show business. L’art, dans ce qu’il a de plus élevé, dans son aptitude à toucher la sensibilité, jeter une lumière sur l’existence humaine, appartient à un monde à part, un monde autre que celui de la vie, un monde de spectacle. La philosophie est communément perçue comme une entreprise vaine et inutile. Celui de se poser des questions là même où communément plus personne n’en pose. Comme si était implicitement admis un contrat tacite selon lequel il est inutile de penser, inutile de s’interroger. Du moment que les rayons du supermarché sont pleins, et que les programmes télé sont attrayants, on est forcément dans le meilleur des mondes possibles. On peut donc dormir sur ses deux oreilles et se dispenser de toute réflexion. La grande majorité des adultes dans notre société n’ont pas lu un bon livre depuis des années, mais par contre, ils peuvent vous réciter par cœur le programme télé pour toute la semaine. Ce qui est très caractéristique de notre époque, « faisant d’elle une barbarie d’un type encore inconnu, c’est précisément d’être une société privée de toute culture et subsistant indépendamment de celle-ci ».
Que dire, dans pareil contexte, de valeurs telles celle de la famille ? Elle est très souvent perçue dans ses aspects négatifs : son rapport de dépendance, la restriction de la liberté qu’elle impose, les intérêts divergents qui s’y affrontent. La donation joyeuse de la richesse affective est perdue de vue. De même, on ne cautionne la relation de couple, que sous la condition d’une garantie de sécurité, d’investissement sexuel et financier. Cela s’appelle le mariage. Ce que l’on appelle « amour », dans les chansons que l’on entend au supermarché, est en fait un attachement égocentrique qui tue l’épanouissement de soi et interdit la générosité.
Bref, quand elle a perdu toute dimension spirituelle, quand la vie humaine n’a plus d’autre valeur que matérielle, toute évaluation passe par des considérations économiques. Le bonheur devient une valeur économique qui se consomme comme le reste et se mesure à ce que l’on est à même de posséder, d’exhiber, il se résume à la sécurité économique, le confort et la jouissance matérielle. Le chien est heureux quand sa niche est confortable et que sa gamelle est remplie tous les jours. Il se tient tranquille. S’il se révoltait, il sentirait la laisse qu’il a acceptée avec le collier : la réprobation diffuse du qu’en dira-t-on, le diktat de l’opinion, la pression de l’économie, les imprécations de la religion, la sévérité de la loi, la force de la police, etc. Autant rester tranquille. Pour tous les paumés du système, pour ceux qui ne peuvent pas accéder à la jouissance matérielle, que reste-t-il ? Y a-t-il une autre issue que la marginalité ? L’évasion nihiliste dans la contre-culture ? La dérision systématique ? Le sabotage et la casse ? La toxicomanie et la délinquance ? Que faut-il faire quand la vie n’a plus de sens que celle d’une survie sans espoir et sans lendemain ? Se laisser gagner par la nausée et entraîner quelqu’un d’autre dans sa chute ? Décrocher le fusil du râtelier et tirer au hasard dans la rue? Le vide spirituel ambiant est aspirant, comme la déglutition du lavabo dont parle Sartre pour désigner l’intimité. Aspirant, déprimant et désespérant. D’autant plus qu’économiquement, il est dans l’intérêt des multinationales qu’il perdure, car il rapporte. Quand on est déboussolé, on consomme n’importe quoi. Pour compenser. On est prêt à trouver une valeur absolue à n’importe quel gadget, n’importe quel leurre bombardé dans une campagne de publicité. Moins la vie a de sens, plus on consomme. On ne sait plus quoi ni pourquoi, mais la pulsion de toute manière est réactivée par le milieu en permanence et il n’est pas possible d’y échapper.
2) Il n’y a pas à s’étonner en conséquence de la résurgence permanente de la violence dans un monde où les valeurs spirituelles ont été perdues, car elle ne fait que manifester la frustration dans laquelle la vie se trouve maintenue. Nous sommes dans un monde où la colère et la rage contenue n’attend qu’une délivrance. Ce n’est pas une violence idéologique ou guerrière mais une clameur de souffrance et d’impuissance. Ce que, dans son for intérieur, la vie cherche, c’est d’être pleinement vécue dans ses multiples potentialités phénoménologiques. Ce que la vie veut se donner, c’est l’épanouissement entier de son propre pouvoir ; ce vers quoi elle tend, c’est toujours une création consciente d’elle-même. C’est précisément le rôle des valeurs spirituelles que de libérer la création de soi par soi. C’est seulement dans les valeurs spirituelles que la relation consciente s’établit entre le soi et la vie.
qu’une délivrance. Ce n’est pas une violence idéologique ou guerrière mais une clameur de souffrance et d’impuissance. Ce que, dans son for intérieur, la vie cherche, c’est d’être pleinement vécue dans ses multiples potentialités phénoménologiques. Ce que la vie veut se donner, c’est l’épanouissement entier de son propre pouvoir ; ce vers quoi elle tend, c’est toujours une création consciente d’elle-même. C’est précisément le rôle des valeurs spirituelles que de libérer la création de soi par soi. C’est seulement dans les valeurs spirituelles que la relation consciente s’établit entre le soi et la vie.
Il appartient à l’éducation de prendre en charge la compréhension des valeurs spirituelles, en permettant à chacun de les redécouvrir par lui-même. C’est à l’éducation de rendre possible la création très tôt d’un système de valeurs chez l’enfant. L’enfant doit pouvoir explorer les valeurs, les comprendre, les rendre fonctionnelles dans sa propre vie et il doit aussi pouvoir les remettre en question. Malheureusement, notre éducation actuelle reste factuelle. Elle se borne à l’instruction. Elle ne prend pratiquement pas en compte les valeurs. Elle inculque un savoir. Elle ne revient pas sur les décisions fondamentales qui sont à l’œuvre dans une société. Elle dit très peu de choses sur le système des valeurs de la société, alors même que celui-ci ne doit jamais être accepté comme fait, puisqu’il relève de choix résultant de jugements moraux. L’enfant devrait pouvoir se poser des questions sur les choix que les hommes ont effectués dans le passé, et exprimer son accord ou son désaccord. Il est extrêmement important qu’il reçoive le choix pour lui-même, qu’il comprenne qu’il est possible de faire des choix différents et que les hommes du passé ont pu commettre des erreurs. Fallait-il lâcher une bombe sur Hiroshima et Nagasaki ? C’était une décision avant d’être un fait, une décision motivée par un système de valeurs. Une éducation intelligente est fondée sur les valeurs et pas seulement sur les faits. Elle prend soin d’attirer très tôt l’attention sur le système des valeurs. L’enseignement traditionnel le savait et c’est pourquoi on se servait admirablement des contes, des légendes, des histoires populaires. Cela permettait de mettre au jour le système des valeurs qui est en amont de toute décision en société. Nous avons sous-estimé l’importance de cette éducation. Nous voulions une éducation « scientifique », ce qui impliquait une éducation factuelle. Nous avons condamné des générations au faitalisme, et au refus de considérer les choix en valeur. Nous avons rejeté les traditions spirituelles en prétextant qu’elle contenait trop de moralisme. Deux erreurs : L’éducation n’est pas seulement factuelle et le moralisme n’est pas le sens vrai d’un enseignement spirituel. Il ne s’agit pas dans l’éducation au valeurs de « faire la morale » à la jeunesse, mais de lui permettre de comprendre comment fonctionne le système de valeurs dans lequel la société est fondée. Il ne s’agit pas de justifier ou de condamner par avance, mais de donner tous les éléments de compréhension nécessaire pour que chacun puisse par lui-même recréer le sens des valeurs, au lieu de seulement de s’y conformer ou de les rejeter en bloc. Le système de valeurs d’une société est avant tout un choix de société. Il est par essence changeant et relatif et nous en sommes tous les cocréateurs. Nous pouvons très bien choisir un avenir différent en prenant appui sur des valeurs différentes de celles qui ont eu cours dans le passé.
Allons plus loin. Si nous voulons pour le futur un monde différent, si nous voulons un monde plus libre, plus heureux, plus respectueux de la vie, un monde dans lequel la vie se sente en quelque sorte davantage chez elle, parce que chez Soi, il nous faudra promouvoir d’autres valeurs que celles qui ont eu cours jusqu’à présent. S’il doit y avoir un dépassement de la postmodernité, dans la cosmodernité, il faut au minimum donner dans l’éducation une importance fondamentale à trois valeurs essentielles :
a) La conscience. Une société éclairée est faite d’individus conscients. Elle n’est pas un troupeau somnolent gouverné par quelques uns, prenant toutes les décisions à sa place. Tout ce qui peut être fait dans le sens du développement de la conscience est utile.
Un être humain devrait grandir dans la conscience, car c’est précisément l’expansion de conscience qui le fait grandir. Tout ce qui est favorable à l’éveil et à la lucidité permet l’accès une vie plus grande et plus libre, mérite d’être encouragé. Toute ce qui contribue à l’enténèbrement de l’esprit, à l’abrutissement collectif, à la crétinisation des masses devrait être évité. C’est déjà une bonne mesure de nos décisions que de se demander si elles vont dans la direction d’une conscience plus élevée, ou d’une conscience moindre. Ajuster nos décisions sur la valeur de la conscience aurait une incidence extraordinaire sur la portée de nos actes.
d’être encouragé. Toute ce qui contribue à l’enténèbrement de l’esprit, à l’abrutissement collectif, à la crétinisation des masses devrait être évité. C’est déjà une bonne mesure de nos décisions que de se demander si elles vont dans la direction d’une conscience plus élevée, ou d’une conscience moindre. Ajuster nos décisions sur la valeur de la conscience aurait une incidence extraordinaire sur la portée de nos actes.
b) L’honnêteté. Une société éclairée est faites d’individus ayant un sens élevé de l’intégrité et pour qui l’honnêteté est une valeur fondamentale. L’honnêteté est cohérence avec soi. Nous ne pouvons être honnête envers autrui qu’en étant honnête envers nous-même. L’honnêteté signifie que l’extérieur reflète fidèlement l’intérieur, elle consiste à dire ce que l’on pense et à faire ce que l’on dit, sans distorsion. Si je dis ce que je suis, sans restriction, honnêtement, alors je n’accorde plus de réalité à ce que j’ai pu construire auparavant par illusion ou par peur. La simplicité prend la place de toute ce que j’avais mis en avant et cru obligatoire et je passe de la peur à la confiance en mettant en conformité l’extérieur et l’intérieur. La simplicité est la demeure dans laquelle le sujet maintient son expérience de lui-même. Le lieu de la coïncidence avec soi dans laquelle précisément toute vie se rencontre. L'honnêteté élimine toute hypocrisie ou artificialité dans la relation, elle élimine ce qui est générateur de confusion et de méfiance dans la relation. Par suite, l’honnêteté se traduit dans le fait de ne jamais employer à mauvais escient ce qui nous a été confié. L’honnêteté est une contribution directe à l’intégrité, car précisément elle permet que l’intérieur se reflète fidèlement à l’extérieur restant un, sans division. L’honnêteté est valeur en ce qu’elle contribue à la construction d’une stabilité intérieure et fournit un fondement à une estime de soi qui ne dépend pas du jugement d’autrui. Comme la conscience, elle contribue à l’auto-référence qui donne son assise profonde à l’autonomie.
c) La responsabilité. Une société éclairée est faites d’individus qui ont en sens élevé et étendu de la responsabilité. Être responsable veut dire avoir de la sollicitude à l’égard de ce qui nous est confié et dont nous avons la garde, depuis celle de l’enfant dont nous devons nous occuper jusqu’à ce qu’il devienne adulte, jusqu’au soin que nous accordons au-delà de notre famille, à notre voisinage et de là jusqu’à la Terre entière dont nous souhaitons la protection. La responsabilité implique avoir conscience des conséquences de nos actes au-delà de la recherche d’une satisfaction immédiate. Cela veut dire aussi avoir conscience que rien n’est séparé, que toute décision nous engage et que nous sommes embarqués sur cette Terre le même bateau. Eduquer dans l’enfant la valeur de la responsabilité l’amène à reconnaître les implications lointaines d’une action et à regarder le monde comme sa famille élargie. L’éducation à la responsabilité décloisonne les visées à courte vue de l’ego en leur offrant une perspective illimitée. La responsabilité invite chacun à prendre en main les rennes de son existence et à accorder un soi à tout ce qui rendre en relation avec notre propre existence. Elle invite l’adulte à se déposer sur les épaules de l’enfant le soin de faire ses propre choix, au lieu de les faire à sa place. Le soin de ne pas cacher ou détourner les conséquences de l’enfant. Elle donne à la lucidité une portée concrète dans l’action en maintenant la flamme de l’attention au cœur de toutes nos décisions.
* *
*
Les valeurs diffèrent des normes. Elles sont l’objet d’une préférence subjective en vue d’une fin que nous estimons digne d’être poursuivie. Les valeurs ne sont pas pour autant des désirs égocentriques, elles s’inscrivent dans la perspective d’une communauté. La communauté de ceux qui sont attachés aux mêmes valeurs. Les normes relèvent d’un consensus social qui possède un caractère d’obligation. La valeur se situe sur le plan de la raison privée, la norme se situe sur le plan de la raison publique. Elle est directement en jeu dans le droit et le fonctionnement des institutions. Dans notre monde contemporain, la relation entre valeurs et normes fait problème. Nous raisonnons comme s’il était justifié de séparer les préférences individuelles et la fonctionnalité juridique. Les normes sociales ne sont pas séparables du système de valeurs à l’œuvre dans une société, mais elles sont davantage avancées dans le consensus.
Toutes les valeurs ne sont pas morales, même s’il est vrai qu’effectivement les valeurs morales ont une place privilégiée dans nos systèmes de valeurs. Ce qui est sûr en tout cas, c’est que notre époque connaît une crise profonde qui atteint de plein fouet les repères de nos valeurs. Une crise qui se traduit par une incapacité de parvenir à les fonder en raison de manière satisfaisante. La crise des valeurs est une crise de la représentation des valeurs dans sa relation intime avec la vie. Elle nous confronte avec la situation indépassable dans laquelle la Vie découvre que sa propre justification n’est qu’elle-même et ne dépend d’aucune représentation. La crise des valeurs nous ramène à l’essence pathétique de la Vie, dans sa puissance de manifestation, son auto-accroissement, son expansion, sa perpétuelle donation à soi et sa jouissance de soi. C’est dans l’intériorité la plus vive que se situe la dimension spirituelle de la Vie. Il y a des valeurs qui servent la vie, d’autres qui la desservent. Il y a des valeurs qui contribuent à son auto-développement, d’autres qui deviennent un carcan et une prison. Notre éducation ne devrait pas dédaigner l’enseignement des valeurs, car le monde économique lui ne les oublie jamais et il aura tôt fait de remplacer ce que nous aurons négligé. C’est notre propre négligence que nous contemplons aujourd’hui avec des yeux effarés, dans le sentiment que tout fout-le-camp et qu’il n’y a plus de valeurs.
* *
*
![]()
![]() © Philosophie et spiritualité,
2005, Serge Carfantan.
© Philosophie et spiritualité,
2005, Serge Carfantan.
Accueil.
Télécharger,
Index thématique.
Notion.
Leçon suivante.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom du site et le titre de la leçon ou de l'article. Rappel : la version HTML n'est qu'un brouillon. Demandez par mail la version définitive..
![]()