Depuis la
destruction de la représentation chosique de la matière accomplie par la théorie
de la relativité et la théorie
quantique, les concepts fondamentaux permettant
de penser les phénomènes physiques sont devenus ceux de
champ et
d’énergie. Dans la nouvelle physique, ce que nous appelons
chose est
une configuration locale d’un champ d’énergie non séparable de
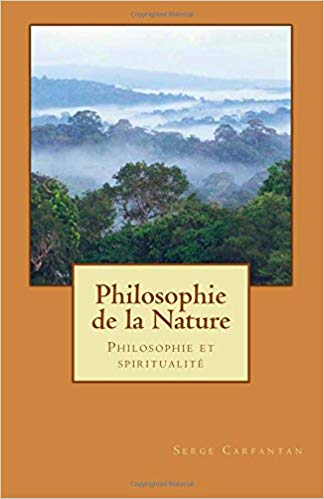 l’univers dans
son ensemble.
l’univers dans
son ensemble.
Cependant, le concept de champ, tel qu’on le rencontre dans la théorie quantique reste marqué d’un flou caractéristique et d’une indétermination fondamentale. On dit de l’électron qu’il est une sorte de nuée, de nuage dans lequel sa détermination en tant qu’apparition événementielle ne dépend que de nos instruments de mesure. A l’opposé, dans tout ce que nous observons, au niveau macroscopique dans notre perception, dans l’attitude naturelle, nous trouvons des structures bien définies.
Le passage d’un champ indéfini vers l’univers structuré dans des formes fait problème. Si l’univers jaillit à chaque instant de la Vacuité d’un champ unifié sous-jacent à la matière telle que nous la percevons, si une fluctuation chaotique en est l’origine, il n’en reste pas moins que la forme organisée est sa loi la plus évidente. L’organisation de l’univers suit même une loi de complexité croissante, depuis les structures cristallines en passant par les entités vivantes jusqu’à l’homme pensant. L’existence des formes, suppose nécessaire une causalité formelle à l’œuvre dans la Nature. La question est donc de faire le lien entre le champ fondamental et les formes manifestées.
Est-il possible de mettre en évidence une matrice formelle œuvrant dans la Nature ? Quel rapport y a-t-il entre les champs et les structures complexes ? La mise en évidence de formes, morphé, de propriétés morphiques dans la Nature, a conduit Rupert Sheldrake à l’élaboration d’une t....
* *
*
Nous avons vu plus haut qu’il était possible de considérer l’ensemble de l’univers comme un champ d’énergie en perpétuelle auto-transformation. Dans cette nouvelle vision, le concept d’objet solide a une valeur qui est relatif à une échelle de perception qui est celle du sujet dans l’état de veille. La théorie quantique montre d’autre part que le champ d’énergie de l’Univers est aussi un champ unifié qui met en corrélation infinie les événements qui se produisent en lui. Elle nous oblige aussi à renoncer au concept de causalité locale en pensant l’événement comme une maille dans une trame infinie de l’espace-temps-causalité. Nous savons que le champ unifié est aussi un champ d’information non-local. Le seul modèle de représentation de l’information compatible avec la nature même des champs est le paradigme holographique. Nous avons aussi vu, en référence avec les travaux de Karl Pribam, que la mémoire humaine, sous la forme des souvenirs, contrairement à ce que croyaient les neurologues du XIX ème siècle, n’est pas ...
---------------1) Le concept de champ n’est pas une découverte récente. Il devait être connu dans la plus haute antiquité. Les traditions spirituelles anciennes parlaient de l’âme bien plus comme d’un champ de conscience enveloppant le corps-physique que comme d’un objet. On savait que l’ambre frotté attire sans contact les brins de paille. La réflexion la plus élémentaire sur le fonctionnement de la boussole conduit à penser qu’il existe dans la Nature une action à distance. A la Modernité, de manière assez paradoxale, c’est la physique qui a fait obstacle au développement de ce concept en raison de son paradigme mécaniste. On sait que chez les cartésiens, la causalité est seulement causalité par contact. Descartes avait pourtant imaginé une « théorie des tourbillons », mais elle est restée lettre morte. Les cartésiens verront dans l’idée d’action à distance avancée par Newton, une hérésie finaliste. C’est pourtant le coup de génie de Newton est d’avoir introduit en physique cette idée d’action à distance, idée qui est passée d’abord pour une monstruosité logique. Newton bouscule le paradigme mécaniste en introduisant un concept très nouveau qui va connaître un développement très important par la suite. Il
___________________________________________________________________________________________________________
’exemple classique de l’aimant et de la limaille de fer. Le champ est dans notre expérience invisible, sauf quand on peut, avec des artifices expérimentaux, parvenir à le manifester, comme dans l’expérience de la limaille de fer. Ce qu’on observe, c’est que l'action du champ dessine une forme. Le champ modèle une structure spatiale. La poudre de fer suit la configuration du champ magnétique, elle épouse son champ de force et se crée ainsi une organisation structurelle caractéristique. La finesse du grain semble rendre l’objet ici très sensible aux influences de champ. Mais nous savons que tout objet de taille plus élevée reçoit aussi une influence. Nous savons par exemple qu’il existe un champ magnétique terrestre. Une chose aussi simple que le fait d’avoir les pieds sur Terre n’est explicable qu’en supposant un champ de gravitation que pourtant nous ne voyons pas. Il en est de même de la relation entre les corps célestes, entre les étoiles et les planètes et de leurs mouvements. Nous ne voyons pas dans quoi se propagent les ondes radio et pourtant, nous notre poste fonctionne dans une pièce fermée de la maison, sans être directement arrosé par une antenne qui serait dehors. Notre poste de télévision contient un tuner qui lui décode des ondes porteuses d’images, ondes qui ...
Faraday admettait la réalité physique des champs, mais pour lui, ils n’étaient pas constitués de matière ordinaire. Les lignes de forces perceptibles autour de l’aimant avaient selon lui :
a) soit une existence physique en tant qu’état de ce qu’on appelait dans les anciennes cosmologies « l’Éther », le plus subtil des éléments dans les anciennes cosmologies.
b) soit en tant qu’état de « simple espace », comme lignes de forces, modifications de l’espace.
Maxwell, par la suite, adopta la première interprétation en voyant dans le champ un état spécifique de l’Éther. Selon lui, l’Éther avait une nature très proche des fluides dans lesquels on forme des tourbillons. En 1916 Lorenz considérait que l’Éther, comme siège de l’électromagnétisme, avait son énergie propre et sa vibration, et en un sens, un certain degré de substantialité.
Einstein suivit lui la seconde interprétation de Faraday en considérant que le concept d’Éther était superflu. Selon Einstein, le champ électromagnétique imprègne l’espace. Le champ n’a plus la moindre base mécanique, il est le siège de processus complexes et il possède à la fois énergie et mouvement. Il peut entrer en relation avec la matière et même échanger avec elle de l’énergie et du mouvement. Cependant, le champ reste indépendant de la matière et ne doit certainement pas être considéré comme un simple état de la matière, c’est plutôt un état de l’espace. L’effort d’Einstein dans la théorie de la relativité générale est d’étendre le concept de champ aux phénomènes liés à la gravitation. La synthèse géniale d’Einstein consiste à montrer que le concept newtonien de force gravitationnelle agissant à distance, se laisse mieux interpréter comme champ de gravitation, ce qui désigne en réalité un continuum espace-temps qui est courbé à proximité de la matière. La gravitation devient alors une conséquence des propriétés géométriques de l’espace-temps. La théorie ...
2) A
l’autre extrême du spectre, dans l’infiniment petit,
nous savons aujourd’hui que nous ne pouvons plus en physique continuer à
maintenir une interprétation des particules sous la forme de petites billes,
comme on le croyait au XIX ème siècle. Le concept de champ a-t-il une portée
dans l’infiniment petit ?
C’est la théorie quantique qui répond à ce genre de
question. Elle part de l’idée que les atomes absorbent et émettent de la lumière
en « paquets», ou quanta. En fait, un rayon lumineux possède cet aspect
particulier de se présenter sous un double aspect celui d’une onde ou d’une
particule. Les particules en question sont appelées photons. En 1924
Louis de
Broglie montre que, de même que les ondes de lumière ont à la fois des
propriétés de particules et d’ondes, les particules de la matière ont aussi des
propriétés des ondes. Jusqu’alors, les physiciens étaient encore tributaires de
la vieille idée de particules sous la forme de très petites
boules de billard. Or
La théorie quantique aboutit à une représentation dans laquelle toute
matière a un aspect d’onde, y compris les atomes et les molécules plus
complexes.
Il faut donc raisonner avec un nouveau concept, celui de
champ de matière quantique. Dans cette interprétation, on dira qu’il existe
un type de champ propre à chaque particule. On dira que l’électron est
un quantum du champ électron/positron, ou le proton un quantum du champ
proton/antiproton. Dans les interactions, les champs entrent en relation les uns
avec les autres ainsi qu’avec les champs électromagnétiques. Il n’existe plus
alors de dualité champ/particule. De plus, le champ de matière quantique est
décrit comme unitaire et c’est en lui que se spécifie la probabilité de trouver
des quanta en un point particulier de l’espace-temps. Comme nous l’avons vu, les
particules sont des manifestations de la réalité sous-jacente des champs. Comme
les champs ne sont rien d’autre que des états de l’espace, ou du vide, il faut
finalement conclure que le vide lui-même est en
fluctuation. Il est une énergie
perpétuellement en mouvement d’où apparaissent et où retournent les quanta. Une
particule ...
----------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
© Philosophie et spiritualité, 2005, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()