L’existence, c’est communément le fait d’être dans l’expérience. La rose dans le vase « existe », elle est là près de ma main, elle rayonne son existence dans la perception que je puis en avoir, elle se donne dans ses formes délicates et son parfum. Elle existe en ce sens pour moi, dans la conscience que j’en ai. Mais elle est dans l’ordre des choses et dans l’ordre de la Nature. Nous
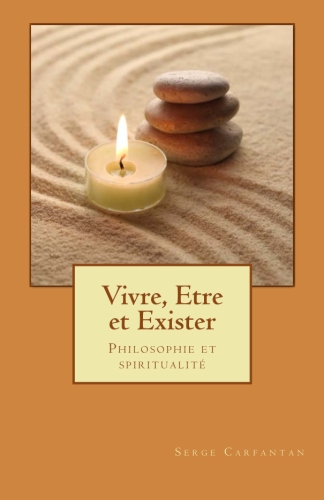 disons à l’enfant qui grandit : « mais non, le père Noël n’existe pas » et il est déçu, il croyait dans son existence.
disons à l’enfant qui grandit : « mais non, le père Noël n’existe pas » et il est déçu, il croyait dans son existence.
Cependant, nous ne pouvons pas mettre toute existence sur le même plan. En tant qu’être humain, je n’existe pas à la manière d’une chose et la seule référence à ma place dans la nature ne suffit pas à m’indiquer où est le sens de mon existence. On pourrait bien sûr dire qu’exister, c’est simplement vivre, mais exister est-ce seulement vivre ? Ce mot « vivre » n’est-il pas bon seulement pour désigner une existence seulement vitale ou l’existence de l’animal qui effectivement, d’un point de vue biologique « vit ». Mais sait-il seulement qu’il existe ? Aurai-je seulement le sentiment d’exister si je me contentais de « vivre » ?
* *
*
Essayons de nous interroger avec attention sur notre expérience de l’existence, mais aussi sur le sentiment d’inexistence. Supposons que je me trouve sur un banc, dans un jardin public. Je suis là, assis sur le banc. Devant moi une rangée d’arbres bien taillés. Un chien passe et quelques pigeons viennent se poser sur les cailloux du parc. Les arbres, le chien, les pigeons, les cailloux existent. Je peux cependant marquer une différence entre ce qui est inerte, tel le gravier, et ce qui est vivant et manifeste un mouvement tel l’oiseau. La pierre existe sous une certaine forme. Le gravier est poli par le passage des promeneurs. Il maintient son existence dans une forme, contre une dégradation continuelle. Il maintient sa cohésion propre. Le caillou persévère dans l’Être d’une manière très élémentaire. Je ne dis pas qu’il vit. L’arbre a une existence plus riche, puisqu’il a en lui déjà un principe de croissance. L’oiseau lui aussi existe, mais il existe avec non seulement un principe de cohésion et de développement biologique, mais aussi avec une capacité de mouvement et une forme rudimentaire de pensée. Il est vivant. Lui aussi tend à se conserver. Il n’est rien qui dans la Nature ne cherche à persévérer dans l’Être. (texte)
1) C’est là qu’il nous faut prendre la mesure du sens exact que nous donnons aux mots. Sur le fondement de la vigilance, je peux dire que la pierre existe, je ne peux pas dire qu’elle vit, par contre de l’oiseau je peux dire qu’il existe et qu’il vit. Le terme vivre peut s’entendre au sens:
a) biologique et c’est à cela que l’on pense tout d’abord, c’est-à-dire que nous réduisons la vie au phénomène vivant. Le vivant est l'objet d'étude de la biologie.
---------------b) phénoménologique. Il y a pourtant une autre signification de la vie. La Vie c’est aussi ce qui se manifeste à soi-même dans le vécu de la conscience. Je ne peux pas préjuger de ce qu’éprouve l’oiseau. Il est peut-être possible qu'existe une forme virtuelle de conscience dans le caillou dont je ne peux rien dire. Mais je sais bien par expérience que je vis en ce sens que je m’éprouve moi-même dans des vécus. La plénitude de la Vie, telle que je puis parfois l’éprouver, est une plénitude d’éveil et une plénitude de conscience, ce n’est pas d’abord un fonctionnement biochimique. Par extension, je suis porté à considérer le terme exister à partir du vécu. Nous en avons parfaitement le droit, mais nous devons aussi nous rendre compte qu’alors le mot ne relève pas de la biologie, mais plutôt de l’approche d’une phénoménologie de la Vie. Mais si l’existence est ce que nous vivons, ce que nous vivons est différent de ce que nous pouvons seulement penser de la Vie. L’existence n’est pas un simple concept, elle est la réalité elle-même.
2) Et c’est là que surgit la difficulté.Nous suffit-il d’exister pour savoir ce que signifie exister ? Rien n’est moins sûr et c’est ce que veut montrer Sartre dans La Nausée. Les arbres dans le jardin sont là, « il y a » les pigeons, le chien qui court, la racine de marronnier. Tout cela « existe » devant moi, mais pourquoi ? Je n’en sais rien. Cela surgit d’abord devant moi et ce n’est qu’ensuite que je puis en trouver le sens. L’existence s’impose à moi avant la connaissance que je puis en avoir. Dans les
--------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
.
Questions:
1. Faut-il invoquer seulement des raisons historiques pour rendre compte de la vogue de la littérature de l'absurde à l'après-guerre?
2. Quelles relations y a-t-il entre le temps psychologique et le sentiment de l'absurde?
3. Faut-il croire que le projet permet "d'échapper à l'ennui" et de "fuir l'absurdité de l'existence"?
4. Faut-il ajouter "une" passion à la vie pour la rendre "intéressante"?
5. La plénitude de l'Être ne nous est-elle accessible qu'au contact de la Nature?
6. Faut-il distinguer la Présence au maintenant du sentiment d'exister en général?
7. Est-ce le souci constant de devenir de l'ego qui crée l'angoisse ou le seul sentiment de l'impermanence?
![]() © Philosophie et spiritualité, 2002, Serge Carfantan.
© Philosophie et spiritualité, 2002, Serge Carfantan.
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom du site et le titre de la leçon ou de l'article. Rappel : la version HTML n'est qu'un
brouillon. Demandez par mail la version définitive..
![]()