Dans Le
Discours de la Méthode, dans le seconde maxime de la morale provisoire,
Descartes se sert d’une image, celle du voyageur égaré dans une forêt qui cherche son chemin
pour en sortir. Mieux vaut prendre une direction unique et ne plus
en dévier que de tourner en rond. C’est aussi le sens de la
méthode. (texte) Donner une direction de travail.
Comme par hasard (!) le mot méthode
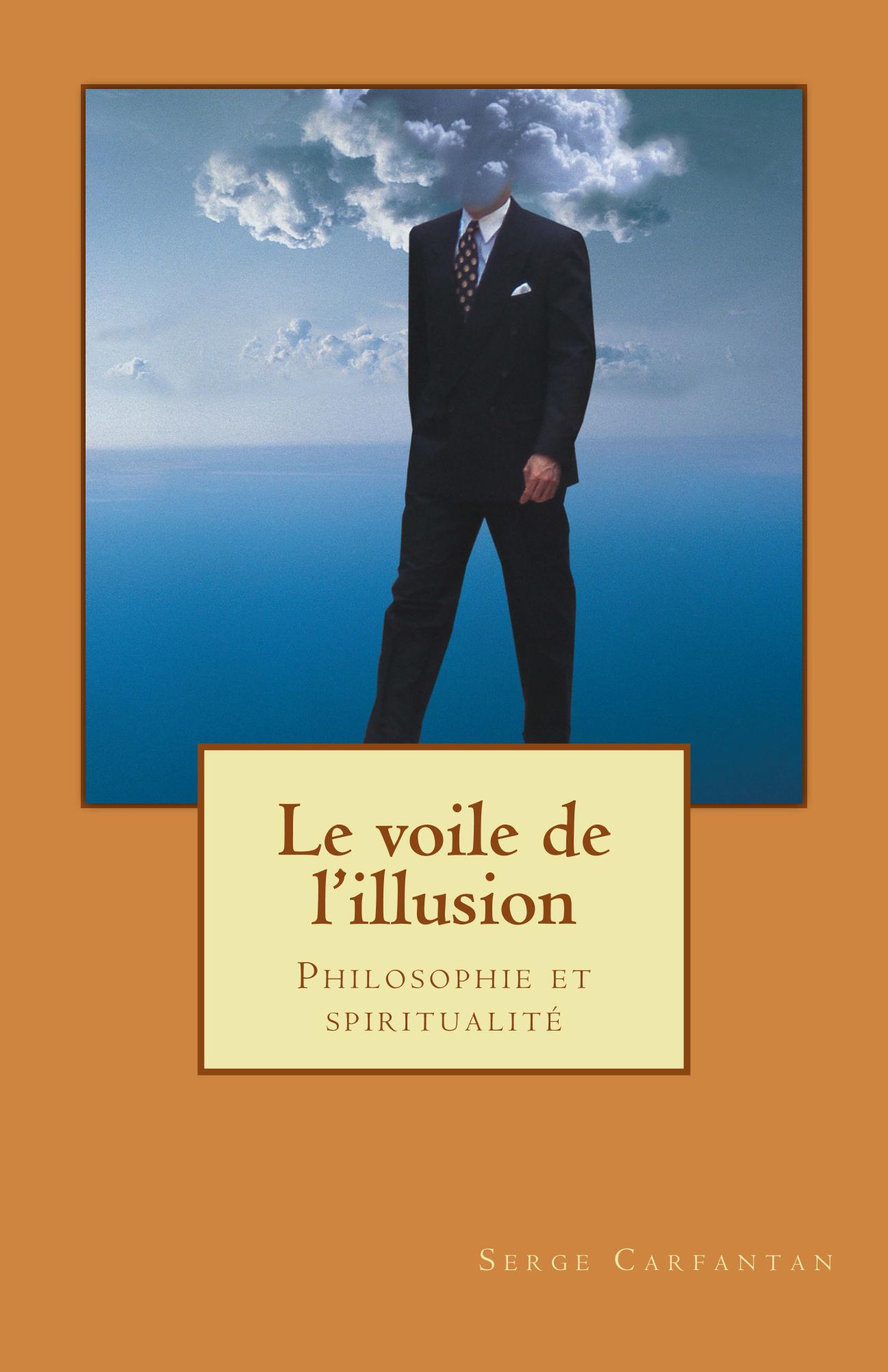 est
justement formé sur odos,
le chemin (texte). De la suit un
principe juste, qui devrait donner à l’intellect
les moyens de sortir de l’égarement où il se trouve placé et de l'indécision.
est
justement formé sur odos,
le chemin (texte). De la suit un
principe juste, qui devrait donner à l’intellect
les moyens de sortir de l’égarement où il se trouve placé et de l'indécision.
Mais la question est subtile parce que pour sortir de l’égarement, il faut d’abord prendre conscience que nous sommes égarés. Il faut sonder l’égarement lui-même, ce qui revient à voir l’illusion en tant qu’illusion. L’égaré est celui qui va de ci, de là, revient sur ses pas, marche à l’aveugle parce qu’il a perdu la route. Il divague. L’égaré s’est perdu. Il est perdu dans le monde et son esprit est sans repères. Mais s’en rend-il compte ? Rien n’est moins sûr. S’il pouvait au moins prendre conscience qu’il est perdu, il se mettrait à chercher son chemin. C’est la différence entre l’ignorant qui est englouti dans l’illusion, et le chercheur de vérité qui a pris conscience de l’illusion et se met en quête du Réel, du Vrai et du Juste. Comme dirait Platon. Souvenons-nous de ce que nous disions plus haut sur les trois degrés distingués par Platon, l’opinion en général, l’opinion droite et la connaissance. Il était encore question d’un voyageur égaré, mais qui cherchait sa route vers un village, Larissa. Le chercheur de vérité est en chemin, il a au moins la ressource de suivre les conseils de ceux qui connaissent la voie. Ce qui n’est pas suffisant, car il faudra aussi marcher pour s’y rendre. (Un clin d’œil : dans Matrix Morpheus dit à Néo : tu devras comprendre qu’il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin !)
... a une portée gnoséologique liée à la méthode. On en trouve la réédition dans un traité inachevé de Spinoza Le Traité de la Réforme de l’Entendement. Il serait intéressant d’ailleurs de comprendre pourquoi ce texte est resté à l’état de projet. Mais il est évident que l’égarement a surtout une signification existentielle. Il pointe vers l’illusion dans laquelle les hommes vivent, ne sachant qui ils sont et ne sachant où aller. Donc, que veut dire sortir de l’égarement ?
* *
*
Dans une leçon précédente, nous avons été très sévère au sujet de la télévision, vu l’effet de fragmentation qu’elle produit dans l’esprit. Quand, en l’espace de quelques secondes, l’esprit passe depuis le meurtre du petit garçon, au paquet de lessive, du paquet de lessive aux élections, des élections au loto, du loto à la fermeture de l‘usine, de la fermeture de l’usine aux people etc. il est plongé dans la confusion, soûlé par des images et interdit de compréhension. Égaré. C’est le nuage d’inconnaissance dont parle Edgar Morin, expression d’origine bouddhique qui traduit bien l’idée d’égarement. En laissant passivement l’esprit se disperser dans une telle mixture, nous incitons les êtres humains à confondre une image vidéo clip de la vie avec la vie réelle, ce qui sans aucun doute produit un effet d’égarement. Mais ce n’est là que le symptôme le plus apparent. Il est important de considérer en tout premier lieu la dimension existentielle de l’égarement.
1) C’est peu de dire que nous vivons dans une culture qui s’ingénie à nous couper de tout et à induire un sens de la séparation. L’individu de l’individualisme, c’est une feuille au vent. Comme la feuille qui tourbillonne, il se laisse emporter. Il suit les fluctuations des humeurs collectives, des courants d’opinions, des rumeurs et des modes, il ne sait pas très bien où il va, mais comme il suit tout le monde, il en oublie qu’il est perdu. Ce qui lui manque, c’est le sens de l’auto-détermination, l’expression vive et forte de la Nécessité intérieure qui fait que, loin d’être agi, il serait vraiment en acte. Ce qui implique souvent de nager à contre-courant. Un homme qui suit son étoile et met en mouvement ses vrais désirs est sorti de l’égarement qui le conduit à abandonner sa volonté aux pulsions d’une foule. La foule des égarés.
L’individualisme est donc très paradoxal. Il est une repli sur soi, un repli dans la sphère égotique, donc en apparence, en rupture avec le collectif, mais c’est un « moi » sans substance qui n’est que l’écho du tambour de la conscience commune. L’ego en quête de reconnaissance n’aime rien tant que la banalité de ce que l’on dit, de ce que l’on fait et de ce que tout le monde pense. Étrange situation donc, dans laquelle chacun prétend vouloir se distinguer des autres, « s’écarter des grandes foules », comme dit Heidegger, mais où chacun est semblable à tout autre, sans véritable détermination intérieure qui lui soit propre. C’est un peu comme dans ce film, l’Éveil, tourné dans les murs d’un hôpital psychiatrique, où les malades restent prostrés, tétanisés, et ne trouvent de volonté qu’en empruntant un mouvement extérieur qui leur donne un élan. Une balle de caoutchouc lancée, le sujet peut la suivre et la rattraper. Mais il n’aurait pas pu se lever de lui-même pour faire le même geste. Il emprunte sa volonté au mouvement de la balle, donc à une suggestion externe.
Ainsi en est-il de ce que René Girard appelle le désir mimétique. J’ai vu la tablette électronique et l’excitation était à son comble en famille pendant les fêtes autour de l’objet. Ces petites images qui bougent, ces programmes plus attrayants les uns que les autres… La suggestion est trop forte, me voilà possédé du désir d’avoir moi aussi l’objet. Il m’est livré... L’excitation se maintient un jour ou deux… et je me rends compte qu’en réalité je n’en n’ai pas l’usage. Il finit par rester abandonné et inutile dans un tiroir... J’ai dû avoir un moment d’égarement au moment où je l’ai acheté.
Maintenant, supposons toute une vie sur ce modèle, qui ne ferait que papillonner d’un objet à l’autre sous l’effet d’une suggestion, une vie dans laquelle pas un seul désir ne serait vrai, ou une vie dans laquelle à 95% les désirs seraient des faux désirs, des désirs fictifs. Du point de vue du marketing, ce serait le consommateur idéal ! Mais de l’intérieur, un vide existentiel impressionnant. Derrière chaque désir un moment d’égarement. Le sentiment constant que l’on à beau faire, rien n’est jamais satisfaisant, que l’on ne sait pas ce que l’on veut, et que plus le temps passe, plus le vide se creuse. D’où le regard étrangement triste de ces gens qui possèdent beaucoup, mais dont la vie n’a pas de sens ; le regard égaré d’une âme perdue au milieu d’une prospérité apparente, mais dont la vie intérieure est un vraie désastre. Regard égaré encore, de l’homme qui, au contraire n’a rien, se ronge dans la misère, mais fantasme devant son poste de télévision en regardant la vie idyllique de la jet-set, de ces gens qui peuvent se permettre tous les caprices, qui doivent donc avoir une vie « bien remplie », puisqu’ils ont tout pour être heureux. Et puisque nous sommes dans l’égarement, continuons : tandis que le plus riche s’achètera de la drogue pour se sentir mieux, le pauvre ère n’aura peut être plus d’autre expédient que de devenir dealer et la lui vendre.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Et pendant ce temps, dans les immenses cités humaines, des ados errent en bandes dans les couloirs du métro, calfeutrés et les yeux masqués par des cagoules. Pas de repères, pas vraiment de but. Égarés dans tous les sens du terme, ils rodent de couloir en couloir, de rue en rue. Exutoire de la proc’ et de la casse. A New York, d’autres jeunes en bandes ajoutent à la tenue un masque de carnaval et tabassent un jeu asiatique, pendant qu’une fille suit la scène et filme avec son portable. La dernière mode sur le Net pour faire le buzz. On s’émeut chez les politiques d’une épidémie de violence urbaine publiée sur Internet. Mais c’est juste sporadique, on oublie aussitôt. Un autre objet dans l’actualité capte l’attention. L’égarement c’est justement ce sautillement sans repos d’un objet à l’autre. Un autre buzz pour exciter l’émotionnel. Une futilité, histoire de s’occuper quand on ne sait pas quoi faire et que l’on est réduit à la recherche de stimulants. Et comme un effet boule de neige cette subjectivité avide, comme dit Michel Henry, se déverse sur Internet. D’autres stimulants, d’autres substituts de sens pour une vie égarée. A foison débauche de pornographie avec surenchère dans l’obscénité. Pas vraiment pour la perversité, mais par compulsion, pour tenter de trouver quelque chose qui secoue l’ennui : un « délire » comme on dit dans la téléréalité. L’excès devient norme et il n’y a pas de limites, manière de se maintenir hors de l’eau en trouvant quelque chose « d’excitant » que l’on puisse montrer. Repasser en boule sur Face... A ce rythme fou, l’habituel devient un repère fuyant, équivalent de ce qui est bon, surtout si on frôle les interdits et puis il est chassé par un autre. Rien de tel pour secouer l’ennui que de se donner quelques frayeurs ou quelques dégoûts pour se sentir un peu exister. Que dire ? ...
2) Dehors, on peut se joindre à la marche erratique des égarés des grandes villes. L’égarement se lit dans le regard et si nous observons bien, nous verrons qu’il se traduit par une allure étrange. Giono disait que les citadins marchent d’une manière sans vraiment toucher le sol. L’homme de la terre marche posé, d’un pas égal en embrassant le paysage. Il existe une noblesse du pas de celui qui est comme porté par la totalité. L’égaré a quelque chose de rigide, décalé, déconnecté de la totalité. Il ne remarque rien de ce qui l’entoure. Son regard est fixe, tout occupé à ses pensées. Sa marche est somnambule, sans amplitude sensible. Il est coupé de tout. Comme il est perdu dans ses pensées, il est aussi perdu dans le monde où ne fait que se déplacer d’un point à un autre. Il ne marche pas consciemment. Il marche inconsciemment. Et le plus souvent il marche à côté, ou il croise, d’autres marcheurs égarés. Ils traverseront un parc, comme absents, sans interrompre leur monologue intérieur. Ils entreront dans une galerie commerciale ou un supermarché, comme absents, sans interrompre leur monologue intérieur. Non d’un pas décidé pour prendre juste le nécessaire et sortir, mais d’un pas irrégulier, attendant vaguement d’une vitrine une suggestion, avant que de retourner à leurs pensées. Ils croisent de temps à autre un visage connu dans les lieux publics. De quoi bavarder un peu, mais le plus souvent sans se rencontrer : occasion de verbal outlook, verbaliser un peu le monologue interne en direction de quelqu’un. De quelqu’un qui, si on lui laisse en placer une, aura l’occasion à son tour... de verbaliser son monologue interne en direction de quelqu’un. Ce qui permet à chacun d’y rester et de n’en jamais sortir. Le moi se raconte des histoires et en raconte à d’autres.
Et puis retour au bercail il fait des histoires. Là, le monologue interne devient interprétatif et performatif, se transforme en remarques, reproches, récriminations. La ronde des pensées égarées se mue dans une cascade de réactions prévisibles. Toujours les mêmes. L’égaré devient amer et agressif, vaniteux ou dépressif etc. selon ce qu’il a programmé dans ses pensées, souvent des années durant. Oublié la politesse envers le supérieur hiérarchique, l’étranger ou l’inconnu, place aux empoignades familiales. La relationnel chaotique c’est d’abord derrière les volets clos.
Le monde du travail n’abolira pas l’égarement, mais lui donnera une autre forme d’expression. Il n’a en effet pas de rapport avec les objets ou les personnes, mais avec la conscience du sujet. L’égarement est un état de conscience, il se transporte aisément partout et contamine tout ce qu’il touche avec sa lassitude, son indécision et de son absence. Regard vitreux de l’OS qui prend la file derrière la pointeuse et rejoint, morne et déjà fatigué, son poste de travail. Perdu dans un monde trop difficile, trop douloureux, trop complexe où il ne sent à sa place nulle part… « Qu’est-ce que je fais là ?... Ce n’est pas comme ça que je voyais ma vie… Vivement que la journée se termine ». Non loin de là, dans le métro, des gens qui, déjà sous pression à l’idée de ce qui les attend, se rendent au bureau, le regard par avance écarquillé par l’urgence des tâches à mener et des objectifs à atteindre. Égarés et harcelés à la fois, égarés parce que harcelés. L’inquiétude et la peur au fond des yeux. Absents au monde et absents à eux-mêmes au fur et à mesure que la pression monte. « Rendez-vous…coups de fils à donner. Je vais encore devoir courir toute la journée… Et puis les résultats… » A moins que le bureau ne soit que les longues heures d’un mortel ennui, auquel cas, en partant l’esprit est déjà égaré dans un ailleurs et il sera en fuite tout au long de la journée. Vers l’ailleurs des vacances. Un autre regard égaré. Et comme il se doit, le plus souvent, quand ce temps de délivrance arrive, l’existence demeure égarée et le regard retrouve à peine son étincelle. Le touriste le plus souvent est aussi un homme perdu, embarqué avec d’autres égarés dans un bus qui va d’un point à un autre, suivant les étapes d’un itinéraire balisé par l’agence de voyage. Et l’on continue ce train-train des années durant. Et comme la fin de vie approche, les regards égarés deviennent maintenant des regards effarés. Le monde devient de plus en plus étrange, hostile et incompréhensible. ...
De proche en proche, comme un signe qui mène à un autre signe, un égarement mène à un autre égarement et personne ne voit la folie de l’ensemble. Quand la présence à soi et la présence au monde a perdu toute sa substance, les coquilles sont vides, les hommes sont égarés, parce que le mental humain s’est égaré. Ainsi va le monde que l’égarement des hommes y est protéiforme.
------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Questions:
1. Quand nous parlons d'égarement, est-ce d'égarement de la pensée? Des sentiments? De la raison?
2. Celui qui est égaré a-t-il conscience qu'il a perdu sa route?
3. Peut-on renverser la formule en disant que les hommes suivent exactement la bonne route et celle qu'ils ont décidé de suivre?
4. Le défaut de savoir et d'instruction pourrait-il remédier à l'égarement?
5. Que notre civilisation ait décidé d'entrer dans la voie objective ouverte par la techno-science la prédisposait-elle à laisser la subjectivité humaine dans l'égarement?
6. En quel sens la souffrance est-elle un rappel à l'ordre?
7. Comment peut-on tout à la fois affirmer que l'homo sapiens est en même temps homo demens?
© Philosophie et spiritualité, 2012, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()