Dans les
années 60-70 se développait en Occident, dans la lignée de
Kierkegaard, la
Pensée de l’existence.
Sartre
revendiquait clairement la paternité de
l’existentialisme. Camus était classé
« existentialiste » par les journalistes, mais se défiait du terme et
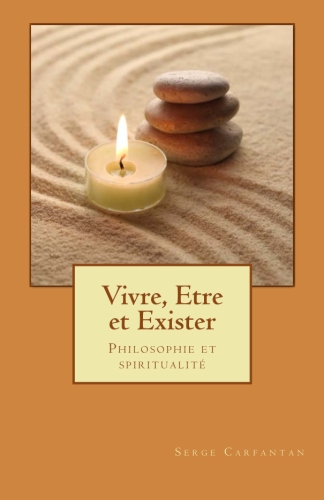 refusait
être rangé dans une doctrine. On a parlé à cette époque d’existentialisme
athée avec Sartre et
Simone de Beauvoir et d’existentialisme
chrétien avec
Karl Jaspers et Gabriel Marcel. Ce que partagent ces
différents auteurs, c’est un certain nombre de thèmes évoquant les
situations limites comme l’angoisse,
la mort, la
déréliction, l’absurde, la
finitude de l’existence
humaine. C’est aussi une manière de
philosopher rattachée à l’expérience
subjective, contre la tentation objective de l’esprit de
système à la manière de
Hegel, dissolvant
toute réalité dans le concept.
refusait
être rangé dans une doctrine. On a parlé à cette époque d’existentialisme
athée avec Sartre et
Simone de Beauvoir et d’existentialisme
chrétien avec
Karl Jaspers et Gabriel Marcel. Ce que partagent ces
différents auteurs, c’est un certain nombre de thèmes évoquant les
situations limites comme l’angoisse,
la mort, la
déréliction, l’absurde, la
finitude de l’existence
humaine. C’est aussi une manière de
philosopher rattachée à l’expérience
subjective, contre la tentation objective de l’esprit de
système à la manière de
Hegel, dissolvant
toute réalité dans le concept.
Mais, de part son refus des abstractions vides, la philosophie de l’existence court le risque de s’empêtrer dans le subjectivisme qui n’est rien d’autre que celui du moi, de l’existence personnelle et de manquer l’Être. A cette même époque on vit donc apparaître chez Heidegger ce qu’il appelle la Pensée de l’Être, qu’il distinguait nettement de la pensée de l’existence. Heidegger se meut dans un air plus raréfié, celui de l’appel de l’Être et ne cesse de revenir vers la nécessaire ouverture cette fois impersonnelle de l’homme à l’Être. Mais ici, le chemin de mène nulle part et il est difficile de voir à quoi aboutit cette philosophie qui semble se perdre dans des incantations poétiques.
Ce qui étonnant dans l’opposition de ces deux styles de philosophie, c’est qu’elles se trouvent confrontées avec les limites même de la pensée, les limites du concept et de l'abstraction. (R) Simultanément, apparaissent deux niveaux dans la subjectivité, celui de l’existence du moi et un autre niveau dont les contours sont impossibles à tracer, du rapport intime entre le Soi et l’Être. La pensée peut-elle appréhender l’Être ou doit-elle se cantonner à décrire l’existence?
* *
*
Heidegger voyait dans la prolifération des « -ismes » un effet de la dictature de la publicité (texte). Le suffixe « -isme » permet, chez ceux qui l’adoptent, de fixer le nom d’une doctrine. Inversement, pour ceux qui cherchent la polémique, il sert à enfermer un adversaire éventuel dans une position arrêtée, à le ranger dans un tiroir conceptuel d’une catégorie générale. Il peut être utilisé aussi pour désigner un courant de Pensée. Par existentialisme nous pouvons entendre un courant de Pensée de l’après-guerre qui a cherché à renouveler la philosophie en partant de l’existence humaine concrète. Y a-t-il réussi ? C’est ce que nous allons examiner, tout en rappelant les résultats d’investigations menées auparavant.
1) Le mot ex-istence, comme les mots ex-tériorité, ex-plosion ou ex-stase indique une sortie de soi, une poussé au dehors allant éventuellement jusqu’à la dispersion. Nous avons vu précédemment que l’existence implique l’espace-temps-causalité. Tout ce qui existe apparaît à un moment du temps, se maintient une certaine durée et disparaît, dans la dissolution de sa forme. L’existence se déroule sur la scène de l’espace et elle fait intervenir le conditionnement propre à la série des causes qui la manifeste. Toute existence est donc phénoménale. Nous appelons monde relatif le champ de la phénoménalité. Le monde relatif est le domaine de l’impermanence où tout ce qui vient doit s’en aller, car rien dans l’existence n’est éternel. Le monde phénoménal est aussi le domaine de l’expérience car l’existence c’est aussi le fait d’être dans l’expérience. Rien de plus et rien de moins non plus. La rose dans le vase « existe », elle est là tout près, elle rayonne de sa beauté et de son parfum, elle rayonne son existence dans la sensation que je peux avoir d’elle si je lui prête attention. Elle existe uniquement dans la conscience subjective que j’ai d’elle et non pas en l’air dans on ne sait quelle soi-disant réalité, dans une abstraction objective sans conscience. Ce qui ne veut rien dire du tout.
Maintenant, ... dans laquelle l’existence nous apparaît, prend place à l’intérieur d’un état de conscience. Nous avons appelé états de conscience relatifs l’état de veille, de rêve et de sommeil profond. Ce point a été négligé, mais il est capital. Il est essentiel de comprendre que les caractéristiques de chaque état de conscience modèlent le type d’expérience vécue dont nous sommes le sujet et elles structurent le sujet lui-même. La relation sujet-objet dont nous servons pour tenter de comprendre la conscience ainsi que le concept d’ego auquel nous sommes tellement attachés, n’ont de sens qu’à l’intérieur de l’état de veille. Dans le rêve les contours se dissolvent et l’opposition sujet/objet, si elle est vécue comme réelle par le rêveur, s’avère en réalité une illusion. De même, l’ego dans le rêve n’est pas complet, il repose sur le subconscient, il n’a pas accès à l’incarnation comme dans l’état de veille. Cependant, pour le besoin de l’expérience, nous voyons que l’esprit dans le monde onirique constitue tout à la fois une relation sujet-objet et aussi une forme identité qui n’est très visiblement que l’écho de la mémoire. Dans le sommeil profond, la relation sujet-objet disparaît, nous pouvons dire que l’existence différenciée s’est complètement résorbée, elle reflue dans l’Être. Simultanément, l’ego disparaît. Notre moi est aboli toutes les nuits, tandis que pourtant perdure un sentiment d’êtreté qui va permettre au dormeur de structurer à nouveau un ego au réveil, à partir des bribes de ses souvenirs. Dans le sommeil profond, le monde disparaît et ainsi, quand nous parlons du monde de la vie, il ne faut pas oublier que ce monde un et commun n’existe que pour des sujets entrés dans la vigilance ou parvenus à une conscience lucide. Sinon le concept ne veut strictement rien dire.
---------------Or ce qui est étrange et mystérieux, c’est que quelque chose se produit. Dans la vigilance ordinaire le sujet semble complètement chuter dans l’objet, de sorte que la domination de l’objet est précisément la forme d’expérience qui nous est la plus habituelle. C’est la matrice de toute déréliction. Nous en avons une admirable illustration jusqu’à la limite dans la phénoménalité du rêve. Quand la vigilance s’affaiblit, le sujet glisse du plan conscient vers le subconscient. Il tombe dans un certain degré d’inconscience, sans pour autant perdre l’aptitude d’expérimenter ; et ce qui a alors lieu c’est une forme d’hallucination dans laquelle il se perd dans l’objet, en vertu d’une identification au monde des formes. Se perdre soi-même dans les objets des sens est ignorance au sens radical, car le sujet qui s’est égaré dans le monde des formes, a perdu toute conscience de soi, il est sous l’empire de la conscience d'objet. Il est jeté dans le monde des objets. Il ne sait plus qui il est, il ne se connaît plus lui-même, il erre dans le monde des formes. Et bien sûr cette ignorance fondamentale se produit aussi dans notre soi-disant « vigilance », chaque fois que notre conscience s’affaiblit, que nous sommes entraînés dans un défilé de pensées obscures et que notre qualité d’éveil est émoussée. Chaque fois que nous perdons la Présence pour nous enfoncer, regard éteint, dans l’absence. Bref, dans ces conditions, contrairement à ce que nous pourrions croire, il n’y a plus grande différence entre l’état de veille et l’état de rêve, parce que cette forme de conscience est lourde, inerte et régressive. Les caractéristiques du rêve viennent alors teinter l’état de veille, comme une tâche d’encre qui se répand sur un buvard. Absence, attention distraite, égarement des pensées confuses, bruit parasite du mental, hallucination de spectateur devant l’écran, bouffées émotionnelles induites par une macération de pensées, vie sous perfusion dans le virtuel, existence fantomatique, propension à la fuite, recherche d’extase ; à l’image de l’homme qui voudraient disparaître dans le néant des images, pour ne jamais plus éprouver ce profond malaise de n’être jamais soi. Sentiment constant d’inachevé, d’inaccompli, d’insuffisance. Projection constante dans le futur, dans la promesse d’un but transcendant, d’un perfection glorieuse, contre la réalité médiocre et pâteuse de l’existence. Angoisse terrible de la mort qui menace à chaque instant d’interrompre la projection vers l’ailleurs et l’autrement. Angoisse latente d’anéantissement possible d’une vie qui au bout du compte d’aurait pas été vécue, n’aurait jamais été à la hauteur de ce que le ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Les philologues font remonter l’existentialisme à Pascal qui, dans les Pensées, donne une description de la misère de l’homme, l’effroi devant le temps et l’errance dans le temps. (texte) Mais dans un éclair de génie Pascal a vu que si le malheur de l’existence humaine tient à l’incapacité à se tenir dans le présent, (texte) son bonheur éclot dans la disponibilité pleine et entière au présent. Là où se rencontre la Joie. On a dit que Zola a toute sa vie a balancé entre la souffrance d’exister et la joie d’être, ce qui décrit à merveille le drame pascalien. L’existentialisme a glosé sur la première expérience, tandis qu’il s’est révélé incapable de parler de la seconde.
Prenons le début de L’Existentialisme est un Humanisme de Sartre : « On nous a reproché… de souligner le sordide, le louche, le visqueux, et de négliger un certain nombre de beautés riantes, le côté lumineux de la nature humaine ». Nous l'avons vu avec La Nausée. (texte) Ignorer ce qui est lumineux en l’homme, c’est manquer l’essentiel et justement la condition de l’ignorance consiste à vivre coupé de l’essentiel (texte). Le grand mérite de l’existentialisme est d’avoir décrit la condition de l’homme dans l’ignorance. Son plus grand échec a été son incapacité à cerner l’ignorance en tant que telle.
Qu’est-ce donne profondeur à l’existence de l’être humain, sinon la conscience qu’il a de lui-même et de ce qui va au-delà de lui-même ? Toutefois, cette conscience, dominée par l’objet, est seulement conscience-de-quelque-chose, conscience intentionnelle. Qu’est-ce qui caractérise une conscience qui est seulement conscience de quelque chose ? Qui n’a quasiment pas de conscience-de-soi en deçà de tout objet? Elle est comme la conscience du garçon de café (texte) décrit par Sartre : un courant d’air. Si vous rentriez en elle, vous seriez comme un vent projeté dehors, là-bas, dans l’objet: « main qui se lève à la table 33 », ou dans un autre objet-pensée du genre : « il n’a toujours pas fini de manger celui-là… » ou «vivement ce soir, j’en ai ma claque aujourd’hui ». La condition ek-statique de la vigilance vient de cette projection constante de la conscience dans les objets. La subjectivité, dans son sens le plus banal qui soit, est cela même, elle existe d’abord sous la forme de pensées dans le contenu de l’activité mentale. Ces pensées tournoyantes, agglomérées sous la forme d’un « moi », se donne l’identité d’un rôle. L’existence humaine en tant qu’elle est une volonté qui fait des efforts pour obtenir quelque chose dans le un futur n’est rien d’autre que cela. Cela n’a rien à voir avec une quelconque « culture ». C’est tout simplement humain. Ce que Sartre appelle « élan de l’homme vers l’existence » est aussi un « mouvement pour se fuir » par lequel l’homme « se fait » lui-même. « L’homme est seulement, non seulement tel qu’il se conçoit, mais tel qu’il se veut, comme il se veut après cet élan vers l’existence ; l’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait. Tel est le premier principe de l’existentialisme. C’est aussi ce qu’on appelle la subjectivité ». Rien que de très banal donc dans cette formulation de la subjectivité happée par le temps psychologique, identifiée à la volonté, campée dans un rôle et à la poursuite d’un but lointain dans l’avenir. De manière conséquente, Sartre va donner ensuite une définition de l’humanisme qui sort du même tonneau : « L’humanisme … signifie au fond ceci : l’homme est constamment hors de lui-même, c’est en se projetant, en se perdant hors de lui qu’il fait exister l’homme… en poursuivant des buts transcendants ».
Mais que cherche-t-il ? S’il existe tout entier dans la tension du futur, c’est qu’il refuse nécessairement d’être au présent. Il se dit en pensée par devers lui-même que s’il s’ouvrait au présent, il aurait l’impression « d’être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur » ! Le futur est plus stimulant. « L’homme est d’abord ce qui se jette vers un avenir, et ce qui est conscient de se projeter dans l’avenir. L’homme est d’abord un projet ». « L’homme n’est rien d’autre que son projet ». Comme le projet appartient au futur et que le futur n’est que pensée, le projet n’a de réalité que mentale. Pétrie par le temps psychologique, l’existence humaine est entièrement mentale. Quand elle crée, c’est avant tout des créations mentales, une simple image, ou un concept. L’homme existant vit en permanence dans des concepts, des images, du langage. Sa principale obsession, c’est de se donner une forme dans une image de lui-même et pour cela aussi de donner une forme à un devoir-être. « Il n’est pas un de nos actes qui, en créant l’homme que nous voulons être, ne crée en même temps une image de l’homme tel que nous estimons qu’il doit être ». « Nous façonnons notre image ». Cette image de moi n’a de sens que si elle est validée par les autres. Le moi « ne peut rien être … sauf si les autres le reconnaissent comme tel ». Le devoir-être que je m’impose veut dire aussi que « je suis obligé à chaque instant de faire des actes exemplaires ». « Comme si toute l’humanité avait les yeux fixés » sur ce que je fais. Nous n’avons vu, ce cogito existentialiste n’est pas « je pense donc je suis », mais « on me regarde, donc j’existe », (texte) ce qui est au fond une figure très banale de l’extraversion de la conscience. Mais cette conscience en dehors d’elle-même, qui ne vit que sous le regard et le jugement d’autrui, est toujours dans la souffrance et aux prises avec le conflit. « L’homme est angoisse ». Il se sent jeté et délaissé, il ne doit sa survie qu’aux expédients de sens qu’il parvient à se donner. « L’existentialiste ne croit pas à la puissance de la passion », il ne peut pas comprendre la puissance de la Passion sans motif qui est au cœur de la Vie, car il se croit délaissé par la Vie et jeté en dehors d’elle. (texte)
Nous voyons donc à quel point le discours existentialiste calque admirablement l’expérience de l’égarement de la conscience dans l’objet. Ainsi, tout un chacun peut aisément se dire « existentialiste », car cette doctrine ne fait que réfléchir la conscience habituelle dans des concepts philosophiques.
----------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Questions:
1. L'existentialisme aurait-il encore un sens, si on lui retirait l'idée d'engagement politique?
2. Quelle relations pourrions-nous formuler entre l'existentialisme et la montée des tendances postmodernes?
3. L'existentialisme a-t-il une orientation nihiliste?
4. Pourquoi a-t-on discerné chez Heidegger une philosophie de l'écologie?
5. En toute rigueur, pourrait-on trouver chez Descartes une orientation "existentialiste" de la philosophie?
6. En quoi la pensée de l'Être nous interroge-t-elle sur les limites de la pensée?
7. Que signifie la formule la connaissance véritable est "être-connaissance"?
© Philosophie et spiritualité, 2009, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()