Leçon 205. Le mental comme stade évolutif

Un petit
rappel important pour ce qui suit : Nous avons vu
précédemment qu’en sanskrit (texte) la
racine MAN signifiait penser et qu’elle
donnait manas, l’esprit et manuh, l’homme.
Ainsi l’étymologie nous rappelle que l’homme se définit comme un être mental.
On suit très bien cette filiation dans toutes les langues
indo-européennes. Mensch en
allemand, man en anglais, humain en français. Le mens latin
pour l’esprit devient mental
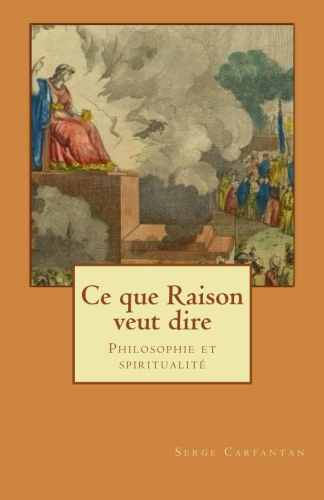 en français en anglais etc. Mental
structures, les constructions mentales, correspondent aux innombrables
produits de l’intellect humain. Quand nous disons de l’intellect
qu’il est une faculté de concevoir, nous parlons de
concepts qui ne sont que des
constructions mentales et
rien d’autre.
en français en anglais etc. Mental
structures, les constructions mentales, correspondent aux innombrables
produits de l’intellect humain. Quand nous disons de l’intellect
qu’il est une faculté de concevoir, nous parlons de
concepts qui ne sont que des
constructions mentales et
rien d’autre.
Notre civilisation est toute entière tissée sur des constructions mentales. Nos villes, nos champs bien tracés, sont des paysages aussi géométriques que conceptuels, dessinés dans les constructions mentales de notre organisation industrielle. Notre nourriture, nos rythmes de vie frénétique, nos looks et nos mimiques, nos modes, sont le plus souvent des produits publicitaires, c’est-à-dire des constructions mentales à usage de profit. Nos grandes hypothèses sur l’univers, nos théories scientifiques sont des constructions mentales, ingénieuses et sophistiquées, mais des constructions mentales aussi. Ce qui résulte du monde encadré par notre vision scientifique, toutes nos techniques et nos pratiques sont entièrement façonnés par des constructions mentales. Tous les produits du calcul, toute la spéculation financière ne sont rien d’autre que des constructions mentales. L’art lui-même, quand il se confond avec l’objet technique, l’art qui n’offre plus rien à sentir, est seulement du conceptuel, des constructions mentales. La plupart de nos pensées, les plus répétitives, ne sont que des schèmes conditionnels, des constructions mentales sans substance.
Nous sommes tellement identifiés aux formes (R) produites par le mental qu’il nous est difficile, ne serait-ce que de prendre conscience de son rôle. Et pourtant, il n’a pas toujours été là, le mental est apparu dans le cours d’une longue évolution, en se dégageant d’une nature qui n’était pas sa création. C’est ce qui va nous intéresser dans cette leçon. En quoi la compréhension du fait que le mental est un stade évolutif modifie-t-elle notre appréhension de la pensée ?
* *
*
Dans l’histoire de l’évolution, l’apparition de l’homme est l’avènement, après le développement du vital, d’un plan nouveau, celui du mental. Comme nous l’avons vu, cela ne signifie pas du tout l’avènement soudain de la sensibilité, de la mémoire, de la conscience, de la sociabilité, ni même de l’intelligence. Nous disions de l’homme que non seulement il existe en tant que forme, il sent et connaît, mais surtout il sait qu’il connaît au sens où l’apparition de la conscience est en lui redoublée par le pouvoir de la réflexion. L’homme se pense lui-même, se connaît dans une représentation de lui-même qu'il constitue par concepts et il se connaît dans des concepts.
1) Revenons sur une exposition simple, prenons celle qui figure dans les pages du petit livre de Marignal, Voyage vers l’Insaisissable. Notre ancêtre, l’homme premier, vit dans la nature au milieu des animaux et son comportement se distingue très peu d’eux. Il se sert de ce qu’il trouve à sa portée pour se nourrir, se protéger des intempéries et du danger. Tout comme les autres animaux, il suit les rythmes et les cycles de la Nature, tout comme la plante et l’animal, il participe d’une même vie dont il ne se sent pas séparé et moins encore isolé. L’idée même de séparation et d’isolement n’a pas le moindre sens chez l’homme premier. Elle ne pourra en avoir que beaucoup plus tard, une fois rompue l’immanence de l’homme dans la vie. Debout sur ses membres inférieurs, ses mains sont libérées. Son cerveau ne se distingue pas de celui de ses cousins anthropoïdes, mais du fait de sa station debout, il va connaître un développement très original et continu. La « faculté mentale liée au cerveau – que dans ce contexte nous appelons « mental » - va pouvoir acquérir de nouvelles possibilités ». « Au fil du temps, d’action en réaction entre la main et le cerveau qui se développe, d’action en réaction entre l’objet et le mental qui s’enrichit de nouvelles facultés, l’homme déploie son habileté, son savoir-faire, sa technique. Dans le cerveau de cet homme qui désormais fabrique et utilise un objet, commencent à se faire jour des possibilités d’idéation, d’abstraction : il prend conscience à la fois de la relation entre l’objet et lui et de la séparation entre l’objet et lui ».
La dualité sujet/objet qui se fait jour est d’une importance primordiale, car sans elle, il est impossible de comprendre le mental humain. Nous avons montré précédemment que nous avons de solides raisons de penser que l’animal conserve une immanence non-duelle au sein de la vie ; même s’il distingue des objets, il ne structure pas de séparation complète.
Il y a toutefois quelque chose de plus qui naît de la dualité sujet/objet. « Cette prise de conscience s’élabore dans le mental et par le mental » ; oui, mais ce qui est proprement décisif, nous l’avons souligné à plusieurs reprises, c’est que « dans le mental de l’homme et par le mental de l’homme, éclot l’idée de « moi » ». Toutefois, chez l’homme premier, l’ego n’est pas encore présent comme il peut l’être chez un être humain, tel que nous le rencontrons dans la vie quotidienne. Il n’a pas encore pris la forme d’une existence et d’une existence séparée. « Ce « moi », ce « je », n’a pas d’existence séparée ; c’est une idée, un concept élaboré par le mental, par nécessité de différenciation et de relation entre l’homme et ce qu’il fabrique et utilise. Ce concept n’existe que dans le mental – par rapport à l’objet et, par extension, par rapport à tout ce qui l’entoure ». C’est tout. Ce qui va se passer dans la suite des temps, c’est que, posé comme un singe sur l’épaule de son maître, l’ego va s’accoler au mental, se mouler dans son contour, s’identifier au mental, de sorte que bientôt, il ne se connaîtra plus que comme mental-ego. Un petit peu de nécessité, une petite dose d’oubli, et « le mental a perdu la possibilité de voir l’artefact et s’est identifié à ce qui l’avait engendré ». La suite appartient à l’histoire : « Cette identification s’est mise en place au cours des siècles : elle s’est installée dans le mental collectif, tissée par les mémoires, les cultures, et dans le mental individuel ». Une fois le processus d’identification engendré, il a eu une incidence directe sur le fonctionnement du cerveau, il l’a entraîné à toujours fonctionner dans le même schéma, ce qui est la forme la plus subtile de son conditionnement. Le résultat a été que le mental ne pouvait plus « voir au-delà de ses limites ».
---------------Cependant l’homme premier est « pleinement intégré au monde dans lequel il vit. Il participe de la vie visible et invisible, proche et lointaine, autour de lui, en lui – vie perceptible aux sens ou non -, qui le constitue et constitue le monde. Il vit cela directement, sans séparation, sans détour, par le fait d’une perception non consciente qui pénètre et s’exprime à travers son être, ses sens, sa sensibilité, que nous pouvons appeler mental perceptif.
Ce mental perceptif, qui est lieu de participation à la vie universelle, lieu de communication avec l’ensemble de toutes choses connues et inconnues, lieu d’échange, de rencontre de l’homme avec l’univers, est aussi lieu de sa nature première, essentielle, transcendante ». Si nous pouvons parler de « perception non consciente », c’est en comparaison évidemment de ce que nous appelons « perception » dans notre condition actuelle, perception qui est hautement intellectualisée. Cela signifie que ce niveau du mental perceptif est tout entier sensation. (texte) Il rassemble tous les sens, n’a pas encore la marque de l’intellect, mais n’est pourtant pas dépourvu d’intelligence.
... la pensée est construction mentale ; en partant du stade où nous sommes parvenus, nous ne pouvons qu’imaginer l’intellect isolant en nommant des objets, les découpant dans l’observation. Nous avons tendance à occulter ce qui a été premier, « la perception intuitive de la nature et de l’invisible par le mental perceptif ». Les mythes, « d’abord perçus, vécus directement de l’intérieur, sans forme verbale, sans image,… seront peu à peu mis en forme par le mental rationnel, discursif : forme-image, forme-pensée, forme-idée, forme-symbole, forme-sagesse. Au fur et à mesure de son évolution, ce mental second va tenter de les faire entrer dans une logique, ébauche de la science de son développement technologique ». L’essor du mental discursif au cours des millénaires est prodigieux. Nous ne devons cependant pas oublier ce qui s’est produit simultanément avec sa montée en puissance : a) « il est arrivé à occulter quasiment le vécu direct, spontané, du mental perceptif ». b) le « mental discursif a engendré, généré en son sein le moi-ego : il est devenu mental-ego. Cette installation de l’ego dans le mental discursif va établir une barrière entre ce dernier et le mental perceptif, limiter la relation de l’un à l’autre et déformer la connaissance intuitive ».
2) Un rapprochement qui s'impose: Beaucoup de commentateurs se sont demandé quel sens donner à la description du « sauvage » dans le Discours sur l’Origine de l’Inégalité parmi les Hommes de Rousseau. Il est évident qu’une interprétation politique est insuffisante et superficielle. A quoi bon évoquer un état de nature antérieur à l’état social, si c’est de manière purement hypothétique ? L’ambiguïté demeure. Rousseau a récolté beaucoup de mépris pour avoir soi-disant inventé un mythe. Une interprétation sociale est tout aussi superficielle. Dire qu’auparavant il y avait un homme naturel et qu’ensuite est apparu la figure artificielle du bourgeois n’explique rien. L’interprétation morale disant que le bon sauvage, qui était innocent, (texte) a laissé place à l’homme de la morale, raisonneur, (texte) disposant de règles, mais n’ayant que peu de compassion, n’est pas satisfaisante. Il est exact que pour comprendre Rousseau il est indispensable de partir de sa quête éperdue de l’authenticité. Mais le véritable enjeu est ailleurs.
En marchant dans le bois de Vincennes, ce que Rousseau a entrevu, ce qu’il n’a pas su bien préciser, c’est le processus de développement du mental humain. L’état de nature n’est pas un concept politique, il ne l’est que de manière secondaire, il décrit un cheminement de la conscience. Si nous le lisons le Discours sur l’Origine de l’Inégalité parmi les Hommes dans cette perspective, c’est un texte proprement génial. Par exemple, pourquoi dire que le sauvage vit en lui-même, tandis que le bourgeois ne vit que dans l’opinion des autres ? (texte) La réponse saute aux yeux : l’homme premier n’a pas encore développé un sens de l’ego aussi prononcé que celui qui viendra bien plus tard. Il est encore dans l’immanence de la vie. C’est seulement pour et par l’ego que paraître devient plus important qu’être. Pourquoi reprocher à Hobbes, Locke, Grotius d’avoir mal compris l’état de nature ? Ils n’ont fait que transporter les caractéristiques du mental actuel sur l’homme premier ce qui est complètement erroné. Comment Rousseau ose-t-il déclarer de manière aussi brutale que l’homme pensant est un « animal dépravé » ? !! (texte) Mais voyons, c’est parfaitement clair : l’apparition du mental discursif a eu pour effet de couper l’homme de sa propre sensibilité, de rendre difficile l’accès à Soi au sein de la vie. L’empire du mental discursif a installé la division et a rompu l’unité. Tout le reste n’est que conséquences diffractées à l’infini. De même, il fallait un sacré culot pour critiquer, comme le fait Rousseau, le passage de la nature vers la culture au moment où l’Occident se lançait à corps perdu dans les conquêtes de l’Histoire ! Mais c’était un coup parfaitement génial. A côté, l’excitation mentale de Condorcet autour du progrès est superficielle et d’une naïveté confondante. Pourquoi Rousseau insiste-t-il sur les origines poétiques du langage? L’homme premier se sentait lui-même poétiquement au sein de l’Univers, bien plus qu’il en pouvait se penser, se représenter comme différent de lui. C’est l’extase de l’unité en toutes choses qui lui montait aux lèvres. Il ne connaissait pas le sens du mot « individualisme », il vivait sous les étoiles dans l’humilité de la Terre ; des frissons de sa joie, il pouvait faire des chants et des poèmes. Il y a chez Rousseau un insight, une vision en profondeur, une vision intuitive qui l’a poursuivi toute sa vie. Et elle a un rapport étroit avec le développement du mental et à la relation entre l’homme et la Nature.
-------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Questions:
1. Peut-on dire que chaque être humain dans son développement psychologie, refait tout le cheminement évolutif de l'humanité?
2. Que veut dire occulter le mental perceptif?
3. Qu'est-ce qui caractérise un mental-ego?
4. Pourquoi une hygiène de l'esprit?
5. Pourquoi est-il indispensable de mettre en relation le développement égotique et la technique?
6. Pourquoi est-il nécessaire de transcender la pensée?
7. n'avons-nous pas désormais besoin de plus de sensibilité à ce qui est que puissance d'analyse?
![]() © Philosophie et spiritualité, 2010, Serge Carfantan,
© Philosophie et spiritualité, 2010, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()