Revenons sur
le mot intelligence, tel que nous l’avons considéré dans les leçons précédentes.
En latin, inter veut dire entre,
ligare veut dire lier. Nous
disions que l’intelligence est la
faculté qui permet de relier, d’établir des rapports. (texte) Nous avons noté aussi que
le mot religion est composé de manière
semblable et qu’il veut dire « lier à nouveau ». Cette définition rapide pose
problème, car elle pourrait laisser croire que l’intelligence se range « à côté de » quelque chose d’autre qui en est
séparé. L’intellect
tranche aisément et il a tendance
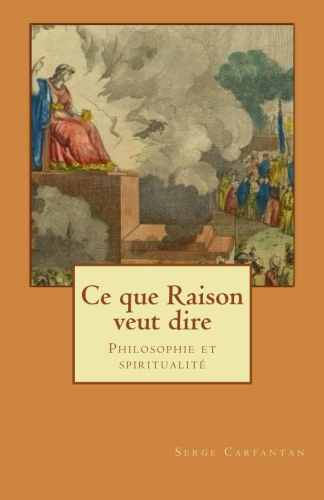 à
disjoindre ce qu’il ne faut que
distinguer sans séparer. Il est
absurde de ranger l’intelligence à côté de l’imagination,
de la mémoire ou de la
perception. Ce que l’on pointe de cette manière, ce sont des facettes ou
fonctions d’une seule et même chose qui est le
mental, ou, si l'on
préfère, la pensée.
à
disjoindre ce qu’il ne faut que
distinguer sans séparer. Il est
absurde de ranger l’intelligence à côté de l’imagination,
de la mémoire ou de la
perception. Ce que l’on pointe de cette manière, ce sont des facettes ou
fonctions d’une seule et même chose qui est le
mental, ou, si l'on
préfère, la pensée.
Néanmoins, en évoquant le problème du langage animal, nous avons été amenés à évoquer plusieurs formes de l'intelligence. Nous distinguions l’intelligence abstraite qui manipule et calcule avec des signes. En termes techniques, on dira que l’intelligence abstraite est l’aptitude à résoudre les problèmes portant sur des idées. L’intelligence relationnelle, elle, opère dans le domaine social, elle est l’aptitude à résoudre les problèmes qui tiennent à la relation entre des individus. Enfin, nous avons vu que l’intelligence pratique, appelée aussi ingéniosité, est l’aptitude à résoudre des problèmes concrets, c'est-à-dire qui se situent dans les choses. Ce que nous observions, c’est qu'il est indéniable que l’on rencontre souvent chez l’animal une intelligence relationnelle très élevée (cf. L’exemple des dauphins), et une intelligence pratique remarquable (cf. exemple des castors). Par contre, il est bien plus difficile d’établir chez l’animal l’existence d’une intelligence abstraite... ce qui est d’ailleurs un argument pour considérer qu’il est « bête » ! Mot qui dans le langage populaire veut dire pas intelligent!!
La question qui se pose alors est celle-ci : l’intelligence doit-elle être considérée comme multiple ? C’est ce que prétend par exemple Gardner dans Les formes de l’intelligence. Faut-il opposer des « performances » différentes ? Mais qu’en est-il alors du facteur de lien consubstantiel à l’intelligence ? Quelle est la relation entre l’intelligence et la conscience ?
* *
*
Prendre le mot intelligence en le mettant au pluriel, comme le fait Howard Gardner, en disant « les intelligences » n’a pas la même signification que de dire qu’il existe plusieurs formes de l’intelligence. Dans le premier cas, on insiste sur la séparation, dans le second, il s’agit de dériver une qualité unique dans différents aspects de son expression. Le choix du pluriel est expliqué dans l’hypothèse de Gardner, dans Les Formes de l'Intelligence, à la page 67, en partant de l’idée a) qu’il existe des compétences différences, b) que celles-ci sont en rapport avec des zones cérébrales différentes du cerveau, c) que chacune correspond à un traitement de l’information. L’argument général consistant à nous faire « admettre l’existence de plusieurs compétences intellectuelles humaines».
___________________________________________________________________________________________________________
d’aptitude à traiter une information particulière. Si on résume la classification de Gardner on obtient ceci :
a) L’intelligence linguistique serait une intelligence liée à la manipulation des signes du langage. Relier, c’est appréhender le sens d’éléments qui sont les mots. Une intelligence linguistique médiocre les verrait comme disparates. Cette intelligence suppose la compétence linguistique, donc la maîtrise d’un vocabulaire, de la syntaxe, de la sémantique. Curieusement, Gardner part sur T. S. Eliot, Homère et Blake et la voit d’abord comme une aptitude de poète. Or ce qui était attendu logiquement en tout premier lieu, puisque la définition parle de compétence à manipuler le langage, c’était plutôt la rhétorique et ses formes diverses, car c’est en rhétorique que l’idée de performance efficace traduit au mieux une compétence. La compétence linguistique, c’est avant tout l’aptitude à parler, à dialoguer, à persuader, à convaincre, ou encore en bref, à communiquer. Il y a une intelligence de l’orateur, du vendeur, de l’homme politique etc. Les « communicateurs » font de bons instruments de propagande, mais de mauvais poètes et de piètres penseurs. La finesse du style chez un écrivain est un art délicat qu’il serait injurieux de considérer comme une « performance ». Il y a en fait une grande différence entre l’intelligence poétique et l’habileté rhétorique. La catégorie est confuse. Elle fait aussi l’impasse sur la question très importante de l’intelligence non-verbale.
b) On passe ensuite, sans logique, au chapitre 5 à l’intelligence musicale. Bizarre. Pourquoi en faire une catégorie à part ? Il faudrait alors inventer une intelligence du trait et de la couleur en peinture, du volume en sculpture ou du mouvement dans la danse. Il est vrai que le domaine de la musique possède une structure remarquable, il a son ordre et sa perfection mathématique, mais d’une manière si vivante, que la mathématique s’oublie dans la beauté de la forme. Il est exact que la composition musicale possède une spontanéité créative. Nul ne contestera la prodigieuse intelligence des œuvres de Bach. Mais alors, on se demande en lisant Gardner, s’il n’aurait pas mieux fait, pour définir l’intelligence de partir de la notion de créativité. Comme le fait A. H. Maslow dans Vers une Psychologie de l’être.
c) L’intelligence logico-mathématique est la forme d’intelligence que nous connaissons le mieux, car elle est la référence classique de l’instruction scolaire et de la culture. Elle est susceptible d’être quantifiée par des tests, dont le célèbre QI. On dit de quelqu’un qu’il est « intelligent » quand il est rapide à résoudre un problème logico-mathématique, comme les tests utilisés pour l’évaluation des appelés à l’armée. On utilise alors la manipulation des nombres, les problèmes de logique, de stratégie. C’est l’intelligence calculatrice du jeu d’échec. Il est possible de comparer la performance de A à celle de B et de noter les résultats pour dire sur cette base que B et plus intelligent que A parce qu’il a passé avec plus de succès les tests. La lenteur est donc en ce cas un défaut d’intelligence. Nous vivons dans une société qui idolâtre la vitesse et la performance, qui stimule la rivalité et pratique des formes de sélection quasi-darwinienne. Comme l’intelligence logico-mathématique admet une quantification et que celle-ci peut même être automatisée, on comprend l’usage exclusif de la sélection par les maths à tous les niveaux de l’éducation. De là à ne juger des talents qu’à cette unique forme d’intelligence, il n’y a qu’un pas qui a été largement franchi. Ici, l’intérêt de l’exposé de Gardner n’est pas dans son contenu, mais dans le souci de distinguer par rapport aux autres cette forme d’intelligence spécifique. On peut relever dans ce chapitre de nombreuses inexactitudes. Il y a une différence entre l’intuition proprement mathématique, la construction mécanique de raisonnements qui appliquent une règle (le problème de mathématique et ses astuces), et l’art de la déduction logique complexe.
___________________________________________________________________________________________________________
intelligence spatiale. On se demande par quelle principe de classification Gardner en arrive là. C’est une énumération indéfinie. Si on suit ce gendre de distinction, il faudrait un « intelligence du temps » et une « intelligence de la causalité ». Le rapport avec ce qui précède n’est pas clair. D’autre part, la géométrie fait partie des mathématiques. Les exemples choisis y sont empruntés. Mais cet espace est par nature abstrait. Ce n’est pas l’étendue concrète. Pour que le propos se tienne, il faudrait trouver avant tout une réflexion sur l’orientation dans l’espace à partir du corps, ou encore, une élaboration de l’espace dans la danse par exemple. Mais Gardner mélange tout et passe d’un point de vue à l’autre. En fait, Gardner est sur la piste de l’intelligence perceptive, dont il mélange la reconnaissance des formes avec l’aptitude à peindre et à dessiner. Additionner ces considérations avec l’exemple du jeu d’échec accroît encore la nébulosité du propos, car ce qui est spécifique des échecs, c’est la stratégie, pas seulement la représentation d’un espace. Donc un calcul.
e) Sous l’appellation intelligence kinesthésique Gardner désigne le langage du corps et l’intelligence du mime. L’habileté ici, est de pouvoir se servir du corps comme d’un véhicule expressif, sans passer par le langage verbal. Cette voie dans la pédagogie est valorisée sous le nom "d’expression corporelle". Ensuite, l’idée de performance réussie, étendue au sport, permet de rattacher n’importe quelle performance physique au domaine de la culture. Ce type d’intelligence concerne tous les métiers centrés sur le corps. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, au-delà des généralités, sur la relation intelligente au corps, mais cela outrepasse le propos de Gardner.
f) Sous le nom d’intelligence intrapersonnelle, Gardner désigne l’aptitude à l’introspection, la capacité de porter un regard critique sur soi-même, de mesurer ses limites et de comprendre ses réactions. Le terme est obscur, il vaudrait mieux lui préférer le concept de lucidité. Il faudrait aussi qu’il ne soit pas dissocié de la conscience et de l’attention et qu'il soit rattaché de manière claire à la connaissance de soi. Sur ce registre, Gardner délaye des généralités et ne pose pas la question de l’auto-observation. Nous avons vu qu’effectivement l’investigation de la nature de la conscience favorise l’expansion de l’intelligence, mais on ne peut pas la dissocier de la relation au monde et de la relation à autrui.
___________________________________________________________________________________________________________
2) A ces sept types, peuvent s’en ajouter d’autres, comme « l’intelligence naturaliste » de celui qui a le don de l’observation et du classement. C’est l’aristotélicien qualifié en quelque sorte. Autre catégorie, « l’intelligence existentialiste » (!?) qui serait définie comme une aptitude à se questionner sur l’origine des choses.
En l’absence de classification précise, il semble bien que l’on puisse en fin de compte isoler et baptiser «intelligence » n’importe quelle activité réalisée avec une certaine habileté. Il suffit de pouvoir exhiber une « performance » dans un domaine donné. Il devrait y avoir une intelligence du jardinage, de la cuisine, de l’informatique, des jeux vidéo ou du poker etc.
Le succès de l’hypothèse de Gardner tient à l’exploitation pédagogique qui en a été tirée dans les écoles. Les réformateurs se sont emparés de ses arguments pour partir en guerre contre le QI, la tyrannie des mathématiques et faire l’éloge des différences d’aptitudes. C’est donc au nom du combat idéologique en faveur de l’égalité que la théorie a connu son succès. Un succès public. A l’élève en échec scolaire, dont le niveau de culture est proche de l’analphabétisme, on pourra toujours dire qu’il est un génie du ballon de foot. A la jeune fille qui ne comprend rien à rien, on peut toujours indiquer sur le bulletin scolaire qu’elle est gentille, soignée de sa personne et souligner son intelligence relationnelle. Quant à savoir ce qu’est l’intelligence, comment il serait possible de la développer, quel lien précis elle entretient avec la culture, c’est autre chose. Pour l’essentiel, il nous semble qu’il serait plus judicieux de parler de créativité multiple et de se mettre en quête de l’essence de la créativité que de procéder à des distinctions aussi confuses.
Par ailleurs, il faut savoir que cette entrée en force dans la pédagogie n’était qu’un succès public, car la théorie de Gardner a été très largement rejetée par les spécialistes. George Miller, un psychologue connu pour ses découvertes sur le fonctionnement de la mémoire, déclare dans The New York Times Review of Books, que l’argumentation de Gardner se ramène à un fatras de raisonnements boîteux et d’opinions confuses. En bref, il lui est reproché communément d’être plus de la rhétorique que de la science. On peut louer les qualités de communicateur de Gardner, mais sur le fond, l’exposition reste très floue. L’approche de Gardner n’apporte pas de preuves, ne fournit pas de tests que ses collègues pourraient évaluer. Pas de mesure possible, pas de quantification, pas d’expérience. Gardner a d’ailleurs publiquement reconnu que le jugement par lequel il élève au rang d’intelligence une aptitude relève plus à d'un procédé empirique que de la science. Il n’est donc pas utile de chercher comment mener une série d’expériences, pour confirmer ou infirmer, comme Sheldrake le fait pour la théorie de la causalité formative… Il n’y a pas vraiment de théorie.
--------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
© Philosophie et spiritualité, 2007, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()