Nous avons vu tout
l’intérêt d’une anthropologie trinitaire, tant pour
la clarification de la nature de l’être humain, que pour ses conséquences dans
l’art de vivre. C’est un enjeu très important qui a suscité des débats
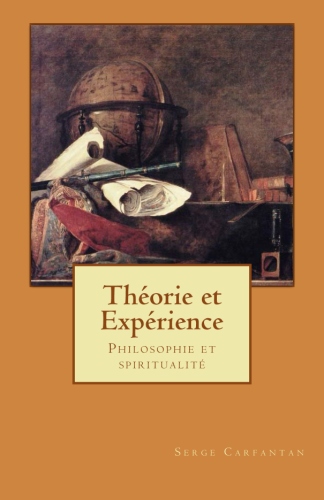 passionnés
en Occident qui sont loin d’être anecdotiques. Nous avons vu que
Giordano Bruno estimait que l’Église s’égarait en
adoptant le dualisme d’Aristote, les Évangiles optant nettement en faveur d’une
conception tripartite de l’être humain. Argument, entre autres,
qui lui a valu le bûcher de l’Inquisition. Le
spiritualisme tiré de
Descartes s’est maintenu dans un dualisme
corps-esprit, avec de grandes difficultés liée au fait qu’il assimile l’âme
et l’esprit. Le
matérialisme procède lui à une réduction drastique en ne prenant en compte
que la valeur du corps.
passionnés
en Occident qui sont loin d’être anecdotiques. Nous avons vu que
Giordano Bruno estimait que l’Église s’égarait en
adoptant le dualisme d’Aristote, les Évangiles optant nettement en faveur d’une
conception tripartite de l’être humain. Argument, entre autres,
qui lui a valu le bûcher de l’Inquisition. Le
spiritualisme tiré de
Descartes s’est maintenu dans un dualisme
corps-esprit, avec de grandes difficultés liée au fait qu’il assimile l’âme
et l’esprit. Le
matérialisme procède lui à une réduction drastique en ne prenant en compte
que la valeur du corps.
Dans la leçon présente, nous allons reprendre cette question à partir d’un livre de Ken Wilber, Les trois Yeux de la Connaissance. Si en effet nous admettons qu’un être humain est tout à la fois corps, esprit et âme, il y a nécessairement trois manières d’envisager la connaissance selon qu’elle se fonde sur les sensibilia liés à l’expérience charnelle, sur les intelligibilia de l’expérience de l’esprit ou sur les transcendelia de l’expérience de l’âme. Il s’ensuit alors des types de connaissances très différents qu’il ne faudrait pas confondre, mais intégrer à la place qui leur convient. En quel sens pouvons-nous parler d’une connaissance fondée sur le corps, l’esprit où l’âme ? Dans quels domaine sommes-nous en droit de parler de théorie possible, voire de science et de quelle manière ?
* *
*
Autant citer directement Wilber pour commencer : « Saint Bonaventure, le grand Docteur séraphique de l’Église, philosophe apprécié des mystiques occidentaux, enseignait que les hommes et les femmes possèdent au moins trois moyens d’accéder à la connaissance – « trois yeux », comme il disait… l’œil de chair, par lequel nous percevons le monde extérieur de l’espace, du temps et des objets ; l’œil de raison, par lequel nous acquérons une connaissance de la philosophie, de la logique et du mental lui-même ; l’œil de contemplation par lequel nous nous élevons jusqu’à la connaissance des réalités transcendantes".
1) Poursuivons. Nous avons évoqué ailleurs la relation connaisseur-connaissance-connu. Le connaisseur est le sujet, la connaissance forme le lien, ce qui inclut les moyens corrects de connaissance (dans la philosophie indienne les pramana), et l’objet, le connu. Dans une philosophie intégrale, empreinte de spiritualité, qui ne nie rien, mais cherche plutôt ce qui est vrai, l’affirmation pertinente dans chaque système, la connaissance est ultimement un regard de l’âme. Notons que pour Saint Bonaventure « toute connaissance est une sorte d’illumination. Cependant, il faut se garder de tout confondre. Il y a la lumière extérieure, lumen exterius, « qui éclaire l’œil de chair et nous donne accès à la connaissance des objets tangibles. Il y a la lumen interius qui éclaire l’œil de raison et nous donne accès aux vérités philosophiques ». Enfin, « il y a la lumen superius, la lumière de l’Être transcendant qui éclaire l’œil de la contemplation et révèle… une vérité qui mène à la libération ». Il est intéressant de noter que pour Saint Bonaventure, nous ne trouvons dans l’extériorité, précisément parce qu’il y a ex-tériorité, donc manifestation dans l’espace-temps-causalité, que des objets séparés : des « vestiges de Dieu ». Si maintenant nous nous tournons vers nous même, sur le plan de l’esprit, nous rencontrons dans la triple activité de la mémoire de la raison et de la volonté, « l’imago de Dieu », « laquelle est révélée par l’œil mental ». Enfin, « grâce à l’œil de la contemplation, éclairé par la lumen superius, nous accédons à l’ensemble ...
« Cette terminologie particulière –œil de chair, de raison et de contemplation – est d’origine chrétienne, mais on trouvera des idées similaires dans les principales écoles de psychologie, de philosophie et de religion traditionnelle ». Nous dirions avec Wilber que ... philosophia perenis, La Philosophie éternelle. - C’est le titre d’un livre méconnu d’Aldus Huxley-. ...Toutefois, pour éviter de longues énumérations comparatives, nous nous en tiendrons seulement à quelques unes. Dans le Vedanta la distinction entre shtula, suksma et karana est très claire et très détaillée. Wilber distingue « le grossier (charnel et matériel), le subtil (mental et animique), et le causal (transcendant et contemplatif) ».
L’œil de chair « participe de l’expérience sensorielle commune, qu’il crée en partie et qu’il révèle en partie. C’est le « domaine grossier », celui de l’espace, du temps et de la matière… le domaine partagé par tous ceux qui possèdent un oeil de chair semblable ». Il est essentiel de bien marquer les spécificités sous peine de commettre des erreurs préjudiciables. Ainsi, « dans le domaine grossier, un objet n’est jamais A et non-A ; il est soit A soit non-A. Une pierre n’est jamais un arbre ; un arbre n’est jamais une montagne, une pierre n’est pas une autre pierre, etc. ». L’œil de chair pose une constance objective des choses, c’est tout à la fois la fonction sensorimotrice et l’œil empirique de l’expérience sensorielle. Ce qui peut « être décelé par les cinq sens humain ou leurs extensions ». Wilber ajoute que dans la mesure où cet œil de chair est partagé par ceux qui en possèdent un semblable, ce domaine humain est dans l’ensemble partagé avec les autres animaux, surtout les mammifères, quoique avec des nuances importantes.
« L’œil de raison, ou de façon plus générale, l’œil du mental… participe du monde des idées, des images, de la logique et des concepts ». En raison d’une influence très forte de l’empirisme, la pensée moderne a tendance à dépendre fortement de l’œil de chair, cependant, il est essentiel de se souvenir que « l’œil mental ne peut être réduit à l’œil de chair. Le champ mental comprend mais transcende le champ sensoriel. L’œil du mental, quoique n’excluant pas l’œil de chair, s’élève bien au-dessus de lui. Par l’imagination, il est capable de se représenter des objets sensoriels qui ne son pas présent physiquement, et donc de transcender l’emprisonnement de la chair dans le monde ». Par la logique il parvient à agir intérieurement sur son monde. Par la volonté il est à même de « retarder les décharges instinctives et impulsives de la chair et donc de transcender les aspects simplement animaux et sub-humains de l’organisme ». Et puis, c’est un débat très classique en philosophie : si l’œil de la raison dépend en grande partie d’un avoir qu’il tire des sens, il reste que « notre connaissance n’est pas entièrement empirique et sensorielle ». L’implication que nous allons devoir suivre, c’est qu’il est indispensable de laisser une grande latitude d’ouverture au concept d’expérience pour ne pas le réduire à de l’empirique au sens trivial du mot. L’expérience est un domaine bien plus vaste que le simple constat de fait, elle ne se réduit pas non plus à l’expérimentation et il existe une forme d’expérience spirituelle qui n’a rien à voir avec l’empirisme brut. Nous avons vu par le détail que l’existence même des mathématiques et de la logique témoigne de cette aptitude de l’esprit à pouvoir penser au-delà de l’expérience empirique. « Personne n’a jamais vu, avec l’œil de chair, la racine carrée d’un nombre négatif. C’est une entité transempirique, que ne peut être appréhendée que par l’œil de raison. La majeure partie des mathématiques, ainsi que le dit Whitehead, est transempirique et même a priori… Il en va de même de la logique. La vérité d’une déduction logique se fonde sur une cohérence interne – et non sur sa relation aux objets sensoriels ». Comme nous l’avons démontré précédemment.
L’œil de la contemplation de la même manière, ...« L’œil de contemplation est à l’œil de raison ce que l’œil de raison est à l’œil de chair. De même que la raison transcende la chair, la contemplation transcende la raison. ... la raison ne peut être réduire, ni dérivée de la connaissance sensorielle, la contemplation ne peut être réduite à, ni dérivé de, la raison. Si l’œil de raison est transempirique, l’œil de contemplation est transrationnel, translogique et transmental ». C’est exactement de cette manière que Shri Aurobindo conçoit la Gnose. C’est un point sur lequel il faudra revenir.
2) Pour l’heure contentons nous de résumer : « Tous les hommes et toutes les femmes possèdent un œil de chair, un œil de raison et un œil de contemplation » (le célèbre troisième œil des traditions spirituelle). « Chaque œil a ses propres objets de connaissance (sensoriels, mentaux et transcendantaux) ; qu’un œil supérieur ne peut être réduit à – ni expliqué par – un œil inférieur ; que chaque œil est
(A compléter vous-même)
|
Œil de chair |
Œil de raison |
Œil de la contemplation |
|
lumen exterius |
lumen superius |
|
|
Objet tangible |
L’Être |
|
|
« les vestiges de Dieu » |
||
|
Mémoire, raison et volonté |
Domaine transcendant |
|
|
Sthula le domaine grossier |
Suksham le domaine subtil |
|
|
Expérience sensorielle |
|
Expérience transcendantale |
|
Rationnel et logique |
Transrationnel, translogique, transmental |
|
|
Domaine des faits |
Domaine de l’Être |
|
|
Constance objective |
|
Ce qui est au-delà de l’opposition objectif/subjectif |
|
Cf. exemples typiques des sciences « empiriques » |
|
Cf. exemples de la spiritualité et de la mystique |
|
Fonction sensori-motrice |
Intellect et intelligence |
De là suit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Questions:
1. Quel contenu donner à la philosophie éternelle?
2.
Quelle est donc l'originalité de ce que l'on a appelé "la révolution copernicienne"?3. Quelles seraient en définitive les les limitations de l'oeil de raison?
4. En quoi consiste les limitations du savoir fondé sur l'oeil de chair?
5. Comment justifier l'importance fondamentale d'une connaissance fondée sur l'oeil de la contemplation?
6. Pour quoi Kant aboutit-il à l'agnosticisme?
7. Que penser dans ces conditions du positivisme logique?
![]() © Philosophie et spiritualité, 2014, Serge Carfantan,
© Philosophie et spiritualité, 2014, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()