Disons-le
tout net, ce titre contient une erreur qui risque de produire une illusion. Il
laisse entendre qu’il existerait « une » discipline appelée « psychologie »
enveloppant dans sa structure différents « départements », suivant une
classification admise. C’est faux. Il n’y a aujourd’hui aucune unité de la
psychologie. Il n’existe pas parmi les sciences
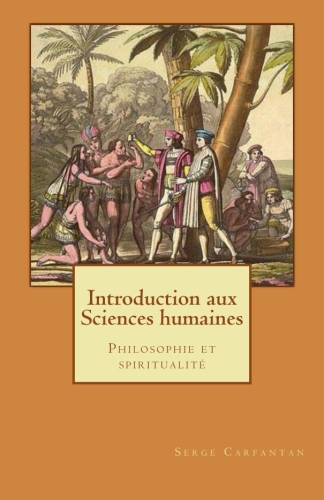 humaines
de discipline plus fragmentée que la psychologie. Si un physicien
relativiste peut ne pas connaître la
théorie quantique, il admet
pourtant qu’elle fait partie de la physique. Il sait reconnaître ce qui fait ou
non partie de la physique. Mais ce n’est pas le cas en psychologie où personne
ne connaît l’ensemble des
références. Les auteurs majeurs pour les libraires,
comme
Abraham Maslow ou
Stanislas Grof
n’existent tout simplement pas dans l’enseignement. Il n’y a aucun rapport entre
ce que l’on trouve dans les magazines grand public de psychologie et ce qui se
pratique à l’Université.
Les spécialistes
disent pudiquement que les modèles biologiques de la recherche et le
modèle culturel de la psychologie
"ont du mal à s’articuler". Il faut mettre en garde le futur étudiant, s’il cherche
dans la psychologie universitaire une quelconque forme de « connaissance de
soi », il sera déçu et surpris.
humaines
de discipline plus fragmentée que la psychologie. Si un physicien
relativiste peut ne pas connaître la
théorie quantique, il admet
pourtant qu’elle fait partie de la physique. Il sait reconnaître ce qui fait ou
non partie de la physique. Mais ce n’est pas le cas en psychologie où personne
ne connaît l’ensemble des
références. Les auteurs majeurs pour les libraires,
comme
Abraham Maslow ou
Stanislas Grof
n’existent tout simplement pas dans l’enseignement. Il n’y a aucun rapport entre
ce que l’on trouve dans les magazines grand public de psychologie et ce qui se
pratique à l’Université.
Les spécialistes
disent pudiquement que les modèles biologiques de la recherche et le
modèle culturel de la psychologie
"ont du mal à s’articuler". Il faut mettre en garde le futur étudiant, s’il cherche
dans la psychologie universitaire une quelconque forme de « connaissance de
soi », il sera déçu et surpris.
Dans le consensus actuel on admet la différence entre psychiatrie, spécialisation des études de médecine dans la maladie mentale, psychanalyse, école fondée par Freud ; psychologie générale. On admet qu’un psychologue est, soit une personne que l’on embauche pour faire des tests de recrutement en entreprise, ou quelqu'un qui donne des consultations pour soulager des personnes vis-à-vis de leurs problèmes. Mais pour ce qui est des contenus, c’est le flou le plus complet.
Le mot psychologie veut dire « science » de « l’âme », en grec. C’est un mot qui n’a pas cours en psychologie. Nous pouvons dire connaissance du « psychisme », ou science de « l’esprit », ou de la « pensée », ou du « mental », ou du « comportement » etc. Cela donne autant de pistes différentes. La question qu’est-ce que la psychologie ? est redoutable en raison de la confusion régnante quand à l’objet que l’on considère. Il n'est même pas évident que le « connais-toi toi-même !» socratique ait aujourd'hui vraiment un sens en psychologie.
* *
*
Essayons de faire un état des lieux. La psychologie a sa place dans notre société, mais elle est tiraillée entre des exigences contradictoires. Les logiques de l'enseignement, de la recherche et de l'intervention ne se recoupent pas. Pour faire simple, disons que dans l’enseignement universitaire existe un corpus de références classiques comme Jean Piaget, Freud, etc. qui continuent d’être enseignés. Il existe une psychologie plutôt « neurologique », « comportementaliste » ou « cognitive », dans la recherche qui n’est pas du tout axée sur les mêmes références. Enfin, les thérapeutes peuvent se réclamer d’écoles extrêmement diverses : de la psychologie analytique, humaniste, transpersonnelle, spirituelle etc. le tout sans aucun rapport avec l’enseignement universitaire ou la recherche.
---------------1) Commençons par des remarques à l’attention de futurs étudiants en psychologie. Une confession tout d’abord. L’enseignement de la philosophie en classe de terminale fait la part belle à Freud. Mais le problème, c’est que cela fait belle lurette que la théorie de l’inconscient est contestée et désertée par les psychologues. En tout cas ce n’est jamais qu’une théorie parmi d’autres et elle est plutôt passée de mode. Il est parfaitement possible de faire des études de psychologie sans rien connaître de la psychanalyse. L’intérêt pour l’œuvre de Freud est maintenu en France artificiellement uniquement en raison du soutien que lui apporte l’enseignement philosophique et du succès littéraire qu’il a toujours rencontré en librairie. Freud n’est pas du tout représentatif des courants de la psychologie contemporaine. On ne peut pas demander aux enseignants de philosophie de tout connaître, mais le reproche qui leur est fait parfois de véhiculer une idée fausse de la psychologie est fondé. C’est une des raisons pour lesquelles la première année de psychologie en Fac s’avère pour beaucoup d’étudiants décevante et démotivante. Ils ne s’attendaient pas à ce qu’ils y trouvent, car ils sont restés sur l’image de Freud reçue en cours de philosophie en terminale. Il est donc important d’intégrer dès maintenant des éléments de critique de la psychanalyse et de garder l’esprit ouvert sur des approches différentes. Contrairement à une idée répandue, un bon psychologue n’a pas forcément lu Freud.
Autre idée reçue : on croit qu’il est indispensable d’avoir de solides bases en philosophie pour commencer l’étude de la psychologie. Théoriquement, c’est tout à fait juste, car la philosophie est par nature transdisciplinaire, c’est en elle que toutes les disciplines peuvent être resituées. Mais dans les faits, dans la pratique, c’est faux. L’étude de la psychologie est in facto complètement dissociée de la philosophie, ce qui correspond à la tendance actuelle de l’enseignement à fragmenter à l’extrême le savoir et à supprimer les ponts entre disciplines. Si un enseignement philosophique est maintenu en cycle universitaire, c’est seulement sous la forme d’une épistémologie de la psychologie. Une sorte d’annexe présentant les théories cognitives en général.
L’étudiant débutant croit aussi que le psychologue est quelqu’un qui se consacre à autrui par l’aide, ou le conseil, généralement en cabinet privé ou en établissement hospitalier. Ce n’est pas faux, mais ce n’est qu’une partie de la vérité. Une bonne partie de ceux qui se consacrent à la recherche en psychologie n’ont pas vocation à aider autrui. La psychologie ne se limite pas à la consultation. De plus, cet aspect est aussi largement pris en charge par la psychiatrie qui implique elle tout le cursus de médecine. La psychiatrie est une spécialité après la médecine.
Bref, il y a un fossé important entre la psychologie envisagée par le grand public, et la psychologie d’orientation scientifique enseignée en Université. Quelle serait la définition de la psychologie ayant cours dans l'enseignement ? Disons que le paradigme actuel définit la psychologie comme l’étude du fonctionnement des mécanismes mentaux qui sous-tendent les comportements humains. Cette psychologie revendique souvent le statut de science et elle entend produire avec une méthodologie scientifique, un savoir concernant l’objet qu’elle étudie, l’esprit humain. A cet égard, la psychanalyse freudienne (et ses dérivés comme la psychologie analytique de C. G. Jung), n’est donc qu’une sous-discipline, dans un ensemble très complexe.
2) Une fois ceci admis, le terrain est libre pour marquer des distinctions. Le plus simple, pour commencer, consiste à différencier les rubriques de la psychologie par leur domaine d’investigation, tel qu’il est identifié dans l’enseignement universitaire :
- La psychologie générale, appelée aussi psychologie cognitive, désigne l’étude du domaine de la pensée, appelé techniquement « cognition ». Elle recoupe des champs aussi variés que la perception, l’intelligence, le langage, la mémoire, l'apprentissage, la motivation et la résolution de problèmes etc. Le modèle cognitif est dominant dans l’enseignement.
- La psychologie différentielle : prend pour objet d’étude les différences entre les individus : le concept de personnalité, les différences sexuelle, les différences entre groupes sociaux etc.
- La psychologie de l’enfant, appelée aussi psychologie du développement étudie la genèse des structures mentales. Elle a été dominée par les travaux de Jean Piaget, auquel on adjoint un certain nombre d’auteurs ayant apporté leur contribution à l’étude du développement psychique du nouveau-né à la personne âgée.
- La psychologie sociale, étudie l’interaction entre individus, depuis l’intersubjectivité aux phénomènes de foules. Par exemple les schémas classiques du conformisme, de l’autorité, de l'obéissance, du désir de reconnaissance, des rapports conflictuels etc.
- La psychologie du travail est concernée par la tâche de recrutement, les tests en entreprise, la gestion d’une équipe, le règlement des conflits etc.
- La psychopathologie appelée aussi psychologie clinique, désigne l’étude des conduites humaines dans leur relation avec la santé mentale, du concept de normal, des dysfonctionnements psychiques et des méthodes de traitement.
- La psychophysiologie considère le psychisme de l’être humain en relation avec le fonctionnement du cerveau. Appelée aussi neuroscience du comportement. Il y a en France des facultés de psychologie orientées uniquement dans cette direction et qui demandent à l’étudiant un fort investissement en biologie et en mathématiques (fonctionnement du système nerveux, psychopharmacologie, neuropsychologie).
- La psychologie animale est liée à la catégorie précédente. Il est peut être étrange de placer dans cette liste une étude qui ne porte pas sur l’homme, mais il se trouve qu’historiquement, l’étude des comportements par les neuropsychophysiologues a joué un rôle important dans le développement d’une psychologie scientifique. Le comportement animal, (réflexe, perception, réaction), analysé dans le processus de stimulus/réponse est mesurable. Nous savons bien que là où est la mesure, il y a science. Il n’est donc pas étonnant que les développements de la psychologie animale aient été étendus à l’homme.
- La psychologie de l'éducation, ou psycho-pédagogie étude des pratiques éducatives, de la manière de les améliorer en milieu scolaire ou en centres éducatifs. (Discipline détestée cordialement par les enseignants débutants !).
- La psychologie de la santé : étude des comportements de santé, des conduites à risque, des risques dans les décisions de santé, de l'accompagnement de patients atteints de pathologies lourdes, soins palliatifs etc.
- La psychométrie désigne l’étude des tests d’évaluation psychologiques depuis le célèbre QI à d’autres comme le Rochschar.
- La méthodologie psychologique, étude des méthodes scientifiques de recherches appliquées en psychologie.
3) Notons que l’enseignement universitaire montre clairement l’absence d’unité de la psychologie. (notes) Témoin le fait que les programmes d’une Université à l’autre varient considérablement. En France il n’existe aucun programme commun à toutes les universités nationales, chaque Université étant libre de ses contenus. De plus, selon l’Université, on peut par exemple y trouver une orientation néo-freudienne ou au contraire une orientation scientifique bardée de statistiques, de méthodologie et de neuroscience. Même si on peut s’entendre sur le sens des têtes de chapitre précédentes, de fait, le contenu des cours est très hétéroclite. Dans une Université le contenu de la psychologie clinique peut se limiter à l’approche psychanalytique, dans une autre, elle ne sera jamais étudiée.
Quelques mots pour finir sur les métiers rattachés à la psychologie. Un psychologue est quelqu’un qui a fait des études en psychologie et a obtenu des diplômes, en France le titre est protégé par la loi depuis 1985. Il existe ensuite des qualificatifs : psychologue clinicien, psychologue expérimentaliste, psychologue du travail etc. qui dépendent de la formation suivie et d’une spécialisation. Nous avons vu plus haut le statut très différent du psychiatre. Seuls ces deux formations psychologue et psychiatre sont protégées par la loi. Un psychanalyste est quelqu’un qui a fait une analyse (freudienne) avec un autre psychanalyste et s’est ensuite mis à son compte. Un psychothérapeute est quelqu’un qui ouvre un cabinet de conseil, reçoit des gens et pratique une démarche relationnelle parfois rattachée à un courant. Il y a un flou dans la mouvance psy et des dérives possibles. N’importe qui peut du jour au lendemain mettre sur sa porte une plaque et se déclarer psychothérapeute ou psychanalyste. Il y a concurrence directe et rivalité entre psychanalystes, psychothérapeutes et psychologues. Les formations proposées par les psychothérapeutes sont, du point de vue de l’université, considérées comme sans valeur et elles n’ont pas de statut légal reconnu. A l’inverse, les magazines de psychologie grand public ont plutôt tendance à plébisciter des psychothérapeutes ayant une démarche créative originale, mais décalée. ____
--------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Questions:
1. Une philosophie sans psychologie aurait-elle plus de sens qu'une psychologie sans philosophie?
2. Pourquoi les théories psychologiques ne sont-elle pas falsifiables?
3. Comment expliquer le succès de la psychologie dans les médias?
4. Comment faudrait-il reformuler notre idée de la science pour que la psychologie en devienne une?
5. Est-il seulement sensé d'imaginer une psychologie sans spiritualité?
6. Qu'est-ce qui justifierait l'idée selon laquelle la psychologie commune est centrée sur l'ego?
7. Qu'est-ce que l'approche neurologique peut nous apprendre sur l'esprit?
© Philosophie et spiritualité, 2009, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()