Dans le
Charmide de
Platon, parmi les premières définition de la sagesse proposée à
l’examen figure l’idée que la sagesse serait une sorte de
calme, une
tranquillité avec laquelle l’homme accomplit une action. Comme il s’agit
d’un dialogue à caractère pédagogique, la tâche de
Socrate
va consister dans un
premier temps à réfuter ce point de vue. Pour cela, Platon identifie bien sûr la
modération, le calme ou la tranquillité avec la lenteur. Il n’a alors
aucune difficulté à montrer qu’il y a bien plus de beauté et de pertinence dans
la rapidité que dans la
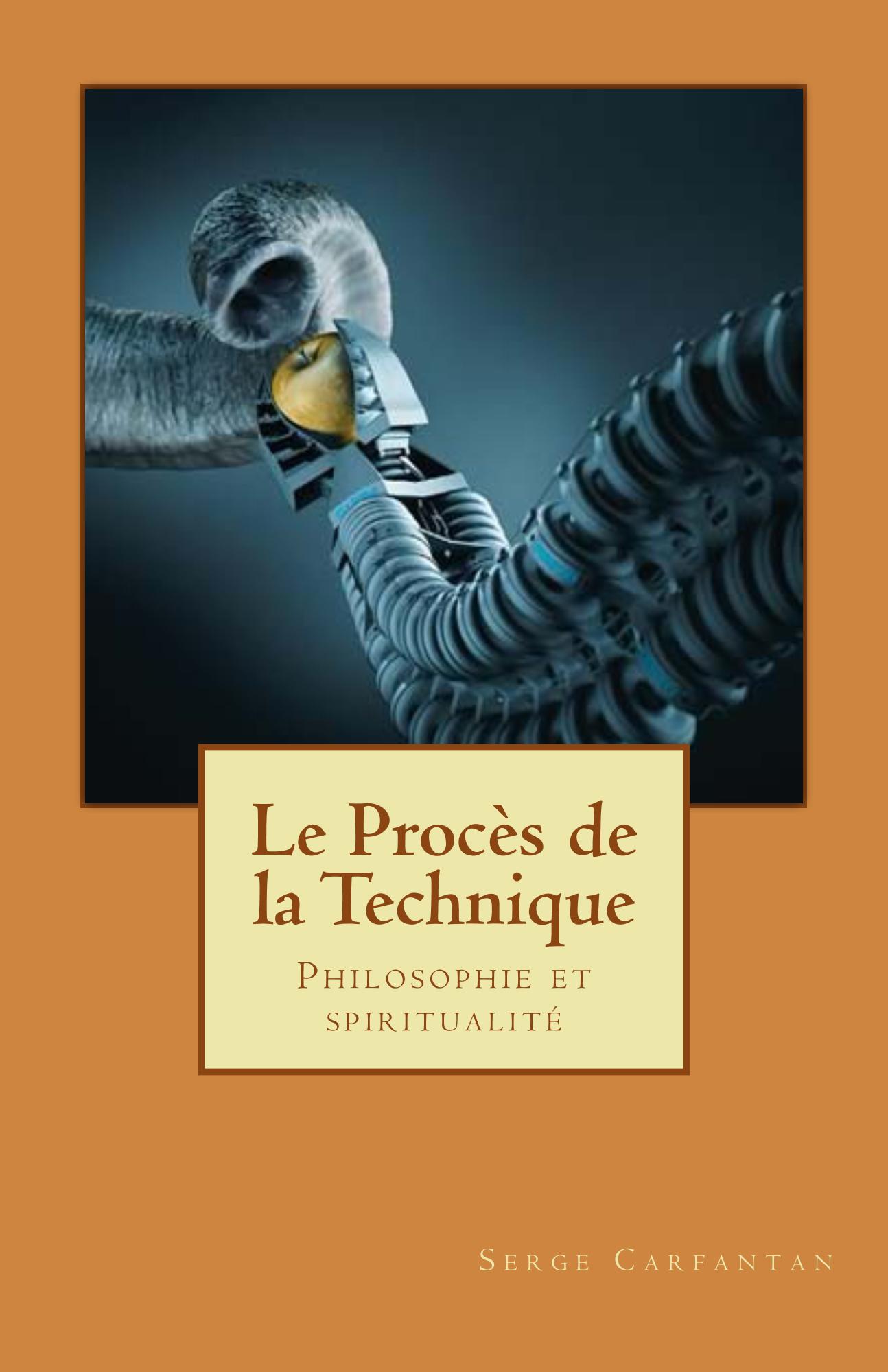 lenteur. Dans l’art d’écrire, on préfère la promptitude
à la lenteur. Dans la gymnastique, la lutte, le mouvement rapide et vif a plus
de beauté que le mouvement lent. Ainsi, puisque la sagesse a nécessairement une
relation avec la beauté, elle ne peut se définir par la lenteur. Voilà donc une
définition écartée et il est possible de passer à la suivante.
lenteur. Dans l’art d’écrire, on préfère la promptitude
à la lenteur. Dans la gymnastique, la lutte, le mouvement rapide et vif a plus
de beauté que le mouvement lent. Ainsi, puisque la sagesse a nécessairement une
relation avec la beauté, elle ne peut se définir par la lenteur. Voilà donc une
définition écartée et il est possible de passer à la suivante.
Néanmoins, le procédé est, il faut l’avouer, assez sophistique et Platon sait bien qu’il y a dans la conduite du sage quelque chose comme une modération, une attitude posée qui n’a rien à voir avec de la précipitation. Il existe une relation essentielle entre la tranquillité intérieure, la quiétude et la sagesse.
Nous autres qui vivons sous la domination, que dis-je, l’obsession de la vitesse, nous tombons aisément dans le premier sophisme. La lenteur nous irrite, nous vivons dans une civilisation où tout va très vite, de telle sorte que ce qui nous importe, c’est de vivre vite, car c’est seulement de cette manière que nous avons le sentiment de vivre. Il est assez commun de considérer que la vitesse est seulement liée à notre technique et de la dissocier de la conscience en pensant qu’elle vient s’y ajouter comme un facteur externe. Ne serait-il pas plus pertinent de voir dans la vitesse un signe des temps ? La vitesse technique est-elle la manifestation extérieure d’une pensée compulsive ? Ou bien est-elle une pression engendrée par le processus d’accélération, voir d’emballement de la technique ?
* *
*
La vitesse n’est pas une caractéristique annexe de notre civilisation mais bien un de ses traits les plus essentiels. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer à quel point la pression qu’elle exerce est omniprésente dans nos activités humaines. La vitesse désigne dans la phénoménalité un rythme du temps accéléré ; la séquence des événements est prise dans un flux de changement qui s’amplifie dans une montée exponentielle. La lenteur désigne au contraire un rythme de temps qui ralentit ; les événements se succèdent dans un flux de changement dont la cadence semble freiner au fur et à mesure que l’on avance. En d’autres termes, dans l’image du fleuve d’Héraclite, nous pourrions distinguer le cours affolé du torrent qui se gonfle d’un afflux soudain d’eau (des précipitations !), du cours majestueux du fleuve dont le mouvement ample tendrait presque à l’immobilité qu’il trouve pour finir dans le lac où il se déverse.
---------------1) Continuons à filer cette métaphore. Les événements sont comme des coquilles de noix portées par le courant. Le flux du temps. Il importe de ne pas confondre le rythme du temps et les événements qui y figurent qui, eux, sont dans le temps. Ainsi, comme l’a montré Bergson, si le temps s’accélérait et s’écoulait trois fois plus vite, l’aiguille de la montre se déplacerait aussi trois fois plus vite, parce que la montre existe elle-même dans le temps. Aussi la montre ne peut-elle mesurer le temps. Elle ne peut pas davantage mesurer l’accélération ou le ralentissement du temps. La montre donnera toujours les mêmes nombres. Cependant, c’est un point sur lequel insiste Bergson, la conscience, elle, sentirait l’accélération ou le ralentissement du temps, car dans la vigilance habituelle nous sommes profondément impliqués dans l’expérience du temps.
Oui mais de quel temps ? Evitons de tout confondre. a) Le temps de la nature, est celui de l’alternance du jour et de la nuit, de la succession des saisons, de la naissance et de la mort, des myriades de cycles au cœur de la nature, de la La Rondeur des Jours comme dit Giono. Ce temps-là va son cours et il se moque de notre empressement. Comme le dit Bergson, si je veux me préparer un verre d’eau sucrée, j’ai beau faire, il faut que j’attende que le sucre fonde. C’est un processus naturel qui requiert donc du temps.
b) De même, il me faut du temps pour faire un gâteau, pour construire une maison, pour écrire un roman. Le temps chronologique de la montre et du calendrier, est celui qui nous sert dans les rapports pratiques. Ce temps est, pour des besoins pragmatiques, spatialisé et il est très nettement linéaire.
c) Le temps historique est la liaison des événements qui retracent le cours de l’aventure humaine. Il suppose, comme le temps chronologique, une représentation linéaire du temps, dans un cadre que nous avons appelé le temps standard, lui aussi linéaire.
.. Cependant, il existe une forme de temps qui semble chercher directement cette confrontation avec le temps de la Nature. d) Le temps psychologique, en effet est le temps qui s’exprime dans la pression constante qui nous porte vers le moment à venir, l’échéance attendue, la protension en direction d’un résultat que l’on voudrait obtenir si possible tout de suite. « Insupportable d’attendre, ce rapport, il me le faut maintenant. Je suis pressé, il faut que les choses se fassent au plus vite.» Le concept de vitesse a son origine dans la pression exercée par le temps psychologique.
Pour la commodité de l’analyse, nous distinguerons la vitesse de la rapidité. Un épervier qui du ciel plonge sur une souris sortie au grand jour est très rapide. Un chat qui bondit sur une table le fait avec une rapidité étonnante. La course du léopard est magnifiquement rapide et leste à la fois. Toutefois, dans ces mouvements, il n’y a aucun stress. Pas de mental là pour exciter le mouvement. Le chat immédiatement après le saut retourne à un repos tranquille. Il peut y avoir dans la nature une promptitude alliée d’élégance, une rapidité des phénomènes naturels, mais qui est très différente du stress engendré par une pression humaine exercée pour obtenir une vitesse supérieure et la précipitation qui s’ensuit.
2) La vitesse n’est pas d’abord une cadence accélérée, la cadence accélérée est la traduction extérieure d’un état de conscience qui vise une accélération. Quel état ? Une addiction au besoin fébrile de faire vite, pour être plus vite au but. C’est d’abord en tant que vécu que la vitesse doit comprise. Nous avons vu que la vigilance est communément interprétée dans l’attitude naturelle comme un qui-vive à l’égard de l’objet et une surveillance. Cela ne signifie pas du tout que la vigilance soit identique à la Présence, car être sur le qui-vive au sens habituel, c’est guetter anxieusement ce qui risque d’arriver, c’est être tendu ou déporté vers le moment suivant. Le chef du bureau qui doit arriver de manière imminente… alors que je n’ai pas fini le dossier. Le type en seconde file qui risque de débouler sur l’autoroute et que je dois pouvoir contourner. Le dernier tour de la pendule qui me signale que dans une minute ce sera le signal pour partir etc. Alors, il faut faire vite, toujours plus vite pour arriver au moment suivant. La vitesse est en rapport direct avec le mouvement intentionnel de la pensée qui se voit déjà au but et ne supporte plus de devoir attendre. Un délai. Elle est l’exaspération de la pensée en lutte avec un monde qui est bien trop lent pour elle.
Nous avons vu qu’il appartient à la vigilance d’être d’avantage une conscience-de-quelque-chose qu’une conscience-de-soi. La première recouvrant la seconde. L’intentionnalité est comme une visée, telle une flèche tendue vers un cible qui est son objet. Comme l’a très bien vu Sartre, réduit à son ek-stase, elle n’est qu’un mouvement pour se fuir pour être déjà là-bas. Mais ce n’est pas d’abord là-bas, là-bas, près de l’arbre, mais là-bas dans le temps psychologique. En tant que mouvement de conscience, la vitesse est une sorte de fuite en avant. Cela veut dire une fuite du moment présent en direction d’un moment futur dont nous sommes le chasseur et dont nous souhaitons d’urgence la capture. Mais comme le futur par définition se dérobe sans cesse et qu’il y a toujours en avant quelque chose à poursuivre, nous disons « manquer de temps » pour « y arriver ». Nous disons être « pressés », nous disons qu’il faut sans cesse « courir après le temps ». « Nous n’avons pas le temps ». Ces expressions sont en fait inexactes, car en réalité, ce que nous trahissons dans cet état, c’est que nous sommes possédés par le temps psychologique, nous vivons dans la traction, l’irritation, l’inquiétude, l’affolement et l’agitation constante du temps psychologique. Si nous n’avions plus de temps, nous serions davantage conscients, simplement présents, nous serions tranquillement dans la présence. S’il est possible de parler de « manque de temps », c’est parce que le désir d’arriver est tellement impérieux qu’il exige sa dose, une dose supplémentaire de temps. Il se trouve engagé dans une guerre constante contre le temps de la Nature qui, lui, ne permet pas que d’un claquement de doigts nous arrivions déjà au but. Mais la guerre fondamentale, c’est avant toute la guerre contre le moment présent qui n’est jamais « assez », jamais assez satisfaisant, en comparaison de ce qu’il pourrait être si… il était déjà au futur. Alors l’impératif, c’est de faire vite, pour y parvenir. (texte)
Quand sonne le réveille-matin, pour des millions d’hommes, ce n’est pas simplement un rappel qu’il est l’heure de se lever, c’est le premier signal annonciateur d’une pression qui tout le jour va s’exercer, la course trépidante contre le temps, le contre-la-montre du stress au quotidien, jusqu’à ce qu’enfin le soir le repos nocturne relâche la pression. (texte) Cavalcade dans l’escalier, petit déjeuner avalé à la va-vite, marche forcée jusqu’au bureau. Excitation nerveuse sur le volant de la voiture avec une bordée de klaxon ou d’injures contre un conducteur qui ne va pas assez vite. Rodéo sur le périphérique pour ne pas être en retard. Précipitation au travail dans le tourbillon des gens qui ne cessent de courir en tout sens dans tous ce qu’ils font. Travailler vite pour se montrer plus efficace, plus performant, plus adroit qu’un autre, plus méritant, etc.
Un besoin dont on ne sort pas quand on quitte son travail, car il se poursuit dans le divertissement. Au cinéma, la plus grande partie de la production mise sur la vitesse de l’action, la tension du suspens du moment qui va arriver, la tension vers la fin, jusqu’à une libération finale gagnée de haute lutte : The end. Le cinéma qui vit à cent à l’heure, donne une image exacte de l’accélération mentale requise par le temps psychologique. On retrouve cette même figure dans le zapping constant des images à la télévision. Inutile de changer de chaîne d’ailleurs, car elles sont presque toutes formatées dans un seul moule, celui de la compulsion de la vitesse. Le cinéma est l’usine à produire des mythes postmodernes, autant qu’il est une fabrique d’objets conceptuels capables de nourrir le corps émotionnel d’êtres humains dopés au harcèlement constant du temps psychologique. La télévision est le reflet de la conscience collective qu’elle nourrit et qu’elle cherche constamment à séduire. Et puisque les hommes ne tiennent pas en place et qu’ils sont toujours en quête d’un ailleurs, et bien, elle leur sert toutes sortes de variations sur leurs propres constructions mentales. Bouger vite. Pas de pause. On entre en courant dans les studios de télévision !... Même si c’est pour s’asseoir et discuter ! La parole aussi doit aller vite : ainsi la polémique est une règle, car les échanges au fleuret verbal, les piques et la dérision systématique, cela va vite. Cela maintient une excitation émotionnelle. Il faut que tout cela bouge, danse, s’excite dans les images. Et quand il n’y a pas d’images, comme à la radio, on peut perpétuer l’hystérie par les jingles, la musique etc. Comme le bruit constant de la pensée dans la tête. Dans le même registre, il est inutile d’insister sur le jeu vidéo. Chacun reconnaîtra que la plupart du temps, c’est de l’excitation émotionnelle à la puissance 2 par rapport à la télévision. On atteint la limite dans la production hallucinée du réflexe : « tu penses pas, tu tires sur tout ce qui bouge ! » C’est là que l’addiction au moment suivant est la plus puissante. On rejoint alors le rythme endiablé d’un rêve très agité, où les événements se bousculent sans rime ni raison, mais où l’excitation émotionnelle se décharge dans un feu nourri. A raison de trois ou quatre heures par jour c’est presque un état second. Impossible d’ouvrir un livre. C’est trop lent. Impossible de maintenir l’attention, le mouvement du monde est si lent qu’il ne peut provoquer que l’ennui.
------------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Questions :
1. La vitesse a-t-t-elle un rapport avec la pulsion inconsciente?
2. Vouloir faire toujours plus vite, est-ce tenter de conjurer la mort ?
3. En quel sens vaut-il mieux gagner du temps que d’en perdre?
4. « Mieux vaut vivre à cent à l’heure et se tuer sur l’autoroute que de rester chez soi et vivre comme un légume » Qu’en pensez-vous?
5. Peut-on réellement parler d’une « culture de la vitesse »?
6. Le sens de la vitesse est-il prescrit par une culture au même tire que la manière de s’habiller ou de parler?
7. La recherche frénétique de l’instantané est-ce la même chose que l’art de vire au présent?
©
Philosophie et spiritualité, 2008, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est qu'un brouillon. Demandez par mail la version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la préparation de la leçon.
![]()