Dans un
monde tel que le nôtre, dans lequel la technologie est l’expression emblématique
de la volonté de puissance, il
semble très paradoxal à son propos de parler d’illusion.
Comment, ce que nous exhibons depuis la Modernité
comme notre conquête majeure, la
technique, elle qui nous a donné une fantastique supériorité sur le reste du
monde, elle qui a permis des prouesses extraordinaires, des avancées
prodigieuses, pourrait-elle être en quoi que ce soit être qualifiée
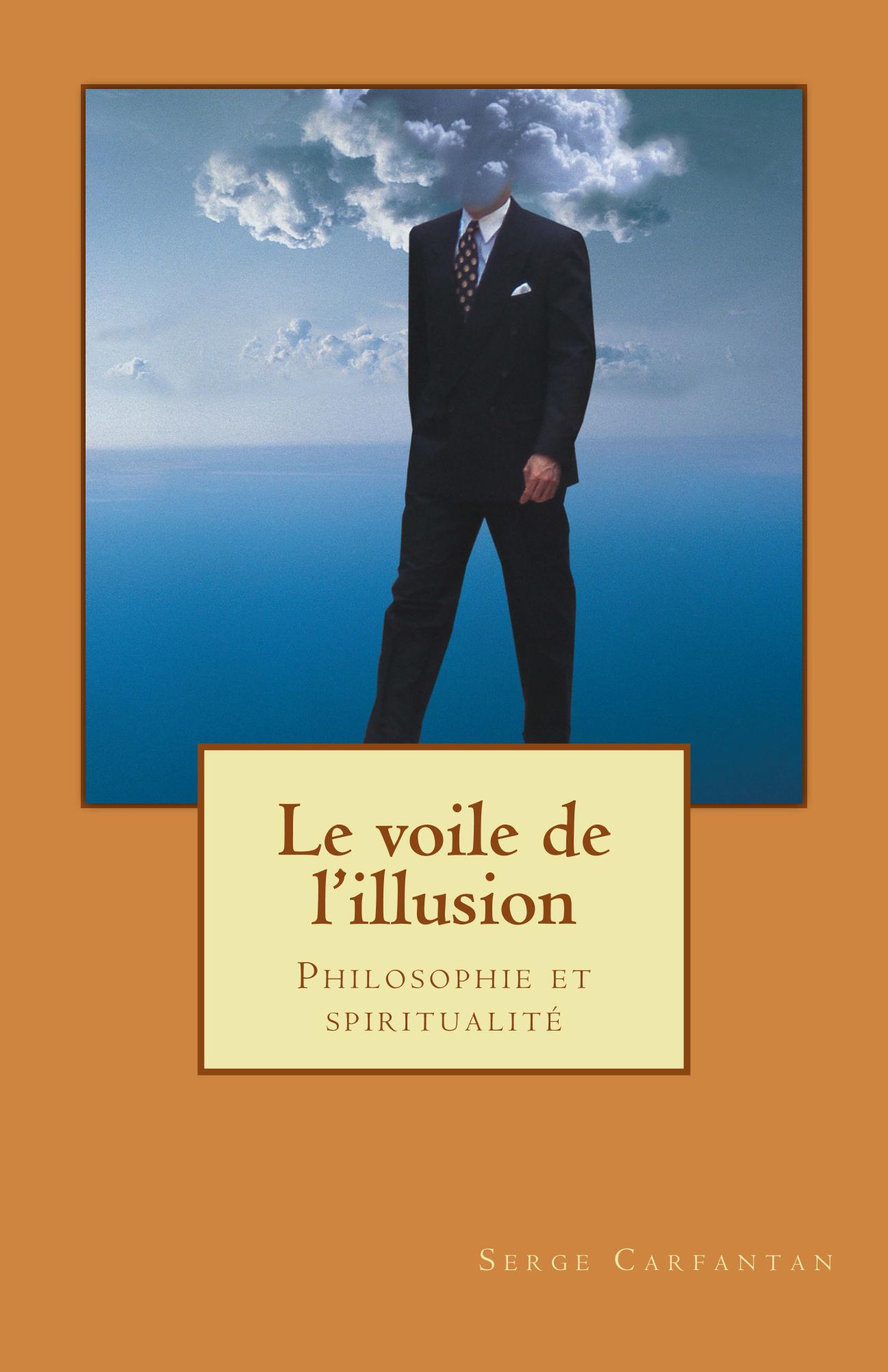 d’illusion ?
Non, non, c’est absurde. Ce n’est là qu’une pensée qui trotte dans la tête d’un
esprit rétrograde, pessimiste ou arriéré.
d’illusion ?
Non, non, c’est absurde. Ce n’est là qu’une pensée qui trotte dans la tête d’un
esprit rétrograde, pessimiste ou arriéré.
Enfin… si on gratte un peu la question il y a tout de même quelques raisons. Conformément à la définition vue précédemment, il faudrait penser que nous surimposons peut être à la technique quelque chose qui ne s’y trouve pas et qui n’est qu’un fantasme dans notre esprit, de sorte qu’il y aurait effectivement des illusions entretenues autour de la technique (texte). Nous nous laissons bluffer, sans voir que nous sommes emportés par un engouement collectif, une idéologie ambiante, qui nous aveuglent sur la réalité du phénomène technique, au point que nous ne le voyons même plus le monde tel qu’il est.
Nous avons eu l’occasion à plusieurs reprises d’évoquer le dernier livre de Jacques Ellul Le Bluff technologique. Dans cette leçon, nous allons y revenir, en explorant une question : si la technique constitue bien une puissance, en quoi peut-elle aussi susciter des illusions ? La question est précise et son traitement nécessite d’éviter tout écart dans le développement. Nous n’avons pas l’intention de répéter ici ce qui a été montré dans les leçons précédentes. Les formulations en apparence abruptes imposeront çà ou là quelques retours en arrière, mais sur le fond, il vaut mieux rester exigeant et congédier les généralités. Disons que cette étude se situe au point d’aboutissement exact à la fois des investigations sur l’illusion et de celles qui ont trait à la technique.
* *
*
Ne perdons pas notre temps à refaire une énième fois l’histoire des techniques, ce n’est pas ici notre objet. Partons du fait que nous vivons dans une civilisation de part en part technicienne, ce qui veut dire que le système technicien est omniprésent et qu’il détermine tout, bien au-delà des oppositions des idéologies politiques qui ne font que s’inscrire en lui. Considérant cette complexité, où serait l’effet d’illusion ? Bien entendu dans une représentation complètement fausse, une opinion pleine de « certitudes », communément répétées, partagées et enseignées, mais qui ne serait en rien conforme à ce qui est.
1) Ce qui fait que le technicien est plein d’assurance, nous l’avons vu, c’est qu’il a le sentiment de maîtriser une causalité linéaire , dans le domaine limité qui est le sien. Nous avons vu plus haut dans ce registre ce qu’il faut entendre par comportement rationnel et action logique. Si mon ordinateur tombe en panne, le réparateur suit un protocole de détection d’erreurs, un diagnostic rationnel permettant de mettre à jour la nature de l’incident. C’est purement technique et efficace. Transporter l’assurance acquise dans la maîtrise d’un processus technique fragmentaire, à l’ensemble du système technicien en croyant que l’on peut en avoir la maîtrise globale est une illusion. C'est très tentant, mais seulement en restant aveugle à tous les éléments d’incertitude présents dans la complexité du réel.
Or de la croyance inconsciente dans une maîtrise technique globale, on passe logiquement vers l’idée que la technique est bonne ou mauvaise seulement par l’usage que l’on en fait. « Avec un couteau on peut peler une pomme, ou tuer son voisin ». Que voilà une idée commode, répandue et universellement adoptée ! Comparaison absurde et illusion simpliste. Nous avons vu qu’il ne faut pas confondre un outil et une machine. Surtout : « la technique porte en ses effets en elle-même, indépendamment des usages ». Bien sûr qu’il faut tenir compte des usages. C’est par excellence le problème moral, mais cette question n’a rien à voir avec la compréhension globale de la technique. En d’autres mots, l’ambivalence du développement de la technique est bien plus complexe que la question de son usage. « Croire que tout dépend de l’usage que l’on en fait, c’est penser que la technique est neutre », mais c’est faux, la technique n’est pas neutre. « La technique emporte par elle-même, et quelque soit l’usage que l’on veuille en faire, un certain nombre de conséquences ». Ce n’est pas seulement une question de bonnes ou mauvaises intentions, le propre de la technique c’est d’offrir « des potentialités qui seront inévitablement exploitées. L’exemple simpliste et bien connu, c’est la poudre à canon : les chinois s’en sont servi uniquement pour les fusées d’artifice, mais elle contenait les potentialités que nous avons connues et qui ne pouvaient être négligées longtemps ».
Tout raisonnement qui part de l’usage des technique adopte donc des prémisses très courtes et aboutit au final à des formulations ineptes : Pensée dualisante incapable d’une appréhension globale. Témoin le poncif selon lequel il y aurait sur la question de la technique le camp des « optimistes » qui disent qu’elle est « bonne » et le camp des pessimistes qui disent qu’elle est « mauvaise » ! Tant qu’on y est pourquoi ne pas dire qu’il au sujet de la technique les « gentils » par tempérament et des « pas gentils » (on se croirait dans une conversation avec la maîtresse au CP).
« Le développement de la technique n’est ni bon, ni mauvais… il est fait d’un mélange complexe" , mais le plus important, c’est que dans la boulimie technologique qui nous caractérise, « nous sommes à notre tour modifiés ». « Nous ne sommes pas un sujet au milieu d’objets sur lesquels nous pourrions librement décider de notre conduite : nous sommes étroitement impliqués par cet univers technique, conditionnés par lui». Pour déterminer ce qu’est un bon usage, il faudrait déjà pouvoir consciemment s’élever au-dessus de la pensée technique, assumer notre idée la plus haute de la vie et de l’humain, décider collectivement, toutes choses singulièrement difficiles en raison ... Nous sommes au temps de la technocratie, de la pensée raplatie dans les considérations techniques et économiques.
.. ________________________
2) Quatre points développés dans la première partie du bluff technologique :
a) « Tout progrès technique se paie ». Le développement industriel de la vallée du Tennessee, par la destruction de son agriculture. Le progrès technique dans l’exploitation des textiles les plus courants (laine, coton, fibres artificielle) par le déclin de textiles dont l’usage a disparu (lin, chanvre) qui étaient plus durables. L’augmentation de la productivité agricole grâce au machinisme et à chimie, par le fait qu’elle ne peut plus être vendue à un prix capable de couvrir l’amortissement des équipements. (D’où la destruction systématique du monde paysan). L’augmentation de la productivité industrielle a été un progrès quand elle a ôté l’effort épuisant. Mais pour toute une série de conséquences. Quel gain si c’est pour un travail de surveillance passif ou des gestes mécaniques ? La transformation technique du travail s’est aussi communiquée au mode de vie produisant une pression psychologique extraordinaire : « Nécessité d’aller en toutes choses de plus en plus vite, rythme de vie croissants (fast-food), multiplicité de contact humains superficiels, tension des horaires… Vivre dans un univers où tout est calculé à la minute est épuisant » etc. Inutile d’en ajouter, la liste est ouverte, il est très facile d’illustrer ce point.
b) « Le progrès technique soulève des problèmes plus difficiles que ceux qu’il résout ». En d’autres termes, qu’il faut très soigneusement examiner en partant de l’observation : la pensée technique, chaque fois qu’elle apporte une solution, crée en même temps des complications, que l’on ne remarque pas d’abord, en raison de la fascination qu’exerce l’innovation, mais qui se font sentir ensuite en devenant des problèmes. Les exemples sont innombrables. Ironie, dès 1970, c’est un défenseur enthousiaste de la technique, Elgozy, qui posait cette question étrange : « l’informatique poserait-elle plus de problème qu’en n’en saurait résoudre ? ». Incroyable, quand on sait dans quel maelström on s’est engagé ensuite ! Elgozy disait que devant la multiplication des difficultés, on aurait sûrement avantage… à revenir à système de mécanographie moins présomptueux ! ! Si on fait le calcul de la somme des problèmes à s’arracher les cheveux, du temps perdu, du gaspillage d’énergie, du stress, de la tension nerveuse, pour les comparer le confort des solutions apportées, il n’est pas certain que le décompte soit vraiment positif. Ce qui serait illusoire, c’est de ne prendre que ce qui nous séduit, sans considérer le phénomène global.
Il y a un effet par lequel les complications s’accumulent qui tient au raisonnement que la technique impose. En présence d’un problème humain, quel qu’il soit, le mental dominant tend systématiquement l’analyser de manière à ce qu’il se réduise à un « problème technique », auquel on apportera ensuite une « solution technique » (vendue surtout par des multinationales), ce faisant, on se rend compte ensuite que de nouveaux problèmes sont apparus, auxquels on doit apporter une « solution technique » (vendue surtout par les multinationales) pour les résoudre, mais l’application de ces solutions… etc. Il existe dans de très nombreuses illustrations et cet enchaînement conduit à ce qu’Illich appelle la contre-productivité. Comme le médicament qui soigne une maladie, mais détruit la flore microbienne, auquel il faut associer un autre produit qui… par ailleurs n’est pas bien assimilé et à des effets secondaires et donc…etc. Le schéma est à dupliquer dans tous les domaines : éducation, justice, santé, vie sociale, loisir etc. Le livre de Jacques Ellul date de 1988. On ne peut que rester songeur quand il pose à un moment la question : « quels seront les vastes problèmes qui seront soulevés lors de la nouvelle étape d’expansion du système technicien, avec le génie génétique, l’informatique, le laser, l’espace ? »
De plus, y a un intérêt économique évident à ce que les problèmes se reproduisent, parce que, comme les solutions sont toujours techniques, les seuls qui en disposent, devront être appelés à chaque fois à la rescousse pour les résoudre. L’empire technologique se nourrit des dysfonctionnements qu’il crée. Ce qui implique aussi qu’il fonctionne dans la logique de l’obsolescence programmée. Dès lors l’alternative posée par Ellul est très claire : où bien nous faisons usage d’une technique et nous acceptons de mettre le doigt dans l’engrenage, ou bien nous décidons carrément de ne pas nous en servir !
c) « Les effet néfastes sont inséparables des effets positifs ». Il est très difficile, voire impossible, de séparer les techniques de paix, des techniques de guerre. La recherche génétique avancée sur un virus pour un vaccin peut aussi permettre de fabriquer des armes biologiques. De même, comme nous l’avons vu auparavant, la bombe atomique n’est pas « le produit de quelques méchants bellicistes, mais un résultat normal du développement des recherches atomiques ». Donc, dans tout ce que produit la techno-science « rien n’est univoque ». « Les techniques d’exploitation
------------------------------ des richesses sont bonnes pour l’homme ? Sans doute. Mais lorsqu’elles conduisent à l’épuisement de ces richesses… à une exploitation sans frein… ? Les techniques de production sont bonnes, sans doute. Mais production de quoi ? Comme ces techniques permettent de produire n’importe quoi »… on «s’appliquera à des productions absurdes, vaines, inutiles ». La technique n’est concernée que par la production. « Et comme la seule affaire importante de l’homme, c’est de travailler, que sa participation à ce développement… est son moyen de vivre, le voici engagé dans un travail de production de choses inutiles, absurdes et vaines, mais infiniment sérieux, car il y consacre une vie d’homme ». Donc, la prolifération technique n’est pas nécessairement douée de sens.
L’orientation impulsée par la technique pousse partout à la spécialisation, stimulant en permanence l’accélération des rythmes et la production, produisant implacablement un effet « d’encombrement généralisé». Produire pour produire pour produire partout et de tout c’est encombrer. Voir de P. Massé L’Homme encombré. Encombrement des villes par l’automobile, encombrement des espaces par la publicité, (et des boîtes aux lettres), encombrement mental des sons, des images, des écrits. Encombrement par le papier…qui perd en définitive sa signification par étouffement. « Surcharge des programmes scolaires qui est la rançon exacte de la croissance de nos connaissance ». « Programmes démentiels qui ne peuvent qu’écraser la personnalité et la sensibilité de l’enfant ». Et par-dessus, fureur des règles, des règlements et des lois pour dominer l’encombrement, ajoutant par là encore des complications à un réel déjà… très encombré.
d) Tout progrès technique comporte un grand nombre d’effets imprévisibles. « L’imprévisibilité est un des caractères généraux essentiels du progrès technique, se situant aussi bien au commencement, au stade de l’invention et de l’innovation, qu’au cours de l’application, et à la fin, au stade des effets ». « Tout progrès technique comporte trois sortes d’effets : les effets voulus, les effets prévisibles et les effets imprévisibles ». Comment forer à 3000 mètres de profondeur pour atteindre une nappe de pétrole ? Le problème posé lance la mise en œuvre de nouvelles techniques pour le résoudre. « La technique est assez sûre et donne ______
ceux qui sont totalement imprévisibles et inattendus. Dans le domaine de l’habitat par exemple, un nouveau système de blocs d’unité de logements va provoquer une mutation sociale dont on ne sait rien au final. Certains des effets inattendus auraient pu être prévus. Ellul cite l’enlisement de Venise et le naufrage du Torrey Canyon. Cependant, il est dans la nature de notre adhésion inconditionnelle à la technique d’inciter à une confiance aveugle. « La formule ‘le pire n’est pas toujours sûr’ est le meilleur oreiller de la paresse » !
La représentation commune de la technique, portée sur des raisonnements à courts termes, ne reconnaît pas ...
------------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Questions:
1. L'addiction à l'image est-elle fondamentalement différente des autres formes d'addiction?
2. S'il est déraisonnable de vouloir de s'opposer au progrès technique, quelle forme doit prendre notre discernement?
3. Quelle différence y a-t-il entre complexité et complications techniques?
4. Est-ce seulement pour le philosophe que la technique apparaît comme un problème?
5. Vouloir simplifier notre vie implique-t-il nous débarrasser de la technique ou en faire un un usage plus intelligent?
6. Quel mirage se cache dans "les solutions techniques"?
7. Que deviendrait la technique si elle était portée par une conscience de l'humanité plus élevée?
![]() © Philosophie et spiritualité, 2012, Serge Carfantan,
© Philosophie et spiritualité, 2012, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()