Si, comme
nous l’avons vu précédemment, la haine de soi conduit
à la haine d’autrui, le manque de confiance en
soi
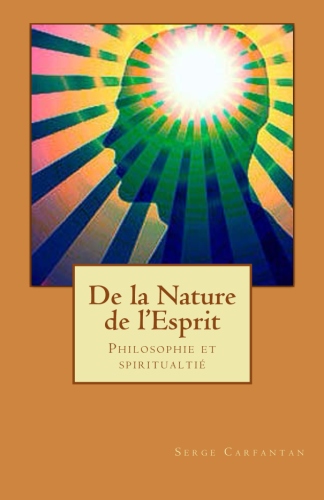 conduit invariablement à la défiance ; inversement, l’amour
de soi, mène à l’amour d’autrui, et la confiance en
soi mène à la confiance en l’autre.
conduit invariablement à la défiance ; inversement, l’amour
de soi, mène à l’amour d’autrui, et la confiance en
soi mène à la confiance en l’autre.
Mais comment pourrions-nous avoir un tant soi peut confiance en nous-même, si par ailleurs, nous vivons avec un très fort déficit d’estime de soi ? C’est peu de le dire, mais s’il est un trouble répandu dans notre société, c’est bien celui-là. Exciter en permanence la comparaison, chercher à se montrer « à la hauteur » d’un autre, comme nous savons si bien le faire, au bout du compte ne fait que contribuer à créer une image du moi négative : on n’est jamais assez bon, assez beau, assez puissant, assez intelligent etc. ! Nul ! Et quand nous vivons centré sur l’ego, l’effet est dévastateur, il sape la confiance en soi. Le corollaire, c’est qu’on s’imagine alors qu’il faut démesurément gonfler son ego pour être quelqu’un. Comme les vedettes du show business, les stars de la télévision ou tous ces gens arrogants dans les affaires ou la politique, qui semblent tirer une incroyable assurance de leur enflure personnelle... Comme s’il y avait un rapport entre infatuation personnelle et la confiance en soi !
Il y a assurément un lien subtil entre confiance en soi et estime de soi, mais quel est-il ? Est-ce que je dois me regarder dans la glace tous les matins en me faisant une petite harangue personnelle ? « Je suis fort, efficace, compétent, le meilleur… et je les écraserai tous !» La confiance en soi marche-t-elle à l’autosuggestion ? Et si c’était tout à fait autre chose ? Et si elle n’avait rien à voir avec une quelconque comparaison avec autrui? Par-delà la psychologie naïve et les incantations verbale, qu’est-ce que la confiance en soi ?
* *
*
Si par devers soi, nous n’avons que bien peu d’estime pour nous-même, c’est que nous entretenons un désamour qui provient d’un jugement. Je me juge ne méritant pas d’estime. Ce qui implique forcément une comparaison dans laquelle d’autres seraient plus méritants en termes d’estime d’eux-mêmes, mais je n’ai justement pas ce mérite. Psychologiquement ce méli-mélo mental est assez confus et doit être mis en lumière. Un premier biais d’approche serait d’examiner les sources historiques de cette étrange notion « d’estime de soi ».
1) Indéniablement, il y a en Occident dans cette expression une provenance archaïque encore teintée au Moyen-âge de l’éthique de la chevalerie. C’est la noblesse qui tenait en « très haute estime » le héros, le brave et l’homme de valeur. Ce sont les chevaliers qui se battaient pour des questions d’honneur, pour qui l’honneur bafoué et souillé était pire que la mort. Voyez ce qu’en dit Hobbes dans Le Léviathan. Dans cette lignée, l’homme d’honneur ne veut pas nécessairement passer aux yeux de tous pour un héros, mais il a souci de lui-même et souhaite être estimé à la hauteur de son mérite. Il tient ...
Dans la société féodale l’éthique de la chevalerie, tournait autour de quatre vertus. Il s’agissait de la vaillance, vertu militaire comme il se doit, du cavalier sur le champ de bataille. Mais aussi de la loyauté, le chevalier étant l’homme qui se met au service du roi. Tel Roland jurant sa foi et qui, même emporté dans la guerre, se refuse à toute manœuvre qui violerait le code de l’honneur en se livrant à des vilenies indignes de son rang. La largesse désigne elle la vertu de répandre des bienfaits autour de soi, le chevalier devant être renommé non seulement pour ses victoires, mais aussi pour ses dons. Enfin, ce qui a donné lieu à bien des expressions artistiques, la courtoisie, accompagné de tout son cérémonial. En bref, ce sont les vertus caractéristiques de la noblesse. L’idéal chevaleresque dissimule, mais suppose chez celui qui l’incarne une image du moi élevée, encadrée par une éthique ou un code. Et on peut observer que dans toute l’histoire humaine, sous des formes variées d’une culture à l’autre, c’est certainement dans la littérature chevaleresque que l’on trouve le plus magnifiquement sublimée l’image du moi.. Des serments héroïques, aux conquêtes nimbées de gloire, des tourments du devoir jusqu’aux décisions devant la mort. Au prix da la plus grande cruauté, car l’honneur impose les plus grands sacrifices. Dans pareil contexte, pour le héros tragique, qui par ses fautes ne mérite plus que le déshonneur, la honte et le mépris, il ne reste que l’issue du bannissement ou du suicide. « S’il vous reste encore de l’honneur, Monsieur, vous savez désormais ce que vous devez faire. Vous trouverez un revolver dans le tiroir du bureau » ! Un classique pour les répliques de théâtre, mais sur le fond, une figure très ancienne de la psyché humaine.
Bref, si le mot estime vient du latin aestimare pour évaluer, ou apprécier, il demeure que son sens veut bien dire opinion favorable que l’on a d’autrui, opinion fondée sur ses mérites et ses vertus et rien ne peut permettre de le mieux le comprendre que de le relier à son ascendance aristocratique. Dans l’opinion, l’estime de soi conserve ces caractères et cela d’autant plus que son fondement psychologique est dissimulé sous les atours de la morale.
2) Si, selon un mot d’Alain, Descartes reste de mémoire le « cavalier français » de la philosophie, comme en témoigne sa correspondance, il a aussi fréquenté les Grands de ce monde, tout laisse à penser que nous pourrions trouver des éléments de représentation médiévale de l’estime encore dans sa philosophie, voire même qu’il en assume les présupposé. Mais Descartes est philosophe, en lisant de près le Traité des Passions, nous sommes ...
A l’article 162 Descartes donne une définition de « la vénération ou du respect ». Or comme nous l’avons précédemment noté, cela pose problème pour autant que vénération et respect peuvent être distingués. Nous l’avons fait en disant qu’il ne fallait pas confondre l’admiration et le respect. S’il nous fallait pouvoir admirer quelqu’un pour le respecter, nous ne respecterions pas grand monde ! Au mieux, nous admirons une valeur exemplaire : un parangon d’intégrité, d’honnête, de courage, de puissance créative, un être humain qui s’est révélé exceptionnel et qui mérite d’être pris pour modèle, ensuite, c’est à la charge de la mémoire ou de l’histoire de porter cette vénération de génération en génération. Mais au pire, la vénération peut être entièrement dans l’illusion, dans le spectacle et la fiction médiatique, celle que la télévision fabrique autour d'une image pour fédérer la bêtise ambiante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une solution à cette difficulté serait de dire que le respect, n’a rien de formel : nous nous inclinons intérieurement (le namaskaram de l’Indien) devant la dimension spirituelle présente dans la personne d’autrui. Comme la présence spirituelle est infiniment plus vaste et plus essentielle que l’apparence ou l’ego, il y a dans le respect une reconnaissance de l’âme et donc, il est parfaitement juste de dire « la vénération ou le respect ».
Quel est le point de vue de Descartes ? Il écrit que la vénération ou le respect « est une inclination de l’âme non seulement à estimer l’objet qu’elle révère, mais aussi à se soumettre à lui avec quelque crainte, pour tâcher de se le rendre favorable ». En première lecture, rien de plus facile, de plus primaire que de personnaliser les choses, et nous reviendrions alors vers la mythologie chevaleresque et l’attitude dévote du petit peuple devant la puissance des Seigneurs. Mais avec un peu plus de subtilité, nous verrions que seule la dimension spirituelle importe, c’est l’aura du seigneur plus que sa personne qui compte. Une puissance spirituelle qui rayonne dans la Nature. Or chez Descartes, très clairement, le sentiment de vénération se rapporte justement avant tout aux causes libres présentes dans la nature. Quand il discute dans l’article 152 des Passions de l’Ame la question de savoir de quelle façon nous sommes en droit de nous estimer ou bien de nous mépriser, il répond que c’est entièrement dans l’usage que nous faisons de notre libre-arbitre. Il n’y a qu’un seul point à prendre en compte dans le jugement porté sur soi-même, celui : « qui nous puisse donner juste raison de nous estimer, à savoir l’usage de notre libre arbitre, et l’empire que nous avons sur nos volontés ». Qu’est-ce qui est estimable par-dessus tout ? Le don magnifique du libre-arbitre déposé en tout être humain. Or c’est une grandeur qui ne doit rien à la gloriole de la reconnaissance, au pouvoir sur autrui ou à l’opinion flatteuse de l’ego que nous aimons tellement voir confirmer. Non. C’est infiniment plus modeste. Plus humble et plus précieux à la fois. Ce qui est difficile à comprendre et tout à fait singulier dans la générosité : « je crois que la vraie générosité, qui fait qu'un homme s'estime au plus haut point qu'il se peut légitimement estimer, consiste seulement partie en ce qu'il connaît qu'il n'y a rien qui véritablement lui appartienne que cette libre disposition de ses volontés, ni pourquoi il doive être loué ou blâmé sinon pour ce qu'il en use bien ou mal, et partie en ce qu'il sent en soi-même une ferme et constante résolution d'en bien user, c'est-à-dire de ne manquer jamais de volonté pour entreprendre et exécuter toutes les choses qu'il jugera être les meilleures ; ce qui est suivre parfaitement la vertu ». (texte)
Ce qui ...d’une immense importance c’est l’autoréférence du sujet dans ......
---------------- L'accès à totalité de la leçon est protégé. Cliquer sur ce lien pour obtenir le dossier
Questions:
1. Le manque de confiance est-il seulement de l'ordre d'un problème relationnel?
2. Peut-on imaginer une volonté sans confiance en soi?
3. L'auto-suggestion conduit-elle à la confiance en soi?
4. Dans une société divisée contre elle-même, la confiance en soi demeure-t-elle possible?
5. Être confiant, est-ce inconsciemment se soumettre et suivre un ordre?
6. La confiance en soi peut-elle être le résultat d'une contrainte ou d'un effort?
7. En quel sens peut-on dire que le mental est très doué pour faire du sabotage interne?
© Philosophie et spiritualité, 2013, Serge Carfantan,
Accueil.
Télécharger,
Index analytique.
Notions.
![]()
Le site Philosophie et spiritualité
autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom
de l'auteur et celui du livre en dessous du titre. Rappel : la version HTML n'est
qu'un brouillon. Demandez par mail la
version définitive, vous obtiendrez le dossier complet qui a servi à la
préparation de la leçon.
![]()